Georges COPPOLANI
AIN–BEIDA
La Source Blanche
S o u v e n i r s d’e n f a c e
Tous droits réservés ®
Note du transcripteur : Ces livres : "Ain–Beida-La Source Blanche-Souvenirs d’en face" ainsi que : "Mon père m'a dit", à partir de la page 67, étant la propriété intégrale de M. Georges Coppolani, qui par Devoir de Mémoire, a bien voulu les éditer sur le site de sa ville natale :
Nous le remercions pour cette louable initiative. Personnellement, je suis sincèrement touché par ce geste et cette confiance de la part de Monsieur Georges Coppolani. Ain-Beida Mars 2013
Boubakeur Kalache
A V A N T - P R O P O S
Ecrire des souvenirs sur une période remontant à plus de soixante ans est une tâche difficile en raison de l'évolution des idées et du sens des mots. Parler de gens sous des appellations particulières dont l'usage a modifié profondément le sens, présente une difficulté qui tient aux connotations péjoratives prises par certains mots au fil du temps, souvent sous une pression idéologique
J'avais pris le parti délibéré d'appeler les différentes populations de l'Algérie de mon enfance par leurs noms réels, sans me préoccuper du sens sous-entendu ou détourné qui à pu leur être attribué, pour des raisons qui sortaient de mon propos. Cependant, après une énième relecture, je me suis rendu compte que j'étais gêné par l'appellation "indigènes" attribuée aux seules populations musulmanes, car elle n'avait pas été d'un usage général, et été détournée de son sens bien qu'elle correspondît à une partie de la réalité ethnique puisque les Français sont les indigènes de France, enfin pas tous
J'ai donc décidé de ne pas les discriminer par leur religion et les appeler "les Algériens". Je ne pouvais pas les nommer "Arabes" puisque les Berbères les ont largement précédés au nord de l'Afrique
Cela n'a pas été sans me poser quelque problème car les Européens d'Algérie se disaient aussi Algériens, car tels se croyaient-ils
Depuis le début du siècle, les populations de confession israélite, auxquels le Décret Crémieux avait octroyé le statut de français de plein droit, n'étaient plus considérés comme des indigènes, alors que leur présence sur le sol algérien était antérieure pour une grande partie, historiquement parlant, à celle des Arabes, venus de la Péninsule arabique à la fin du VIIe siècle
Leur communauté présentait indépendamment de la religion, une spécificité telle sur le plan des traditions et des coutumes, que je ne pouvais que respecter leur identité. C'est la raison pour laquelle je les ai appelés les Juifs. C'eût été au contraire les noyer dans la communauté hétérogène des autres non musulmans et les assimiler à un type de population très différente, en les nommant par exemple israélites qui renvoyait à leur seule religion et le terme d’Européens ne pouvait leur être attribué. On a trop vu depuis le ridicule des appellations inventées par le législateur français pour désigner telle ou telle partie de ceux ayant quelque chose à voir avec l'Algérie
J’ai pensé à la lignée des prophètes des Saintes Ecritures revendiqués par tous les mono-déistes, qui étaient Juifs comme d’ailleurs la mère du Christ, que nombre de Musulmans appellent Lalla Meryem, en tout cas au Maroc. Pour les Algériens, je ne me souviens pas, c’est si loin
Il faut souligner que parmi les concessionnaires urbains du village d’avant 1870, figuraient tous les patronymes juifs qui nous sont jours si familiers : Allouche Attali, Cohen, Doukhan, Guedj, Nakach, et Zerbib, tandis que parmi les premiers Européens, seuls Balmély, Gesta, Mosca, et Xicluna étaient encore Aïn-Beïdéens dans les années 30 et 40
Enfin, les Européens étaient donc tous les autres, qu'ils fussent originaires de France ou bien de l’un des pays de la Méditerranée. J'en ai mentionné l’origine que lorsqu'eux-mêmes la revendiquaient en sous-entendant qu'elle était valorisante
? Écrire... Pourquoi ? Pour qui
«Écris donc un livre sur Aïn-Beïda!». C'est par ces mots que "mon" instituteur Ninou Lagana, conclut l'évocation de mes souvenirs lorsque nous nous retrouvâmes il y a vingt-cinq ans
Je suivis partiellement son conseil et jetai noir sur blanc quelques pages descriptives sur le village algérien de mon enfance. Je me suis arrêté en chemin constatant que si je pouvais décrire les lieux et les habitants, j'étais à court d'anecdotes. Il me sembla alors qu'on ne saurait écrire un tel "ouvrage" sans raconter des "histoires" sur les personnes
Je n'ai pas cherché à ce moment là, les raisons pour lesquelles je ne disposais pas de tels éléments, ni si cela avait vraiment une grande importance
Depuis lors, j'y ai réfléchi et j'ai trouvé les raisons de ce que je croyais être des lacunes. Dans mon milieu familial, on ne laissait filtrer vers les enfants que le minimum de choses concernant les adultes, leur comportement ne les "regardant" en rien
En outre, nous n'étions apparentés à personne dans le village et cela nous privait -nous les enfants- des petits racontars auxquels on se livre entre cousins plus ou moins rapprochés
Les années ont passé et j'ai voulu relire les rares pages que j'avais écrites naguère. J'ai eu la désagréable surprise de constater que depuis lors, ma mémoire avait gommé certains de ces souvenirs. Plus récemment, avec la disparition d'amis que je pouvais considérer comme une source de rafraîchissement de ma mémoire, j'ai pris conscience qu'il ne resterait bientôt plus personne pour dire comment était réellement la vie à Aïn-Beïda dans les années trente et quarante
Il ne s'agit pas pour moi d'écrire véritablement un livre destiné à être diffusé, mais plutôt de confier à l'écriture mes souvenirs d'enfant élevé dans un village des Hauts-Plateaux du département français de Constantine. Les limites de mon ambition sont ainsi marquées: écrire mais sans savoir si l'on me lira un jour... des amis peut-être.
Il convient en outre de préciser le cadre temporel de mon propos. Né en 1930 à Aïn-Beïda, je n'y ai vécu de façon permanente que jusqu'en 1942, date à laquelle ma mère consentit à me laisser aller au Lycée à Constantine. Lors des années suivantes, je n'ai plus séjourné au village que de façon périodique au gré des vacances scolaires. À partir des années cinquante, mes passages s'y sont faits rares jusqu'à mon ultime séjour de quarante-huit heures en Juin 1956 avant de rejoindre au Maroc l’École de Chasse de Meknès.
Mes souvenirs couvrent donc essentiellement le proche avant-guerre et la période de la guerre. Cette tranche de temps est cependant caractéristique. Elle marque en effet l'apogée du développement français du village et le début de son dépérissement. Ceux qui ont continué de vivre à Aïn-Beïda jusqu'à la fin n'ont peut-être pas senti cette évolution des choses en raison de l'accoutumance aux changements vécus au quotidien. A chacun de mes retours, je ressentais un grand malaise et je pensais que je finirais par ne plus avoir le courage d'y revenir. Le destin a tranché pour moi ...
Le village de mon enfance n'a pas résisté aux bouleversements de la seconde guerre mondiale et il a disparu dans la tourmente des années cinquante. Géographiquement il existe toujours un lieu habité qui porte le doux nom que j'entendrai toujours avec un pincement au cœur: Aïn-Beïda. Il est désormais peuplé d'ombres.
La création d’Aïn-Beïda
Aïn-Beïda est un village situé sur les Hauts-plateaux du Constantinois, sur un axe routier très important joignant le chef-lieu Constantine à la frontière algéro-tunisienne et au delà, Tébessa à Tunis. Son importance stratégique sera révélée en 1942, lors de la campagne de Tunisie face à l'Afrika Korps du Maréchal Rommel.
Cette partie orientale des Hauts-plateaux dont l'élévation est souvent voisine de 1000 mètres, est bordée au sud par le massif des Aurès et au sud-est par les Monts des Némencha. Elle constitue un vaste ensemble comportant des montagnes fortement boisées d'essences diverses: chênes-verts, lentisques et arbousiers rapprochés en maquis souvent très dense. Mais certains djebels sont garnis de belles forêts de pins et de sapins.
Cette région était peuplée, avant l'arrivée des Français par la tribu des Haracta, berbères arabisés au mode de vie nomade, éleveurs de moutons et de chevaux, turbulents et partagés en fractions souvent rivales, promptes à s'allier ou se combattre selon les circonstances. On dit que Massinissa y aurait levé sa légendaire cavalerie numide. Malgré les invasions arabes et leur conversion mouvementée à l’Islam, ils étaient restés berbérophones. La conquête française a provoqué l'extension de la langue arabe mais leur particularisme n'a pas beaucoup varié en plus d'un siècle de colonisation.
Ces Chaouïa (de l'arabe chawaya: nomades éleveurs de moutons") se présentaient toujours sous leur aspect farouche, secs et endurants, facilement rebelles, manipulant adroitement leur éternelle canne au bout formé en boule, le debouz et aptes au jet de pierre, ils étaient à la hauteur d'une réputation qui en faisait une population à laquelle il valait mieux ne pas se frotter. Ils ont donné aux régiments de tirailleurs et de spahis leurs lettres de noblesse militaires.
Après la prise de Constantine en 1837, 1'expansion française se fit en direction du sud et de l'est mais ce n'est que lentement sur une période de quinze ans que fut occupé l'ensemble du territoire où seront créés les centres de Batna (1844) et Tébessa (1851).
Un Cercle militaire prit en 1848 le nom de la source qui avait guidé son installation en ce lieu. Ce nom lui fut heureusement conservé. Cependant la soumission des Haracta comporta un épisode insurrectionnel important en 1852. La construction de deux bordjs permit de rétablir l'ordre, avec le concours efficace du caïd des Ouled Kanfar dont le bordj était établi au lieu-dit Aïn-Beïda Seghira. Ses descendants continuèrent de remplir des charges administratives importantes et participèrent glorieusement à la guerre de 1914-1918.
Des ruines romaines dans le Square
Aïn-Beïda et ses environs
On ne peut naturellement pas séparer Aïn-Beïda de ses environs. Tout d'abord, édifiée sur un monticule à l'est, surplombant le village et dominant la plaine, une tour carrée de pierre flanquée de deux tourelles métalliques. C'était la première chose que l'on apercevait en venant de l'ouest. Elle avait perdu depuis longtemps toute fonction, mais restait là comme une espèce de symbole de l'origine militaire du village. On l'appelait le fortin mais dans les documents anciens, on le désigne sous le vocable de petit bordj.
Le village était entouré de plusieurs centres urbains. Les premiers, sur l'axe ouest-est : Canrobert, le chef-lieu de la commune mixte d'Oum-el-Bouaghi, à 27 kilomètres, et La Meskiana à 37 kilomètres; les seconds, les villages importants de Tébessa à l'est, Khenchela au sud et Sédrata au nord. Tous lui étaient reliés par la route, à l'exception du dernier qui l’était aussi par la voie ferrée.
L'activité économique d'Aïn-Beïda reposait essentiellement sur l'agriculture céréalière et sur l'élevage de moutons, exercés sur des terres rassemblées autour de petites agglomérations, de douars et de fermes de colons. Il s'agissait d'Ain-Babouche, de Ksar-Sbahi, de Berriche-Jean Rigal, d'Oued-Nini, d'Oulmen, de Medfoun et d' Ourkis.
Un grand marché hebdomadaire se tenait le lundi matin. Il provoquait un important rassemblement de gens et de bêtes. La réputation de l'élevage régional avait largement dépassé les limites du département de Constantine. Elle entraînait la venue de maquignons, kabyles en particulier, qui négociaient l’achat de bétail pour la consommation des autres régions et pour l'exportation.
D'autres marchés se tenaient à Canrobert, le mardi, et à La Meskiana, le mercredi. On y retrouvait les habitués du marché d'Aïn-Beïda, poursuivant ou entreprenant des transactions commerciales.
La situation géographique du village le prédisposait à orienter son activité vers le nord, en direction de Bône, par les voies naturelles constituées par les vallées des oueds. Il s'agissait de l'Oued-Cherf et de ses ramifications nombreuses, souvent à sec, et de l'Oued Meskiana, plus généreux se déversant dans le Mellègue, affluent de la Médjerda. On sait que dans tout le Maghreb, les oueds, en l’absence de pistes, constituent des axes de communication, en particulier pendant les longues périodes de sécheresse.
L'influence des hommes politiques de Bône s'est longtemps exercée sur Aïn-Beïda jusqu'après la Grande-Guerre. C'est eux qui assuraient sa représentation au Conseil Général.
Sur leur initiative avait été élaboré un projet d'établissement d'une voie ferrée vers Bône rejoignant la ligne Bône-Guelma-Constantine au niveau d'Aïn-Abid ou d'Oued-Zénati. Malheureusement, ce projet est resté lettre morte, l'influence des politiciens constantinois et philippevillois ayant été déterminante en faveur d'une liaison à voie étroite avec Ouled-Rahmoun sur la ligne Alger-Constantine.
Une extension vers Khenchela et Tébessa consolida cette orientation. La conception même de ce réseau secondaire, à voie étroite, en condamnait d'avance le développement. Ce n'est que lorsque l'on exploitera les minerais de fer de l'Ouenza et ceux de phosphates du Kouif, que seront rétablis, fort à propos, les rapports de Bône avec l'hinterland de l'est constantinois. La construction d'une voie ferrée directe Bône-Tébessa sera alors réalisée. Elle confirmera l'exclusion d'Aïn-Beïda.
L'absence de moyens de communication modernes résultant de décisions irrationnelles a condamné au sous-développement toute la région des Haracta qui disposait pourtant d'atouts agricoles importants.
Structure de la ville
Aïn-Beïda avait une structure militaire classique résultant de sa création par l'Armée : larges boulevards de ceinture orientés aux quatre points cardinaux, et quadrillage en rues se coupant à angles droits. De vastes espaces avaient été laissés libres afin de permettre l'aménagement ultérieur des infrastructures nécessaires à l'administration et à la vie de la communauté.
La consultation de documents d'archives de cette époque montre que le site comportait au sud l'Oued Aïn-Beïda, avec un fossé d'irrigation dit Oued Séguia, situé parallèlement à la rue des Jardins et une voie d'eau vers l'intérieur du village, où sera aménagée plus tard la rue Solférino.
Je garde bien le souvenir de crues après orage dans cette rue et au niveau de la rue des Jardins, attestant la modification forcée du cours de ces eaux. Selon les Anciens en 1914 une tornade a détruit tous les peupliers qui bordaient la rue et son fossé.
Les archives précisent les attributions des lots d'urbanisation. Elles privilégient largement la population algérienne définissant dès l'origine, le caractère du village qui fera toujours cohabiter les différentes communautés, excluant toute forme particulière de type "village de colonisation" regroupant essentiellement des Européens et maintenant les Algériens en périphérie.
La superficie du village était de 2.500 hectares et la population a varié de 7.500 Algériens et 650 Européens en 1900, à 8.500 Algériens et 1.400 Européens et Juifs en 1940. La population européenne diminuera inexorablement après cette date, tandis que la population algérienne doublera
Les rues reçurent des noms de baptême évoquant les épisodes de l'histoire du Second Empire: Magenta, Montebello, Solferino, faisant référence aux centres urbains vers lesquels elles s'orientaient: Constantine, Canrobert, Khenchela, Batna, Souk-Ahras, Tébessa. D'autres portèrent des noms divers: des Caïds, Saint-Ange (!), interdite aux enfants bien élevés, où se trouvait la maison close, et Saint-Athanase le berbère.
Les boulevards de ceinture furent appelés par leur nom cardinal : Nord, Est, Sud et Ouest. Dans la conversation courante on désignait plus volontiers, une rue par ce qui la caractérisait: la Poste, la Mairie ou tel marchand particulier.
Lorsque j'ai voulu retrouver le plan du village, en l'absence de document graphique, je me suis servi d'une photographie aérienne de 1960, que j'ai interprétée grâce à mes connaissances professionnelles et bien sûr, mes souvenirs. J'ai dû faire abstraction des nouveautés qui y figuraient et qui m'étaient totalement étrangères.
Les routes du village venant des différentes agglomérations environnantes se raccordaient au carré central urbanisé.
Au nord-ouest. La route de Constantine via Bir-Rouga et Canrobert, passait en bordure d'un petit bois de pins, puis longeait la Gare et pénétrait dans le village après avoir traversé un passage à niveau sur la voie ferrée vers Khenchela.
Au nord-est, la route de Sédrata via Berriche débouchait entre le Marché aux bestiaux et un abreuvoir.
Au sud-est, la route de Tébessa via Aïn-Sédjra et La Meskiana, commençait le long des installations d'une première caserne mitoyenne de l'hôpital militaire. Elle laissait sur sa gauche le grand bordj dressé derrière le Square. Elle passait ensuite entre des logements de sous-officiers prolongeant la caserne, et le "pénitencier" (évoqué par Albert Londres dans son livre « Dante n’avait rien vu »), ainsi baptisé car c'était là que stationnait dans les années vingt, une compagnie disciplinaire de "Bat'd'Af" (les Joyeux). Peu avant la guerre, une unité du glorieux 3è Régiment de Tirailleurs Algériens occupa ces locaux.
Cette route passait devant le captage de la source d'Aïn-Beïda ¨K’bira, qui a déterminé l'établissement du village. Sept ou huit cents mètres plus loin et à droite, s'embranchait une piste conduisant à Oulmen distant de six kilomètres, où se trouvaient une jolie petite rivière plantée de peupliers, une ferme et quelques habitations algériennes. C'était un lieu de promenade traditionnel pour les lundis de Pâques et de Pentecôte.
À quelques centaines de mètres se trouvaient de part et d'autre de la route le cimetière européen et le cimetière mozabite.
Enfin, au sud-ouest commençait la route de Khenchela qui passait devant le Stade "Chiarini", sur la gauche et se rapprochait de la voie ferrée puis traversait une dépression très vaste : le Garâa-Et-Tarf, recélant d'importants gisements de sel en bordure des fermes d'Oued Nini. C’est le lieu mythique où, lors de la première invasion du Maghreb, la Kahena et ses guerriers berbères Djeraoua et Aouraba écrasèrent les Arabes aux ordres de Hassan ibn Nouman el Ghassani, puis les repoussèrent jusqu’aux confins de la Lybie.
Pour compléter la description de la structure d'Aïn-Beïda, il faut indiquer la situation des places et du Square sur de vastes espaces établis dès l'origine, en réserve foncière, au milieu des lots attribués aux différents pétitionnaires.
Certains d'entre eux ont été ainsi agréablement aménagés. Le premier en un vaste jardin communément appelé le Square, et un cours planté de platanes et de verniers du Japon, baptisé cours Magenta, comme le boulevard qui le bordait bien qu’une plaque fixée sur un des piliers en pierres de taille de la grille portât la mention de "Cours Charles Willigens", du nom du pharmacien qui avait été maire du village vers 1920, et dont le fils Pierre, médecin de colonisation fut maire à son tour dans les années trente.
La seconde place baptisée "Montebello" à l'origine, fut partagée par la rue du même nom et reçut d'un côté de cette rue, le Marché aux légumes, l'Eglise et le kiosque à musique, et de l'autre la Salle des Fêtes et la Poste.
Flanquant le boulevard du nord, un vaste espace était planté d’immenses pins et appelé "la Pépinère" ou "Square Blanchard" par les seuls Anciens.
Enfin sur le boulevard du sud, un large espace accueillait le Monument aux Morts de la Guerre de 1914-1918 entouré d’un jardinet la Mosquée.
L'église
Aïn-Beïda, commune et chef-lieu de canton
Le site a été initialement établi comme un chef-lieu de cercle militaire et au bout de quelques le village a été organisé en commune dite de plein exercice et chef-lieu de canton. En conséquence, cela a entraîné la construction d'une Mairie, d'un "Palais" de Justice de paix, d'une Gendarmerie et naturellement d'écoles.
La Mairie, située rue de Batna, était un bâtiment à un étage dont un coin abritait le Commissariat de Police.
Durant la période d'avant-guerre, de la guerre et d'après 1945, ont été maire: M. Charles Willigens dont la pharmacie faisait l'angle du boulevard Magenta et de la rue Montebello, le Docteur Pierre Willigens, M. Zedda, le Docteur Boumali, premier maire musulman d'Algérie, M. Dokhan et le Docteur Dragacci.
Le Commissariat de Police était confiné dans un espace réduit. Son personnel était de statut municipal, à l'exception du commissaire qui relevait de la Police Nationale. Je n'ai gardé le souvenir que d'un seul commissaire en fonction vers 1943. Il portait un patronyme corse, et en cette période où le zèle politique était à la mode, tout lui était bon pour plaire aux maîtres du temps. Il disparut comme il était arrivé, dans l'indifférence générale.
La Justice de Paix, dans la rue portant tout naturellement son nom ne méritait pas l'appellation de Palais et rien ne la distinguait des maisons voisines très banales et sans étage.
Les seules personnes qui y ont officié dont j'ai gardé le souvenir sont : le Juge Swiney, le greffier Fourment dont le fils René revint après la guerre, comme vétérinaire du Service de l’élevage et le Cadi Bensaci.
La Gendarmerie, rue Nationale était flanquée d'une tour avec des meurtrières. Elle abritait les logements de fonction et aussi ... la Prison.
Je n'ai conservé l'image que d'un seul gendarme Algérien à la stature imposante et à la tenue toujours impeccable. Quant aux Chefs-Gardiens de prison successifs, des
Corses, Messieurs Gabrielli et Pinelli. Leur bonhomie faisait que les rares emprisonnés n'étaient pas trop malheureux de leur sort.
L'Eglise était située dans la rue Montebello, entre le marché et la place où se trouvait le kiosque à musique. Le curé résidait au Presbytère tout proche, au coin de la rue de l'Eglise, en face de la Mairie. Il y disposait d'un petit jardin et dans sa cave, s’ouvrait l'entrée d'un souterrain effondré, dont mon imagination d'enfant fixait l'aboutissement au fortin, sans que rien ne pût le confirmer.
Je n'ai connu que deux curés. Le premier qui nous fit faire notre première communion en 1939,1'abbé Rigal, à l'aspect austère mais d'une grande bonté. Son enseignement du catéchisme était accompagné de projections d'images fixes, représentant des scènes religieuses empruntées aux Grands-maîtres de la peinture, et aux sculptures des cathédrales. Il pratiqua l'audio-visuel avant l'heure.
Le second, l'abbé Manéglier, était un personnage haut en couleurs, exerçant son ministère sans trop d'embarras. Avec lui, la conversation ne se limitait pas à l'ordre religieux, et il était aussi, en avance sur son temps.
La mairie
La maison du curé à droite
La mosquée, située sur le boulevard du sud, près du Monument aux Morts, était entourée d'un vaste espace qui demeurera longtemps vacant. Son esthétique était séduisante et le dépouillement de sa décoration intérieure était impressionnant.
Il y avait aussi une Synagogue, incluse dans un pâté de maisons, rue de Tébessa. Elle était intérieurement de bonnes dimensions, mais se caractérisait au dehors, par une grande discrétion. M.Henri Namia, personnalité unanimement respectée, était le président du Consistoire israélite.
Les infrastructures publiques étaient assez réduites. Elles se limitaient à peu d'équipements : un Marché couvert, une Salle des fêtes et un Stade.
Le Marché couvert assez original, fait de murs en briques, et ses quatre coins étaient surmontés d’une coupole. On en devait la réalisation à l'architecte d'alors M. Murienne, ce qu'une plaque commémorait. Très fréquenté avant la seconde guerre, son activité déclina considérablement ensuite, avec la prolifération dans tout le village de marchands de légumes et de bouchers en tous genres.
La Salle des fêtes, construite au début des années trente, était de style néo-classique (!), avec un nombre important de marches sur sa façade. Franchie la porte à larges battants, on se trouvait en face de deux escaliers à révolution munis de rampes en fer forgé d'un très bel effet, permettant d'accéder au balcon de la salle proprement dite et au fumoir. Le parterre se découvrait après une large porte située sous les escaliers. Par les côtés, on gagnait les coulisses et une scène aux belles proportions.
Le parterre et le balcon étaient équipés de rangs de sièges de bois relevables. Lorsque l'on voulait donner un bal, les sièges étaient retirés dégageant une salle de grandes dimensions.
Le Stade avait été baptisé du nom de son concepteur, M. Chiarini, conducteur de travaux aux Ponts et Chaussées. Situé sur la route de Khenchela, une vaste enceinte englobait un terrain de football revêtu de tuf, bordé d'une rampe métallique et un court de tennis flanqué d'un "mur" d'entraînement et d'un petit bâtiment abritant des équipements. C'était en fait sommaire mais suffisant pour que les joueurs du village, regroupés au sein de la Jeunesse Sportive Aïn-Beïdéenne, se taillent une belle réputation dans diverses compétitions départementales.
Une Brigade Mobile de la Sûreté Nationale fut créée vers 1930. Elle s'installa dans un immeuble que M. Zedda avait fait construire en mitoyenneté avec notre maison.
Les Commissaires successifs en furent des Corses : M. Flori, jovial et subtil, M. Colonna, arabisant exceptionnel, connaissant tous les rouages de l'Administration, possédant un esprit de finesse qui en faisait un grand policier. Quant au troisième, Corse aussi et originaire de Bône, sa fatuité en faisait un personnage peu sympathique, provocateur, sûr de lui et dominateur.
Une activité administrative surprenait par le nombre de ses fonctionnaires : c'était les opérations cadastrales effectuées par des "Commissaires enquêteurs de la propriété foncière". Ils parcouraient le bled, afin d'établir des relevés pour délimiter les propriétés. Leur intervention était déterminante dans les conflits entre fellahs. Parmi eux, se trouvait Antoine Benigni qui voulut bien prendre sur ses loisirs pour me faire travailler, pendant les vacances, le Latin et les Mathématiques. Hélas ! Par pudeur, je n'ai pas su lui dire toute la reconnaissance affectueuse que je lui en gardais.
Mosquée
Léglise
Marché
Le village fut électrifié assez tôt, grâce à une petite usine installée boulevard du Nord. Longtemps, le courant fut distribué avec bien des vicissitudes, puis vint le raccordement à une production départementale plus régulière.
Ce qui caractérisait Aïn-Beïda, en plus de son climat rigoureux mais sain, c'était la qualité de son eau, fraîche et abondante, tout au moins jusqu'au début des années trente. Elle était distribuée dans tout le village, et l'on trouvait sur les trottoirs de nombreuses fontaines publiques de fonte verte, disposant à leur sommet, d'une roue horizontale à manivelle qui permettait de pomper l'eau à la demande, mais aussi, d'en limiter l'écoulement.
Hélas! Avec l'accroissement de la population, les gaspillages et la sécheresse, l'eau se fit très rare, et l'alimentation en fut retreinte par des coupures quotidiennes. Il fallait constituer de petites réserves, dans divers récipients, et guetter le moment où le fontainier venait rouvrir la vanne qui en rétablissait la distribution.
Mais, c'était la meilleure eau du monde…
Abreuvoir sur le boulevard Magenta Nord vers 1905
L'École de la République
"Autrefois notre pays s'appelait la Gaule, et ses habitants s'appelaient les Gaulois ... Les Gaulois habitaient des maisons faites avec de la terre, et couvertes en paille. Ces maisons n'avaient qu'une porte, et pas de fenêtres.... Vous n'aimeriez pas (y) habiter... L'image (montre) un Gaulois ... sa moustache est très longue ... il est habillé d'un manteau agrafé sur l'épaule ... Si vous rencontriez un homme comme celui-là dans la rue, vous seriez bien étonnés. " (Histoire de France d'Ernest Lavisse, édition de 1935, chapitre 1er)." La France veut que les petits Arabes soient aussi bien instruits que les petits Français. Cela prouve que notre France est bonne, et généreuse …
Je ne résiste pas à l'envie de rappeler ces phrases, que nous apprenions par cœur. Nos ancêtres les Gaulois : à combien d'entre nous cela s'appliquait-il ? Ces maisons de terre, c'étaient celles qui se trouvaient dans la campagne -les douars- à l'entour. Les habitants étaient semblables aux gens que l'on côtoyait en ville, en particulier, le jour du marché, c'étaient sans doute les parents de nos condisciples auxquels on faisait apprendre les leçons de M. Lavisse.
Nous vivions dans un système social que personne ne semblait vouloir remettre en cause. "La France a le droit d'être fière de ses conquêtes"(op.cit. ch.22). Nous, nous étions fiers de la France ! Le creuset dans lequel se formaient nos cerveaux était la belle école laïque de la Troisième République, aux maîtres le plus souvent remarquables par leur côté missionnaire : faire des citoyens à partir d'enfants de tous les milieux, et ici de toutes origines.
Il y avait à Aïn-Beïda, une école maternelle avec deux classes, située à l'angle de la rue de Tébessa, où se trouvait l'entrée et du boulevard du sud. C'est là que certains enfants, filles et garçons, découvraient l'univers scolaire. J'ai beaucoup rechigné à m'y laisser conduire bien que la directrice en fût Suzanne Bonduelle, la sœur de ma mère.
La seconde classe était confiée à Madame Chamson. La personnalité la plus marquante de ce lieu privilégié était Mademoiselle Françoise, qui veillait sur tout ce petit monde à la rentrée et à la sortie, aux récréations, et à chaque instant critique de la journée. Ce fut pour des générations de petits, une véritable seconde maman, loin de la maison, au moment où la première ne pouvait les assister et les consoler des petites misères quotidiennes ...
J'ai toujours regretté de ne pas avoir, plus tard, surmonté ma pudeur (encore elle !) pour lui dire combien elle nous avait été précieuse.
Outre cette petite école à l'effectif réduit, il y avait trois autres établissements scolaires.
L'École des garçons, de style mauresque, avec une espèce de coupole, située sur le boulevard Magenta, encadrée par la rue des Caïds et la rue Nationale.
Elle comprenait les quatre classes, du cours préparatoire au cours moyen deuxième année, et les deux classes mixtes du cours complémentaire, qui permettait aux détenteurs du certificat d'études d'accéder au brevet élémentaire. Elle disposait d’un atelier d'enseignement pratique, en ferronnerie et en ébénisterie, installé au bout d'un préau, son accès était interdit aux autres élèves, et son domaine réservé m'a toujours intrigué.
Ecole des filles
Ecole de garçons
Ecole des indigènes
Les directeurs que j'y ai connus, furent Messieurs Boesser, Millet et Foulène. Les institutrices Mesdames Boesser et Millet, et les instituteurs Messieurs Carré, Casanova et mon maître Ninou Lagana.
Les élèves qui fréquentaient cette école, étaient aussi bien des Européens que des Juifs ou des Algériens. J'avoue ne jamais avoir su quels étaient les critères permettant à ces derniers d'y être inscrits, puisqu'il existait par ailleurs, une Ecole des garçons "indigènes".
Cette dernière était située sur le boulevard de l'ouest. Elle comprenait onze classes et un enseignement technique plus important que celui de l'autre école. Les maîtres étaient particulièrement sélectionnés, en raison du fait que les élèves n'étaient pas francophones. Les résultats étaient exceptionnels, et nombre de futurs enseignants y furent formés jusqu'au certificat d'études, avant de rejoindre le cours complémentaire puis l'Ecole normale. Les directeurs en furent MM. Finaltéri, Bouzaher et Daoudi.
La troisième grande école était celle des filles, située rue de Batna, séparée de la Mairie par la rue des Ecoles. Elle recevait des élèves de toutes origines, jusqu'au certificat d'études. Avant la Guerre de 39-45, les directrices en furent Madame Siacci puis Mademoiselle Bonduelle, et enfin, jusqu'à l'indépendance, Mademoiselle Lucchini qui marqua de son empreinte plusieurs générations de filles.
L'école communale rassemblait donc les enfants du village, pendant la très longue période du mois d'octobre aux premiers jours de juillet.
Elle avait l'avantage d'être le lieu de rencontre idéal des différentes communautés, mais aussi, servait-elle à mélanger les élèves des différents quartiers, car les enfants avaient tendance à rester dans leur "coin", sous les yeux des mères qui, en général n’exerçaient pas de profession et pouvaient ainsi surveiller aisément leur progéniture.
L'atmosphère des classes était studieuse. Les manquements à la discipline assez stricte étaient peu fréquents, et personne ne contestait l'autorité des maîtres. Les parents algériens étaient particulièrement attentifs au comportement de leurs enfants scolarisés.
Si un instituteur les convoquait pour leur faire part de mauvais résultats ou d’actes d’indiscipline, ils sanctionnaient derechef publiquement, leur rejeton, à l'aide de la canne traditionnelle, le debouz, qui ne les quittait jamais. On comprend que les instituteurs hésitaient avant d'en référer aux parents algériens.
La population scolaire vivait dans une fraternité totale. Dans le village, la notion de classe sociale n'avait pas cours. C'était une des données de l'époque. Heureuse période où les biens matériels étaient réduits et tout naturellement, les enfants n’affichaient pas de signes extérieurs notables. Ils portaient le même tablier noir. Les cartables étaient de fabrication locale, et duraient d'année en année. Règles, porteplumes et cahiers étaient semblables. Les livres achetés d'occasion servaient indéfiniment. Les indigents recevaient de la commune le nécessaire pour l'année scolaire. Les besoins étaient simples. Personne ne louchait sur les fournitures du voisin, qui étaient les mêmes que les siennes. Toute comparaison avec son voisin était ainsi inutile, car sans objet.
Les enfants pauvres étaient cependant souvent chaussés de godillots cloutés, tandis que les autres portaient des chaussures plus fines. Mais ma mère me fit le plus beau cadeau du monde, en se décidant à m'acheter une telle paire de souliers inusables.
On a du mal à se représenter aujourd'hui une telle situation .C'était ainsi et point n'est besoin d'idéaliser. La vie était plus dure pour certains que pour d'autres, mais aucune "richesse" matérielle ne s'étalait.
La chance que nous avons eue d'aller en classe à cette époque, à Aïn-Beïda, a tenu essentiellement à la qualité de nos instituteurs. Le souvenir de la méthode de mon maître Ninou Lagana restera toujours gravé dans ma mémoire. Ce n'était pas seulement un enseignant, c'était un éducateur, un formateur qui nous donnait le goût du savoir, l'envie de découvrir par la lecture, d'ouvrir et d'affiner notre esprit.
Un tel maître ne limitait pas son enseignement au programme officiel : il nous faisait aimer ce qui était beau et noble ...
Le travail s'accomplissait dans la joie. Chaque classe débutait et se terminait par un chant. Lorsque l'on avait bien travaillé, il nous lisait une histoire dans laquelle les vertus fondamentales de l'homme étaient exaltées. Nous en sortions grandis et heureux.
Jeux de récréation
La cour de récréation était pour les enfants, un lieu favorable pour montrer leurs talents extra scolaires. C'était l'endroit idéal pour se valoriser aux yeux des camarades. Les petits algériens, souvent plus aptes aux exercices physiques, profitaient de ces moments pour acquérir du prestige aux yeux de leurs condisciples.
La part des jeux était grande dans notre vie scolaire. Dès que la cloche sonnait, nous gagnions en rangs serrés la cour de récréation. Un tri s'effectuait instantanément, d'une part, il y avait ceux qui inlassablement, jour après jour, tapaient dans une pelote de chiffons et d'autre part, ceux qui variaient leurs activités, selon les jours et les saisons.
Certains de ces jeux étaient sans équivalents ailleurs. C'était d'abord "les noyaux" qui comportaient deux variantes. On utilisait des noyaux d'abricot, qui prenaient une valeur importante pendant la saison, et étaient dévalués dès qu’elle était passée. Dans la première, des tas de quatre noyaux étaient édifiés, et l'adversaire devait tenter de les toucher, à bonne distance avec un autre noyau. S'il y arrivait, il ramassait les quatre noyaux, et tous les noyaux inefficaces étaient gagnés par l'autre. La seconde était dite de "la baraque" : un enfant, le "banquier", prenait une feuille de carton dans laquelle il perçait des trous de différentes tailles, ressemblant aux portes et aux fenêtres d'une maison. Chaque ouverture était affectée d'une valeur, le joueur mis à bonne distance, "tirait" des noyaux en direction de la baraque, et s'il réussissait à les faire entrer dans les trous, il percevait un nombre de noyaux correspondant au chiffre affiché.
Chaque "banquier" s'efforçait de trouver le meilleur compromis entre l'attrait de son dispositif, et la difficulté de gain qu'il présentait. L'annonce par l'expression : "J'ai fait faillite", suffisait à interrompre le jeu, et à ouvrir les négociations devant permettre de solder les dettes. Mais le failli n'avait pas le droit de rouvrir sa baraque pendant le reste de la récréation, sous peine de se voir menacé de se faire "attraper à la sortie".
Le jeu de billes se pratiquait "au pot" ou "à la tête", comme partout ailleurs. Il y avait aussi le jeu du "camp", connu sous le nom "des gendarmes et des voleurs", dans lequel la phase de l'investissement par les voleurs, pour tenter de libérer les prisonniers, permettait de se défouler dans des braillements et une bousculade généralisée. Le développement du cinéma américain entraîna la transformation de ce jeu en celui des
"Cow-boys", dans lequel ces derniers remplacèrent les gendarmes, tandis que les voleurs devenaient les Indiens ou plus généralement les "bandits".
C'est Cassidy qui eut les faveurs des élèves jusqu'à l'arrivée de "Tomix"et Zorro, que l'on pouvait rencontrer accompagnés de Tarzan et du "Fantôme du Bengale", tout juste échappés des journaux illustrés.
Le roi des jeux restait le "fodbal". Les buts étaient figurés par deux tas de vêtements. On procédait à la constitution des équipes en faisant "les tocs", espèce de "poire" au rituel mystérieux, ressemblant au jeu de la "mora", afin de désigner le camp de chaque équipe. Le démon du dribble s'emparait alors, des joueurs dont l'adresse était souvent prodigieuse. Les petits Algériens retiraient leurs chaussures, et animaient le petit corps inerte de chiffon. L'individualisme était roi, et seule la cloche mettait fin aux exploits, dont on parlerait abondamment jusqu'à la récréation suivante.
Un jeu alternatif était pratiqué avec à la place de la balle, une pièce de monnaie trouée, dans laquelle on enfilait un morceau de papier frangé, qui freinait la pièce dans sa chute, lorsqu'on avait shooté dedans pour l'envoyer en l'air. Il ne fallait pas que la pièce touchât le sol pendant les échanges entre les joueurs, qui devaient finalement, tenter de marquer un but. Seul le gardien de but avait le droit de dégager sa "cage" avec les mains, comme au football.
La consécration de l'année scolaire était pour les candidats, la réussite au Certificat d'études ou au Brevet élémentaire. Cela constituait pour la majorité, la fin des études. Une minorité d'élèves plus doués, plus aisés ou bénéficiant d'une bourse, pouvaient aller faire des études secondaires à l'Ecole Primaire Supérieur, au Collège ou au Lycée à Constantine.
Les premiers exerceraient dans le village la même activité professionnelle que leur père ou un proche, ou bien seraient mis en apprentissage chez quelque artisan. Personne ne pouvait se permettre de rester oisif.
La fin des classes ne donnait pas lieu à des cérémonies particulières, comme la remise des prix. Il n'y avait pas de kermesse des écoles. On se quittait tout simplement, avec la certitude que l'on retrouverait les mêmes copains à la rentrée des classes. De toute façon, personne ne partant en vacances loin du village, les mêmes relations amicales se poursuivaient durant l'été, et les quelques fêtes de la saison offraient l'occasion de rencontrer les enfants qui restaient dans des quartiers où l'on n'allait que rarement.
Après l'école
Filles et garçons occupaient la rue aux heures de sortie des classes, dans un vacarme qui en disait long sur l'effort imposé durant de longues heures, par l'obligation d'immobilité, de silence et d'attention. Les enfants n'avaient pas à craindre la circulation des véhicules, qui était peu importante et lente. Les garçons venaient s'attrouper face à la vitrine de l'horloger M.Morio. Elle exerçait sur eux une véritable fascination, les montres étant considérées comme des objets de luxe, et les réveils comme de véritables jouets animés.
Mais le magasin qui attirait le plus de monde était une minuscule boutique sur le boulevard Magenta, jouxtant le marchand de beignets qui faisait le coin de la rue Montebello.
Sa vitrine recélait des trésors de couleurs, comme seul on sait en étaler en Afrique. Les friandises étaient vertes, jaunes caca d'oie, violettes, roses de toutes les nuances, rouges et surtout bariolées. Pour mieux voir, les petits Algériens, plaquaient leurs fronts contre la vitrine, y appliquaient leurs lèvres dans un simulacre de dégustation, ou faisaient mine d'attraper une sucrerie.
Les jours de canicule, par la porte entr'ouverte, s'échappaient des senteurs de fleur d'oranger, de vanille et de jasmin. Ceux qui disposaient de quelques sous de bronze pouvaient accéder au saint des saints. Le marchand trônait en ce lieu magique, sur une chaise haute, tenant à la main un chasse-mouches fait d'une queue de vache, mâchonnant éternellement un bâton de bois de réglisse, et prêtant la plus extrême attention aux envahisseurs escortant l'unique acheteur probable.
Les enfants convoitaient les paquets de "Chicklet" qui, avant le chewing-gum, commençaient à détrôner la glu naturelle récupérée sur l'écorce des résineux. Ils louchaient aussi sur les tubes de "cocomanie", poudre miracle au goût d'anis qui se buvait diluée dans de l'eau et étanchait parfois la soif.
L’acheteur différait au maximum sa décision, et prenait de grands airs importants, comme s’il s’agissait de négocier l’achat d’un âne au marché du lundi. Le boutiquier ne faisait rien pour presser l’achat, sa patience n’avait d’égale que sa gentillesse. Affaire faite, l’acheteur se précipitait dehors, escorté par toute une cour espérant bien obtenir quelque part de friandise sucrée.
Le maître des lieux reprenait alors sa place de Calife, au milieu de ses rouleaux de réglisse enserrant une perle de couleur, ses rahat-loukoums pastels et ses caramels guettés par les mouches, que les bandes de papiers collants pendant au plafond, n'avaient pas encore piégées.
La rue offrait d'autres tentations. En été, les marchands de figues de Barbarie occupaient sur le bord des trottoirs, des emplacements stratégiques. Leur installation se composait de deux planches assemblées par des traverses, portant quatre vieux roulements à billes en guise de roues. Sur ce plateau s'amoncelait un tas de figues jaune et vert, à la peau hérissée de fines aiguilles. Activée par la chaleur, une bonne odeur se répandait à l'entour.
Le petit marchand rameutait le chaland en poussant, à intervalles réguliers : "Indi... Indi!". Lorsqu'un acheteur se présentait, le vendeur prenait délicatement un fruit dans une main, puis, avec un couteau appelé "douk-douk", coupant comme un rasoir, en ôtait adroitement la peau, libérant ainsi la partie consommable. Le client pouvait savourer ce fruit juteux mais, interdit par nos mères, qui craignaient la constipation provoquée par les nombreuses graines indigestes que renfermait leur chair.
Sur le bord des trottoirs, s'installaient aussi des marchands de dattes sèches, présentant l'avantage de pouvoir être mises dans les poches de nos culottes sans qu’elles ne collent. Elles pouvaient ainsi, être consommées discrètement en classe, si une petite faim gourmande se manifestait. Les vendeurs mesuraient l'achat à l'aide d'une petite boîte métallique, et le livrait en versant les fruits dans un cornet de papier journal, on n'était pas très regardant sur l'hygiène.
D'autres marchands poussaient des petites carrioles, dont le plateau était composé de cases, dans lesquelles ils proposaient divers amuse-gueules séchés et salés, des bliblis (pois chiches), des tramousses(graines de lupin), et des glibettes (graines de courge). A la saison, ils vendaient aussi des jujubes et de minuscules pommettes.
Au sortir de l'école, entre filles et garçons, on s'évitait tout en se regardant du coin de l'œil, en baissant un peu la tête. De temps en temps, plus audacieux ou défié par quelque pari, un garçon se précipitait vers un groupe de filles, pour saisir à pleine main, et tirer la natte de cheveux noués d'un long ruban de l'une d'entre elles. Son méfait commis, il disparaissait en courant, mettant du champ entre la "victime" et lui, redoutant qu'un frère ou un cousin ne le poursuivît et vengeât l'agression par quelques coups de poing. Chacun était peu disposé à voir un membre de sa famille chahuté par des garnements, surtout s'il s'agissait de filles.
Les filles algériennes n'allaient à l'école que jusqu'à leur puberté. Scolarisées plus tard, elles arrivaient ainsi rarement, au certificat d'études, ce qui constituera longtemps, un handicap à l'évolution de la société algérienne, et bloquera les relations entre les communautés. Elles étaient dès lors, recluses et souvent mariées, ce qui coupait les liens avec les autres filles, qui poursuivaient leur scolarité. Seules pouvaient continuer de se voir les filles qui habitaient dans des maisons, où résidaient des familles de différentes communautés, disposant de cours intérieures facilitant les relations entre les femmes, pendant les heures où les hommes étaient au dehors.
Tout homme annonçait son intention d'entrer par des coups frappés à la porte, et prononçait le sésame rituel : "trig"(le chemin). Chacune pouvait alors s'esquiver, la coutume étant sauve.
Seuls les garçons algériens avaient une connaissance exacte du mode de vie de leur communauté. En effet, lorsque des Européens ou des Juifs étaient reçus chez eux, ils ne voyaient que quelques vieilles femmes, qui vaquaient aux travaux domestiques. Ils n'avaient ainsi, que rarement, des contacts avec la mère de famille ou une femme jeune.
Quant aux femmes rencontrées dans la rue, elles protégeaient leur anonymat sous des voiles noirs qui les enveloppaient presque totalement, seul un œil découvert leur permettait de suivre leur chemin.
Le boulevard Magenta
Les devoirs terminés, nous avions la possibilité de jouer entre camarades de classe ou bien avec quelques enfants, filles et garçons connus de nos parents comme étant suffisamment sages pour ne pas nous entraîner à faire trop de bêtises.
Pour moi, le choix était aisé. Il y avait d'une part, mes "frères" Alain Audibert et Seghir Benbouzid, et d'autre part, mes condisciples, les deux Yves, Ichaï et Amram, ainsi que Kholadi, élèves doués et studieux qui m'apprirent la tolérance et me donnèrent le goût de la compétition scolaire.
Les adultes ayant toujours un œil sur les gamins, même s'ils n'étaient pas de leur famille, nous prenions beaucoup de précautions, avant de nous engager dans des expéditions non permises ou par trop innovantes.
Nous avions bien sûr le champ libre sur le Cours, mais aussi tout à côté, dans le Square, dont la végétation aurait pu cacher nos exploits, sans la présence vigilante du père Alba. Celui-ci, soucieux du bon ordonnancement de ses parterres de fleurs, guettait nos allées et venues, et brandissait son râteau à la moindre incartade.
Il y avait dans ce jardin, un bassin rond entouré d'une grille, qui contenait quelques petits poissons rouges, tournant sans fin, mais que nous respections, car c'était à peu près les seuls que nous puissions voir à des kilomètres à la ronde.
L'un des pins immenses portait un magnifique nid de cigognes, dans lequel on voyait depuis le premier jour du printemps, jusqu'à l'automne, le couple de parents préparer la naissance des petits et leurs premiers envols. L'arrivée des cigognes était un évènement. Entendre la première claqueter était le signal de la venue du beau temps.
Partout, des restes de la présence romaine, de magnifiques colonnes dont les socles portant des inscriptions nous faisant rêver, côtoyaient des sarcophages de pierre, dont le volume nous permettait de nous cacher durant nos jeux. Ceux-ci se poursuivaient souvent, dans notre maison, qui disposait de deux cours, d'une grande terrasse et de longs couloirs, où il était possible de se cacher et de cavaler sans fin.
Mais aussi, nous avions l'insigne avantage du spectacle de la rue principale du village, qui suffisait souvent à nous divertir, pendant de longues heures.
A la belle saison, la chaleur poussait les habitants hors des maisons, et assis en compagnie de Paule Soual, sur la pierre de taille qui servait de seuil à l'entrée de l'Hôtel, nous pouvions observer leur va-et-vient.
De l'autre côté de la rue, il y avait l'arrêt du car "Dokhan" qui desservait La Meskiana. Il stoppait dans un bruit caractéristique d'auto-allumage, tant il avait peiné en surcharge permanente.
Dès que les portières avant et arrière s'ouvraient, des voyageurs enveloppés dans leurs burnous s'en échappaient, pressés de récupérer leur "barda" placé pêle-mêle en entassement sur l'impériale.
Il s'agissait d'impedimenta hétéroclites : volailles, peaux de mouton, paniers de légumes ou de fruits, et bric-à-brac divers destinés à la vente ou au troc.
Tandis que les arrivants rassemblaient leurs bagages, un flot de partants s'impatientaient et tentaient déjà, de prendre d'assaut le véhicule, dont le toit retrouvait une nouvelle charge aussi encombrante et variée que la précédente. Nous avions beau être habitués à ce spectacle, nous étions toujours amusés par ses péripéties renouvelées, et il n'était pas rare qu'un gag se produisît tout à coup, et déclenchât notre penchant pour la moquerie.
Boulevard Magenta vers1923
Le Grand Hôtel d’Orient en 1930
La banque d'Algérie
Dans la rue, c'était souvent, les mêmes personnages qui allaient et venaient, retenant notre attention. Certains suscitaient notre pitié. Tout d'abord, l'homme tronc, un malheureux infirme, se déplaçant sur son séant en s'aidant de ses bras. Il empruntait un itinéraire immuable, semblant ne voir personne, et venant d'on ne sait où. Nous appréhendions de nous en approcher pour lui donner une pièce, tant son air absent nous impressionnait. Quelqu'un lui avait procuré un petit tricycle de handicapé, mais il avait rapidement abandonné ce moyen mécanique pour reprendre son chemin au ras du sol.
Plus folklorique était le personnage de Sassa. C'était un grand gaillard, à la force herculéenne, simple d'esprit mais pacifique. Vêtu, été comme hiver, d'une gandourah blanche, il déambulait, chantant une mélopée sempiternelle, un bras replié à l'horizontale, la main tenant le coude de l'autre bras, dont la main s'appliquait sur la joue. Il semblait ne se préoccuper de personne.
Cependant, lorsque des petits cireurs l'importunaient en criant : "Sassa, montre le garage!", il soulevait le devant de son vêtement, exhibait son anatomie dénudée, et à demi conscient de l'incongruité de son geste, courait derrière les gamins, qui ne demandaient pas leur reste, craignant toujours d'être rattrapés par le colosse.
Sassa avait dû bénéficier de bienfaits de la part de l'ancien notaire du village, Maître Joseph Renucci, compatriote et ami de mon père, qui depuis s'était établi à Constantine. Périodiquement, Sassa venait demander de ses nouvelles à mon père, qui lui remettait quelques francs, en disant que c'était de la part du notaire, auquel le malheureux homme continuait à témoigner par ses bénédictions sa reconnaissance à son bienfaiteur virtuel.
Au coin de rue de Batna, apparaissait quotidiennement, le père Halimi, l'afficheur public. Petit homme vêtu de kaki, portant une casquette à la visière pliée en bec, il battait son tambour de quelques coups en marchant.
Arrivé au milieu de la chaussée, il exécutait plusieurs roulements pour attirer l'attention, et provoquer un rassemblement, poussait un fort "Avis à la population!", et lisait un texte dont l'écho se perdait à partir du second rang de l'attroupement. Sa prestation se terminait par un dernier roulement, et il reprenait son chemin, accompagné de gamins heureux de participer à une telle parade, dont les étapes faisaient le tour du village.
Parfois, passait un groupe de trois cavaliers. Le premier en pointe, sur un cheval blanc à la crinière tressée, et à la longue queue retombant jusqu'aux boulets, était l'Agha Brahim Benbouzid, capitaine de spahis de réserve, et chef du Goum des Haracta. Il portait un burnous rouge, dont le bas était étalé sur la croupe de la monture, ses bottes de cuir en "filali" rubis contrastaient avec la couleur des flancs de son destrier. Les deux autres cavaliers chevauchaient des alezans, et se tenaient en léger retrait. Delacroix et Fromentin auraient savouré comme nous, un tel spectacle ! Le claquement des sabots grandissait, s'imposait puis diminuait, tandis que le trio s'éloignait.
Un petit groupe de jeunes captait notre attention : mimant quelque action de la dernière partie de football, l'un d'eux serrait à deux mains un ballon de cuir, rassemblant des amateurs friands d'explications de la part de "grands matcheurs". Le coin du cours s'animait un instant, au récit des sportifs puis, chacun se tournait vers une autre distraction.
sassa
Le Patriarche Benbouzid et M.Barnavon
Ali Ben Ahmed Benbouzid
par Chasseriau
Chaque jour, à la même heure, le père Faletti, veste de velours sur ceinture de flanelle rouge garance, casquette coquettement penchée sur l'œil, et la canne à la main, arrivait du bout de la rue des jardins, rejoint inévitablement, par le père Gardon, son fidèle compagnon. Il marquait un arrêt de quelques instants, pour échanger des salutations, en patois italique, avec de vieux amis maçons puis, il reprenait sa promenade habituelle.
Alors que le soleil déclinait, un petit peloton de cyclistes surgissait dans le virage de l'Hôpital militaire, le long du Square et déboulait devant nous. Nous avions tout juste le temps, de les reconnaître, tandis que le plus petit d'entre eux tentait de les rattraper; son vélo faisant un petit bruit de "moteur", car il avait fixé sur les fourches, des morceaux de carton flexible, qui pétaradaient en touchant alternativement les rayons des roues.
Parfois, un cortège d’automobiles hétéroclites, parcourait les boulevards dans un grand vacarme de klaxons et de détonations de fusils de chasse, dont la poudre noire fusait en longues flammes…c’était le cortège des invités d’un mariage qui accompagnaient le futur conjoint vers la maison de la mariée.
Quelquefois, une rumeur montait depuis l'extrémité du boulevard, elle s'amplifiait accompagnée du martèlement des pas d'une foule en marche. On distinguait progressivement, la lancinante récitation de versets du Coran, tandis qu'apparaissait un groupe important d'hommes aux vêtements divers, les burnous côtoyant des tenues de travail à l'européenne.
C'était un enterrement musulman. La dépouille mortelle, enfermée dans un linceul, était déposée sur un brancard que six hommes portaient sur leurs épaules. Le groupe marchait d'un pas précipité tout en psalmodiant. A chaque instant, un homme se présentait au niveau de l'un des porteurs et le remplaçait, sans que la marche en fût ralentie, ni que le groupe perdît de sa cohésion.
Les consommateurs, attablés aux terrasses des cafés, se levaient et se découvraient sur le passage du cortège, qui disparaissait ensuite, au fond du Cours. Habitués que nous étions à la lenteur de la longue procession de nos enterrements, la célérité et la cohésion des obsèques musulmanes frappaient notre esprit.
À Aïn-Beïda, la nuit tombait sans être précédée d'un crépuscule.
L'éclairage public était efficace sur le Cours Willigens, mais réduit ailleurs.
C'était le début de la ronde des "asses", ces gardiens qui, toute la nuit, circulaient dans les rues, armés de leur seul "debouz". Ils donnaient une petite poussée sur les portes et portails des maisons, vérifiant que tout était bien clos. Le bruit de leurs pas rassurait, tandis que l'on entendait dans le lointain, les appels des sentinelles des casernes, après que le clairon de l'extinction des feux eût résonné.
Désormais, seuls les aboiements à la lune des chiens se faisaient entendre jusqu'au milieu de la nuit. Le marchand de beignets commençait alors, à pétrir sa pâte, à grands coups sourds.
Au point du jour, le muezzin lançait son appel à la prière de l'aube, que relayait bientôt la cloche de l'Eglise ...
L’Activité économique
L'activité économique d'Ain-Beïda était tributaire de l'agriculture régionale. Le commerce et l'artisanat vivaient donc essentiellement de celle-ci.
Vers 1920, le principal épicier du village était européen. Il s'agissait de M. Gabarre. Très entreprenant, il ne limita pas son activité à l'alimentation et aux articles de bazar. Précurseur dans le domaine cinématographique, il créa un cinéma ambulant. Dans le village, les séances avaient lieu en plein air, sur le Cours. Chaque spectateur devait apporter sa chaise, pour assister aux projections de films muets. Tous les classiques de l'époque défilèrent sur cet écran fait d'une simple toile blanche, souvent dérangée par le vent.
Personnage pittoresque, il avait une superbe paire de moustaches, admirée par toute la population algérienne. Elle en devint légendaire. Lors de toutes les fêtes musulmanes, la coutume s'était établie de promener dans des espèces d'omnibus aux portières sans vitres, les enfants en habits neufs : robes des filles aux couleurs chatoyantes, et costumes des garçons à jolis sarouels bouffants et gilets brodés. Tout ce petit monde scandait sans fin, un slogan :"Gabarre chlaram el far" (Gabarre a des moustaches de souris), en battant la mesure du plat de la main, contre la carrosserie du véhicule. Le bon M.Gabarre avait disparu depuis longtemps, que son nom continuait d'être acclamé par les enfants en liesse.
Le commerce de l'épicerie était en fait détenu en quasi totalité, par des commerçants tunisiens originaires de Djerba. Les djerbis étaient organisés en une espèce de consortium comprenant plusieurs magasins, appartenant à deux grandes familles : les Doghri et les Lazabi.
Chaque magasin était géré par quelques hommes vivant en célibataires, les familles restant au pays. A tour de rôle, les mêmes employés retournaient dans leur île et revenaient ensuite. D'un naturel très pacifique, d'une grande serviabilité, et peu âpres au gain malgré leur état, ils jouissaient de la considération de tous.
Leurs magasins occupaient des positions "stratégiques", en particulier, sur le boulevard Magenta. Le premier, faisait le coin de la rue de Batna, à l'enseigne du "Bon accueil", en remplacement du commerce de M.Gabarre ; le deuxième, doté d'une pompe à essence, le coin de la rue Montebello ; et enfin, le troisième, le coin de la rue Nationale.
Leur structure était invariable avec plusieurs entrées, qui rendaient le magasin accessible de chaque rue. Un long comptoir était en partie, occupé par de grands bocaux renfermant des olives, des variantes, des friandises de toutes sortes, bonbons, gaufrettes et chocolats. Trônant sur le comptoir, à côté des pointes de fromage, des cylindres de "Halwa turc" dit "caca de pigeon" mis sous cloche de verre, soumettaient à la convoitise des gourmands leur pâte aux couleurs pastel.
Les murs portaient des étagères remplies de conserves, du plafond jusqu'à un mètre cinquante du sol. Au-dessous enfin, de grands casiers renfermaient en vrac, de la farine, de la semoule, du couscous, du riz, des pois cassés, des lentilles, des haricots secs, des pruneaux, des dattes et des figues sèches.
Au plafond, étaient suspendus des ustensiles d’usage courant, poêles, casseroles, couscoussiers, balais en diss, rouleaux d’alfa, pompes à insecticides "flit". Les djerbi vivaient vêtus d'un sarouel serré au-dessous du genou, et d'une gandourah gris clair. Ils se couvraient le sommet de la tête d'un petit bonnet blanc en coton tricoté. Ils étaient entourés de chats, gardiens de l'intégrité de leur marchandise. Malgré l'importance et la diversité de leur clientèle, dont des campagnards frondeurs, ils n'étaient jamais impliqués dans le moindre différend.
Ils avaient, en dehors de l'alimentation, une autre activité, liée sans doute à la première, mais résultant aussi de leur stature et de leur ardeur au travail. Ils assuraient le transport des marchandises à l'aide de grandes charrettes à chevaux. On pouvait ainsi les voir, un sac plié en un vaste capuchon couvrant leur dos, exécuter le chargement et la livraison des poches de blé, de farine et de toutes sortes de caisses, de bidons et de fûts. Ils surprenaient par leur aisance à soulever et à porter sur leur dos des charges de cent kilogrammes.
Il existait d'autres commerces d'alimentation, dont deux étaient plus tournés vers la charcuterie. Situés rue St.Athanase, celui de M.Mignucci, un Corse, grand mutilé de guerre, jovial et farceur, qui élevait des porcs et fabriquait lui-même, selon la tradition montagnarde de son île; le second appartenait à M.Martin et "faisait" aussi épicerie.
Les boucheries étaient tenues par des algériens. Cela rendait plus simple la commercialisation des viandes "hallal" abattues conformément aux prescriptions religieuses. La boucherie Kholadi était la plus fréquentée.
Au début des années trente, l'usage faisait que les Algériens consommaient exclusivement du pain fabriqué à la maison. Il existait plusieurs fours publics, où les enfants portaient la pâte à cuire, sur de grandes plaques métalliques.
Un de ces fours était situé dans la rue de Tébessa, presque au coin de la rue de Batna, et comme l'on portait aussi, les gratins dont les plats n'entraient pas dans les fours de ménage, le spectacle des mets divers et en particulier, des gâteaux lors des fêtes, et les bonnes odeurs qui s'en dégageaient, rassemblaient souvent, les gourmands qui traînaient à la sortie des classes.
La grande boulangerie-pâtisserie du village, appartenant à M.Sabathier, était installée sous la Salle des Fêtes, rue Montebello. Plus tard, M.Victor Murienne en ouvrit une, au coin des rues Montebello et de Tébessa. Tandis que la consommation du pain" du commerce" se répandait dans toutes les communautés, plusieurs Algériens s'établirent comme boulangers, fabriquant cependant aussi du pain dit" de ménage".
Dans le domaine de l'alimentation, il existait dans la plupart des rues, des marchands de beignets, souvent tunisiens. Leur boutique présentait une disposition classique : en façade, à côté de la porte, un muret d'une hauteur d'environ un mètre en soutènement d'un plan de travail maçonné, recevait les bassines d'huile servant à la friture, chauffées au fil du temps, successivement, au bois, au charbon, au pétrole puis au gaz butane. L'ensemble était recouvert de faïence.
Le marchand se tenait assis en tailleur sur cette sole, et prenait de la pâte dans un récipient. Il la formait en l'étirant entre ses doigts, et d'un geste circulaire, la projetait dans l'huile. Elle cuisait à feu vif, en se gonflant sur une couronne qui se dorait. Elle était ensuite, piquée et retirée à l'aide d'une longue fourche, pour être disposée sur un plat circulaire émaillé
Les clients contemplaient le vrai spectacle qui se déroulait sous leurs yeux. Les beignets leur étaient délivrés enveloppés dans du papier fort de couleur grise, qui en épongeait l'excès d'huile.
Mais la production ne se limitait pas aux seuls beignets. Dans la nuit, le marchand préparait des pâtisseries au miel, "makrouds"à la semoule fourrés de dattes écrasées avec des clous de girofle, parfumés à la cannelle et à la fleur d'oranger, "chebakïas", "zlabïas" et "halouas dial jelilane" fourrés à la pâte d'amande et parsemés de graines de sésame.
La période la plus favorable à la dégustation de ces gâteaux était le Ramadan, à l'heure de la rupture du jeûne, lorsque le canon d'artifice tonnait enfin.
Il y avait aussi un grand marchand d'œufs et de volailles, dans la rue de Tébessa, en face de la Poste, appartenant à la famille Boujedra, qui faisait aussi commerce de charbon.
Parler d'alimentation à Aïn-Beïda, conduisait toujours à évoquer ce qui semblait être le summum de la gastronomie locale : les petits rôtisseurs algériens spécialisés dans la préparation du "bouzélouf", la tête de mouton entière, cuite sur du charbon contenu dans des braseros de fonte, inclus dans un plan de travail maçonné couvert de faïences blanches. Il yen avait un particulièrement réputé, boulevard Magenta, entre la rue Montebello et la rue des Caïds.
Ces petits rôtisseurs algériens ne faisaient qu’une concurrence limitée à ceux que l'on appelait les gargotes, sans que ce terme ait le sens péjoratif qu'il avait ailleurs. Servant bien évidemment, de la cuisine locale simple, certaines gargotes s'étaient acquis une telle réputation que les Européens n'hésitaient pas y acheter des plats "à emporter". C'était le cas de l'une d'entre elles, située au coin des rues de Montebello et de Tébessa, dont nous savourions de temps à autre, le couscous rustique à la semoule d’orge.
Quant aux restaurants européens, il n'y en avait que deux jusqu'à la guerre de 1939-1945, faisant partie des deux Hôtels situés sur le Boulevard Magenta : l'Hôtel des Messageries, à l'entrée du village, en venant de Sédrata et le Grand Hôtel d'Orient, en face du cours Willigens. Après 1942, seul le premier subsistera.
On ne peut parler d'activité économique, sans citer la plus prestigieuse surtout aux yeux des Algériens : la pharmacie. Dans ce pays de souche berbère, les remèdes de bonnes femmes gardaient toujours leurs adeptes, et les pratiques religieuses étaient souvent détournées vers une certaine forme de sorcellerie, avec son cortège de rebouteux, de faiseurs de mixture, d'arracheurs de dents et de thaumaturges en tous genres. Cependant, le pharmacien européen avait rapidement, acquis un prestige qu’il partageait avec les "toubibs" aux piqûres miraculeuses.
Vers 1930, il y avait deux pharmacies dans le village. La première, sur le boulevard Magenta, au coin de la rue Montebello, avec une belle inscription en lettres blanches peinte sur sa vitrine : "Pharmacie de 1ère classe", était celle de M.Charles Willigens dont j'ai déjà parlé.
Elle avait comme préparateur M.Tarriet, un personnage haut en couleurs, portant une barbe en collier qui contribuait à son prestige auprès des Chaouïa. Il répétait à chacun de ses clients, en donnant le remède réclamé :" Ouhadmorfafi'l'sbah,ouahadmorfafi'lil" (une cuillerée le matin, une cuillerée le soir). Tous avaient une confiance absolue en ses potions, comme en son regard bleu, qui ne pouvait être que d'un demi-marabout !
1925
Terrasse du Grand Hôtel d’Orient
Pharmacie Willigens
1935
Terrasse du Grand Hôtel d’Orient
Grand chasseur devant l'Eternel, ses patients devaient lui révéler les coins les plus giboyeux de la région, car il rentrait rarement bredouille ... à moins qu'il n'ait été vraiment un peu marabout !
Son épouse, très mélomane, et ayant le goût de l'organisation, préparait avec beaucoup de savoir-faire et de gentillesse, des fêtes avec en particulier, la participation d'enfants qui firent les beaux jours de la Salle nouvellement construite.
La seconde pharmacie, celle de M .Lhéritier était située au coin des rues de Tébessa et Saint-Athanase. Je n'en ai gardé qu'un vague souvenir, car mes parents se servaient à la plus proche. Elle fut d'ailleurs remplacée, quelques années avant la guerre, par celle de Mademoiselle Maurin en face du Marché.
Après la guerre, M.Prince en créa une troisième sous la Salle des Fêtes, dans la rue Montebello. M.Tarriet l'y rejoignit. C'est M.Aït-Si-Selmi Gana qui officia désormais, dans celle du boulevard Magenta.
Les pharmaciens partageaient bien justement, leur prestige avec les médecins, même si le recours à ceux-ci n'était pas toujours pratiqué.
Le Dr. Willigens était le médecin "de colonisation" d'Aïn-Beïda. Personnage de petite taille, mince et portant une petite barbe, il était très intimidant. Il veillait sur la santé publique, et en particulier, s'assurait de la bonne exécution des campagnes de vaccination.
Mais son rôle dans le dépistage des épidémies était primordial. Il faut rappeler que les moyens de prévention étaient faibles contre le choléra, la typhoïde, le typhus, la méningite, la diphtérie et autre poliomyélite, souvent à l'état endémique chez les Algériens des douars. La divagation des chiens "kabyles" et autres animaux carnassiers faisait aussi redouter les cas de rage.
Ma mère vivait dans la hantise de ces maladies. A la moindre alerte, elle prenait ses propres mesures sanitaires... Contre les poux, qui ne manquaient pas de venir atterrir sur ma tête, quand ils étaient noirs, et sur mon corps, quand ils étaient blancs et redoutables, il y avait en plus des inspections à répétition, le port obligatoire d'un petit sachet renfermant une pierre de camphre, qui devait les faire fuir ! Au premier pou apparu sur ma tête, j'avais droit à un passage chez le coiffeur. Celui-ci, le père Gréco, me voyant arriver l'air contrarié, me disait avec son accent italien : "Viens, Giorgio quézé té fais la copa à la Dempsey". La référence au célèbre boxeur n'adoucissait pas mon humeur dans la perspective de me retrouver "la boule presque à zéro".
La mesure prophylactique à laquelle j'essayais en vain d'échapper, était la sacro-sainte fumigation de carbure de calcium. Je devais m'y soumettre, dès que le moindre gosse commençait à tousser dans la salle du café, surtout, s'il imitait le chant du coq annonciateur de la coqueluche.
Cela ne m'empêchait pas d'être exposé à la fréquentation de tous les microbes de la rue et de l'école, et en particulier, du sournois bacille de Koch que l'on savait pourtant embusqué dans les poignées de main fiévreuses, ou pire, dans les livres ou imprimés empruntés à n'importe qui. Ceux-ci devaient subir, par les soins de ma mère, un passage obligatoire dans le four de la cuisinière, préalablement à toute lecture.
Il faut aussi, parler des deux séances annuelles de purge à jeun, au sulfate de soude et à l'huile de ricin, qui n'avaient pour rivales en haut-le-cœur, que les doses d'huile de foie de morue devant m'assurer à tout coup, de devenir centenaire.
La mesure prophylactique à laquelle j'essayais en vain d'échapper, était la sacro-sainte fumigation de carbure de calcium. Je devais m'y soumettre, dès que le moindre gosse commençait à tousser dans la salle du café, surtout, s'il imitait le chant du coq annonciateur de la coqueluche.
Cela ne m'empêchait pas d'être exposé à la fréquentation de tous les microbes de la rue et de l'école, et en particulier, du sournois bacille de Koch que l'on savait pourtant embusqué dans les poignées de main fiévreuses, ou pire, dans les livres ou imprimés empruntés à n'importe qui. Ceux-ci devaient subir, par les soins de ma mère, un passage obligatoire dans le four de la cuisinière, préalablement à toute lecture.
Il faut aussi, parler des deux séances annuelles de purge à jeun, au sulfate de soude et à l'huile de ricin, qui n'avaient pour rivales en haut-le-cœur, que les doses d'huile de foie de morue devant m'assurer à tout coup, de devenir centenaire.
Longtemps, il n'y eut à Aïn-Beïda, qu'un second médecin, le Dr.Boumali, personnage ayant beaucoup de prestige dans toutes les communautés, ce qui le conduisit à devenir à son tour, Maire du village, mais la maladie, hélas, l'emporta prématurément...
M.Bonnotte fut longtemps, le seul vétérinaire du village. C'était un personnage au teint coloré, à la moustache blonde et à l'esprit éclairé d'un bel humour.
L'Hôpital militaire servait à la troupe, et je ne m'intéressais qu'à "l'amphithéâtre" qui le jouxtait. Je lui attribuais un rôle mystérieux, car j'ignorais à quoi il pouvait bien servir. J'avais essayé en vain, d'en percer les secrets en grimpant sur son mur, pour regarder à travers la lucarne d’une pièce désespérément vide.
L'importance de l'activité économique d'Aïn-Beïda justifiait la présence de trois banques, à une époque où pourtant, les opérations bancaires n'étaient pas chose commune. Elles étaient toutes les trois installées en face du Cours.
La plus proche de chez nous, la "Banque de l'Algérie" était le plus bel édifice du village. Mon père m'emmenait parfois, dans ce sanctuaire, où l'on se déplaçait à pas feutrés, et où les conversations s'effectuaient à voix basse. M.Zerbib en était le concierge. Mon imagination attribuait à cet homme d'une grande amabilité, des responsabilités consulaires. Je le croyais gardien d'un trésor fabuleux, enfoui dans des coffres scellés au fond de caves inaccessibles.
La seconde banque était le "Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie", à deux pas de la rue Solférino. Y officiait M.Masseube, un homme jovial rompu à la pratique du calembour.
La dernière était la Compagnie algérienne, au coin du boulevard du Sud, avant d'être transférée dans la rue Nationale. C'était le domaine de M.Vigo. De grande taille, il me paraissait austère et m'intimidait beaucoup.
Les banques rue Magenta
Quelques maires de la ville :.
M.Charles Willigens et son fils le Dr Frédéric "Pierre", Dr.Boumali et le Dr. Dragacci
Lieux de rencontre
Les lieux de rencontre d'Aïn-Beïda étaient le marché du lundi, le Marché aux légumes et les différents commerces, et en dehors de ceux-ci, il y avait les cafés.
Pour la population algérienne, c'était les nombreux cafés maures, et pour les Européens, ainsi que certains Algériens "évolués", les cafés tenus par des Européens.
Les cafés maures étaient les lieux de prédilection de ceux qui voulaient traiter des affaires, en dehors de leur boutique, mais surtout, des endroits où l'on trouvait des gens désœuvrés. Sur le boulevard Magenta, il y en avait quatre ou cinq.
Le plus célèbre était situé à l'angle des rues de Tébessa et de Batna. Il portait sur sa façade un distique : "Mais c'est un café exquis, que vous sert Salah Tébessi".
Ouverts très tôt le matin, ils accueillaient les voyageurs en partance, toujours dans la crainte de rater leur car, ou de ne pas y trouver de place. Ils possédaient généralement deux salles.
La première, avec un comptoir d'un modèle ancien, racheté à bas prix, à un cafetier européen. Derrière ce meuble, quelques étagères murales avec des verres multicolores, un ou deux vases contenant des fleurs, et surtout une petite branche de jasmin. L'indispensable lampe à acétylène trônait aussi, dans un coin : simple boîte de conserve portant un tuyau vertical surmonté d’un gicleur, avec laquelle, en cas de panne d'électricité, on obtenait grâce à un mélange d'eau et de carbure de calcium, une lumière puissante et bon marché.
On accédait à la deuxième salle, en descendant une ou deux marches. Comme dans la première, des tables étaient installées, elles permettaient de s'adonner discrètement, aux jeux d'argent interdits bien évidemment, par les lois terrestres et divines. C'était aussi, le refuge des fumeurs de kif, perdus dans leurs rêves, ignorés voire méprisés par les autres clients.
Des spectateurs très volubiles entouraient les joueurs, commentant les phases du jeu de "ronda" pratiqué avec des cartes espagnoles, dont on annonçait à haute voix, la couleur et la force.
Le jeu de dominos n'était pas en reste quant à son ambiance sonore. Les joueurs cognaient sur la table, à chaque dépôt de jeton, et en annonçaient aussi la valeur.
C’est peu de dire que tout le monde braillait et transpirait, tandis que la fumée des cigarettes se faisait de plus en plus dense et âcre, au fil des heures. Seuls les joueurs de dames surprenaient par le calme de leur attitude.
Parfois, le ton montait sans que l'on connût la cause du différend, une bousculade s'ensuivait, des tables étaient renversées, un groupe se retrouvait sur le trottoir, gesticulant, et se distribuant des coups de "debouz", tandis que 1"indicateur de service" courait vers le commissariat en criant : "Genboulice ! genboulice !" provoquant l'intervention des agents, qui ramassaient les blessés, et quelques suspects escortés ensuite, vers le Commissariat par la foule de ceux qui par définition, n'avaient rien vu.
Avant la mode des sodas de marque, c'était la "gazouze", limonade fabriquée localement, avec des extraits naturels, qui était consommée .Mais la faveur générale allait au moka. On le servait dans de petits verres, additionné de sirop de fleur d'oranger ou de jasmin. Certains préféraient le thé vert préparé avec ou sans menthe.
Les amateurs sirotaient les boissons chaudes, en aspirant avec un petit bruit, qui en disait long sur leur délectation. Chaque première absorption était précédée d'un rituel "Bismillah", et l'achèvement de la consommation était suivi de "Hamdoullah", rendant grâce à Allah de ce nouveau bienfait, montrant combien les choses simples avaient de l’importance.
Pour les passants, les cafés maures se signalaient par le volume sonore de leurs phonographes. Durant toute la journée, les mêmes disques rabâchaient leur rengaine. Seule l'intervention de la police permettait de faire cesser le vacarme, aux heures de la sieste. Il faut dire à la décharge des Algériens, que cette musique ne les empêchait pas de dormir.
En été, les caouadjis sacrifiaient au bienfaisant rite de l'arrosage du morceau de trottoir devant leur café, ainsi que de la rue correspondante. La poussière était un élément permanent avec lequel il fallait compter. Toutes les rues n'étaient pas goudronnées, et même en l'absence de vent, le moindre passage d'un véhicule soulevait de fines particules qui volaient partout.
La technique de l'arrosage était rudimentaire. Le cafetier tenait de la main gauche l'anse d'un petit récipient métallique, et le corps penché pour ne pas se mouiller les pieds, il aspergeait le sol de la main droite, à grandes giclées. C'était simple et efficace.
Cette habitude s'était généralisée, et les commerçants européens la pratiquaient... c'était devenu une tradition.
Il y avait deux sortes de cafés européens. Les premiers, de type "bar" avec quelques tables. Les seconds, de type" brasserie" plus vastes, comportant une ou deux salles de grandes dimensions, et surtout une marquise protégeant du soleil et des intempéries.
Parmi les premiers, on comptait : le Café Bourh, boulevard Magenta, à mi-chemin entre les rues Montebello et de Batna, le Café Boutégège, Canèse par la suite, rue de Tébessa près de la Synagogue, le Café Lyonnais, rue St.Athanase faisant le coin de la rue de Batna, tenu par les Guedi et Leboube, le Café des Haracta, boulevard du Nord, au coin de la rue St.Athanase appartenant à M.Manche.
On peut ajouter dans cette catégorie, la Buvette des Cheminots, à la gare, et le café inclus dans l'Hôtel des Messageries, à l'extrémité nord du boulevard Magenta. Il y avait aussi, près du Crédit foncier, le Cercle de l'Union avec sa salle et sa terrasse. Le fréquenter était comme posséder un titre de Noblesse tombé en quenouille.
Le premier, "Le Café de la Paix", appartenant à la famille Xicluna, fut tenu par M. Xicluna père puis, par son fils aîné, Charles, unanimement connu sous le "diminutif" de Charlot. Il présentait une particularité mythique, une baraque sur roues s'installait à la belle saison sur son trottoir, à côté de la terrasse, et Boudjemaà un ancien tirailleur, préparait des frites, des brochettes et des merguez, attirant beaucoup de consommateurs. Cette activité était connue sous l'appellation de "chez l'Ancien". Un magnifique coq peint sur une pancarte prévenait les éventuels resquilleurs : « Quand ce coq chantera, crédit se fera »
Le Buffet de la Gare et La Halle aux grains-1930
(On voit au coin la légendaire madame Lecerf qui le tenait)
Le deuxième, appartenant à mes parents, faisait partie du "Grand Hôtel d'Orient". Il comprenait une première grande salle qui précédait les deux salles de restaurant. La terrasse avait sa marquise, et l'établissement recevait les mêmes clients que son vis-à-vis, à quelques habitués près, se plaisant plus chez l'un que chez l'autre. Nombre d'entre eux faisaient une escale dans l'un, avant de s'attabler dans l'autre.
Dès 1930, mon père avait installé un poste de T.S.F dans la salle. Equipé d'une grande antenne, il permettait de recevoir les émissions d'Alger et de France. Comme il était doté d'un Pick-up, il fut pour beaucoup dans la diffusion par le disque des chanteurs de Caruso à Tino Rossi en passant par Joan Kepura, Rina Ketty et les nouveaux ensembles orchestraux de danse et de variétés.
En 1939, lors de la déclaration de guerre, mon père retira son poste, conscient que trop d'agitation se produirait lors de la diffusion des informations. Bien lui en prit, l'avenir devant apporter les plus tristes nouvelles que nous devions entendre de notre vie.
Autarcie
Aïn-Beïda présentait dans son économie une physionomie de caractère autarcique. En effet, le fait de vivre d'une mono activité avait conduit à devoir disposer sur place, de tous les moyens commerciaux et artisanaux permettant de faire face à la demande locale.
Il existait tout naturellement, des commerces directement liés à l'agriculture. Celui de l'agréage des céréales, achat et expédition de la production, était pratiqué par plusieurs membres des trois communautés, dont le plus célèbre était M. Chouchana au bureau situé rue de Tébessa. Sa haute stature et son habileté professionnelle en avaient fait un personnage typique du village. Sa disparition marqua la fin d'une époque, où les affaires se traitaient entre gens ayant une estime et une confiance réciproques, que ne pouvait ternir aucune rivalité commerciale.
Deux quincailliers étaient établis rue St.Athanase. Le premier M. Audibert avait son magasin depuis 1934, sous la Salle des Fêtes. Les frères Bentounsi continuèrent ce commerce en 1942, après son décès pendant une épidémie de typhus. Le second, Georges Demaria, s'installa plus tard, à proximité de l'angle de la rue de Batna.
Le développement des machines agricoles entraîna toute une activité en mécanique, à laquelle sont associés les noms de Tisné, Garreau, Vaudey, Casali, Demaria, Siméon, Tomati ...
La qualité des céréales produites permettait d'en exporter une grande quantité, tandis qu’une partie était utilisée pour la consommation locale. Il faut dire que nombreux étaient ceux qui, plutôt que d'acheter de la farine et de la semoule "industrielles", préféraient acheter du blé ou de l'orge, et le faire transformer par les minotiers du village, garants du bon traitement des grains qui leur étaient confiés.
Les moulins de M. Boutégège et de M. Soulliard rassemblaient pendant certaines périodes, une grande diversité de clients, représentant un large échantillon de la population algérienne.
Le moulin de M.Soulliard occupait un angle de la rue éponyme. Voir le meunier dans son installation avait quelque chose de surréaliste, quand on était accoutumé à le rencontrer au dehors. C'était en effet, deux personnages différents. En ville, M. Soulliard promenait sa silhouette vêtue de sombre, l'air d'un notaire de province, ses lorgnons accentuant son aspect austère. Au travail, on le découvrait en blouse grise, et l'on se surprenait à insister du regard sur les projections de farine jusque sur ses lorgnons.
Devant la porte du moulin, stationnait une foule où se mêlaient des villageois et des chaouïa venus du bled. Hommes et femmes encombrés d'enfants dépenaillés, chevaux songeurs, ânes blessés, mulets alourdis de bats, chiens "kabyles" efflanqués, brouettes rafistolées, carrioles tendant vers le ciel leurs bras usés, camionnettes hoquetantes, tout un rassemblement hétérogène, attendant, dans la fascination du manège de la meule, de retrouver son grain métamorphosé en belles farine et semoule.
Le monde varié des artisans que recélait Aïn-Beïda présentait le plus grand intérêt sociologique, toutes les branches étant représentées : ferronnerie, menuiserie, bourrellerie, ferblanterie, bonneterie et habillement.
La plus spectaculaire était sans conteste, la ferronnerie. Les deux ateliers des maréchaux-ferrants étaient installés rue Charles Souillard. Les Frères Pellegrini et M.Auguste Bicais y régnaient en maîtres des forges.
L'atelier de ce dernier comportait un secteur de menuiserie où travaillait un brave homme prénommé Kaddour, un peu contrefait mais au cœur généreux et à l'habileté rare. Il fallait le voir procéder au façonnage des différentes pièces de bois nécessaires à la fabrication ou à la réparation des véhicules destinés au transport : brancards, ridelles et hayons.
L'opération la plus spectaculaire à laquelle on pouvait assister, était le cerclage des roues souvent énormes des tombereaux et chariots. Après que Kaddour eût fignolé les jantes avec un rabot cintré et eût assemblé les rais sur le moyeu, Auguste Bicais procédait à la mise en place de la boîte en fonte et des coussinets devant recevoir l'essieu.
Venait alors l'opération de cerclage proprement dit. Il installait la roue horizontalement sur un support. Puis, sur un grand lit de braises de charbon vivement activées par un énorme soufflet de forge, il déposait le cercle pour le dilater. Lorsque celui-ci était entièrement porté au rouge, il le saisissait à l'aide de longues pinces et le mettait en place autour de la jante.
Grâce à sa force herculéenne, à son expérience et sa grande habileté, il faisait prendre instantanément au cercle la bonne position. Des aides aspergeaient vivement l'ensemble à l'aide de seaux d'eau. Le refroidissement obtenu, le maréchal-ferrant mettait en place de solides boulons qu'il coupait ensuite, à la cisaille.
Tout l'atelier venait alors admirer l'œuvre accomplie par le maître qui restait là, le corps légèrement penché en avant, ses mains puissantes entrouvertes au bout de bras raidis par l'effort, un peu écartés de son buste mouillé par la transpiration.
L'opération de décerclage nécessitait aussi, une grande force. Le maréchal-ferrant y procédait à l'aide d'un levier imposant armé d'une griffe, qu'il plaçait sur le bandage tandis qu'un poussard était engagé dans le moyeu. Le maître s'arc-boutait sur l'extrémité du levier, et après quelques efforts ponctués de "han" violents, le cercle était dégagé. Kaddour pouvait alors, intervenir pour redonner aux pièces de bois leur forme d'origine, et permettre une nouvelle opération de cerclage.
Le ferrage des chevaux intéressait autant le spectateur. Le maréchal-ferrant portait au rouge un simple morceau de fer, qu'il aplatissait en le martelant, puis le formait et le perçait enfin. Il limait ensuite, le sabot de la jambe de l'animal maintenue repliée par un apprenti. La mise en place du fer encore chaud s'effectuait en dégageant de la fumée et une odeur de corne brûlée. Il achevait l'opération en fixant le fer avec des clous, dont la longueur semblait excessive au profane, et lui faisait craindre le risque d'une blessure. Il n'en était jamais rien et une fois libéré, le cheval marchait normalement.
Le vacarme qui régnait pendant les travaux, provoqué par les masses et les marteaux sur l'enclume en battements alternés, maître et apprenti, le rougeoiement étincelant de la forge projetant alentour des ombres étranges sur le cercle de clients et de curieux, et l'allure massive d'Auguste Bicais, Vulcain réincarné, tout contribuait à la magie de ce lieu gravé dans ma mémoire, comme un Dürer.
Menuiserie et bourrellerie
Il existait dans différentes rues d'Aïn-Beïda des menuiseries tenues par des artisans lgériens, mais la menuiserie la plus extraordinaire à mes yeux était celle de M. Chemla. Installée sur le boulevard de l'ouest, dans un immense bâtiment dont on embrassait d'un seul coup d'œil les trois niveaux.
Le sous-sol découvert à travers des espèces de trappes, recevait les divers déchets : sciure, copeaux, morceaux de bois de différentes essences. Pour moi, il s'agissait d'un gouffre sans fond capable de tout engloutir, tant je n'arrivais pas à m'imaginer ce qu'il pouvait bien advenir de ce qui y disparaissait.
Le niveau de la menuiserie proprement dite, était équipé de grands établis, et les murs étaient meublés d'étagères et plantés de pitons, afin de recevoir mille outils de toutes formes et de tous usages : rabots et bouvets trapus, varlopes et riflards aux longs fûts, scies à chantourner à lames brillantes, égoïnes et scies à moulures, vilebrequins à poignées lustrées, équerres, compas, trusquins, ciseaux et une multitude de serre-joints.
Sur ce même niveau, se trouvaient diverses machines-outils servant au façonnage, au tournage et au carroyage des pièces : toupies et dégauchisseuses, tours, raboteuses, scies circulaires et à ruban, autant de monstres métalliques impressionnants. La force motrice électrique était transmise par un jeu de courroies en fibre, descendant de l'étage supérieur, courant sur des roues énormes qui actionnaient les machines.
L'ambiance générale était bien évidemment, bruyante. L'air était chargé de la même poussière de bois qui recouvrait tout dans l'atelier. Au milieu, officiant en blouse, la casquette sur un crâne puissant dominant un visage rond aux yeux plissés dans un sourire permanent, le crayon plat de charpentier glissé au-dessus d'une oreille : le"père" Chemla. Il représentait pour moi, le menuisier idéal sorti tout droit du chant que m'avait appris mon maître Ninou Lagana :
"Ris toujours, c'est ma devise,
Menuisier, c'est mon état.
J'ai goûté, par gourmandise,
A la soupe du soldat.
Dans les îles, pour la France,
J'ai chanté sous les drapeaux.
Au retour ma préférence,
Fut pour vous, jolis copeaux."
Depuis mon enfance, je ne suis jamais entré dans une menuiserie sans que les odeurs mêlées de sciure, de colle et de vernis n'évoquent instantanément, l'image du cher menuisier d'Aïn-Beïda.
Le cheptel, vivant et travaillant tant dans le village que dans la campagne environnante, entraînait l'existence d'une importante activité de bourrellerie.
Dans la rue de Tébessa, à mi-chemin entre les rues Montebello et de Batna, M. Cohen tenait la plus importante boutique atelier de la corporation. Il consacrait tout son temps à son travail. La seule distraction qu'il s'accordait parfois était une partie de chasse avec mon père.
Son atelier recélait mille morceaux de tout ce qu'un enfant rêve de pouvoir récupérer : bois, cuir, toile de jute, ficelles de toutes les grosseurs, lanières de lin et monceaux de crin.
Quand on y entrait, une forte odeur de poix mélangée à de la térébenthine vous saisissait. Elle émanait d'une petite boite métallique dans laquelle un mélange d'apprêt, destiné à enduire le fil, restait en fusion lente sur un minuscule kanoun.
Sur le comptoir, étaient exposées quelques-unes des fabrications de l'artisan : coussin de calèche capitonné, collier de cheval, harnachement de cuir surpiqué, sellette et caveçon de fantaisie. Sur les murs pendaient des accessoires de travail ou de parade : guides, brides, sous-ventrières et traits aux cordelières finement tressées.
En retrait, le maître bourrelier assisté d'un jeune apprenti, travaillait sur une petite table établi où reposaient quelques outils utilisés pour la tâche en cours : maillet, ciseaux, passe cordon, couteau à pied et serpette. Sur ses genoux, cuir et toile concouraient au façonnage.
Les jours de marché, les colons et les fellahs se faisaient passer tour à tour, des pièces pour en évaluer la robustesse et la finition. Le bourrelier confiant en la qualité de sa marchandise, restait indifférent à leurs hésitations, et ne forçait jamais la vente, faisant preuve d'une sagesse appréciée de tous.
Ferblanterie et cordonnerie
Dans la rue des Caïds et dans les rues avoisinantes, de nombreux artisans avaient pignon sur rue.
En face du portail métallique de l’entrée de l'Ecole des Garçons, se tenait l'atelier de ferblanterie du "père" Batkoun. Il me connaissait depuis toujours, me laissait toucher à tout et répondait patiemment aux questions incessantes que je lui posais sur ce qu'il faisait. La soudure était en fait quelque chose qui me fascinait. Hélas ! Que ne m'en a-t-il appris les tours de main. Chaque fois que je m'y essaie et que j'échoue, je lui en adresse le reproche, mais ce n'est en fait qu'une invocation et une prière pour le repos de son âme.
Une forge avec une hotte en zinc occupant tout un coin d'un vaste local, faisait face à l'entrée. Une forte odeur de charbon, de métal chaud et d'acide emplissait l'air.
Le ferblantier était aidé par quelques petits apprentis que lui confiaient des familles juives pauvres, assurées de son expérience et de son soin à former de bons ouvriers.
J'ai compris le sens propre de l'expression " avoir plusieurs fers au feu", en le regardant travailler. Tandis qu'il avait mis dans la braise de la forge des fers à souder de différentes formes et grosseurs, il s'activait à diverses tâches.
Il aplatissait en la martelant, une fine feuille de métal, la roulait ensuite, pour en modeler une théière ou une verse à "kaoua" à long manche. Puis, il soudait une anse sur une bassine galvanisée qu'un apprenti maintenait à bout de bras, dans la crainte de recevoir quelques gouttes de soudure d'étain en fusion.
Dans le même élan, grondant au passage, l'aide qui avait interrompu la manœuvre du soufflet de la forge, pour contempler une portée de chatons jouant avec un chiffon enduit de suif, il plongeait une poignée de couverts à réargenter dans un bain d'électrolyte, alimenté par une vieille batterie d'accumulateurs de camion.
Tous les ustensiles ménagers pouvaient sortir de ses mains calleuses, marquées par les multiples blessures faites par quelque métal et cornées par les agressions répétées du feu.
Dès l'aube, on pouvait voir à travers les vitres de son atelier salies par les fumées, la longue silhouette du "père" Batkoun, penchée sur son ouvrage, en sorte que chacun se demandait s'il s'arrêtait, en dehors du Sabbat.
Dans ce même quartier, plusieurs cordonniers avaient leur échoppe. Les plus connus étaient les maîtres Benmechri et "Zouzou" Taieb. Ce dernier était un personnage. Ancien poilu, décoré d'une Croix de guerre largement méritée par les souffrances endurées dans les tranchées et les assauts à la baïonnette de la Grande-Guerre, il avait conservé une paire de moustaches qui pour être moins célèbre que celle de M. Gabarre, n'en était pas moins remarquable.
Leurs magasins présentaient le même aspect. Une petite porte vitrée s'ouvrait sur un local réduit, encombré de fabrications en tous genres. Dans une petite vitrine, quelques paires de chaussures à la confection soignée, attiraient le regard des passants, mais une fois à l'intérieur, il fallait le secours du cordonnier pour réussir à accéder à la marchandise disposée sur des étagères, dans un ordre dont il détenait seul le secret.
Recroquevillé derrière une minuscule table basse, il travaillait sur un pied inversé en fonte, fiché dans un support de bois, qu'il serrait entre ses genoux. Il gardait dans la bouche, des petites pointes qu'il devait clouer dans la semelle et qui l'empêchaient d'articuler en parlant sous peine de les avaler.
Sur une table longue et étroite, étaient entassées des peaux tannées de diverses couleurs, sur lesquelles le cordonnier dessinait les tiges des chaussures, à l'aide d'un patron en carton. Il les découpait ensuite, d'une alène tranchante comme un rasoir. Dans une petite boite de conserve, l'inévitable poix restait de longues heures, en fusion sur un kanoun, répandant son odeur caractéristique qui se mélangeait aux senteurs chaudes des cuirs et de cire.
Lorsqu'ils entraient dans cette échoppe, les chalands étaient déroutés, ne sachant où poser le regard pour trouver la paire de bottes, de babouches ou de mocassins qu'ils avaient l'intention d'acquérir. Sans se détourner de son ouvrage, l'artisan les écoutaient, faisait un geste dans une vague direction, et l'acheteur dérouté ne devait qu'au hasard de pouvoir découvrir ce qui lui convenait.
On avait toujours l'impression que le principal était d'exercer son métier et que la vente n'en était qu'une modalité secondaire. Cependant, il fallait bien tirer un revenu de son labeur...
Tissus et confection
Le commerce des tissus était partagé entre les communautés juive et algérienne. De nombreuses boutiques étaient situées dans le quartier entre les rues des Caïds, Nationale et St Athanase. Cependant, il y en avait quelques-unes dans la rue de Batna, et sur le boulevard Magenta.
Dans la première rue, se tenait celle de M. Melloul, revêtant l'aspect de celles de la grande ville, avec un large comptoir et des rayonnages, sur lesquels étaient installées de lourdes pièces de tissus, dont des lainages provenant du Nord de la France, destinés à la confection de costumes et de manteaux.
Le marchand détenait aussi des tissus pour toutes sortes d'usages européens ou algériens, ainsi que des articles de mercerie et d'ameublement.
Les plus versés dans le commerce des tissus algériens étaient les Mozabites. Groupe de gens originaires de la région du Mzab, berbérophones analogues aux Djerbi ils appartenaient à la secte religieuse issue du Kharédjisme, des Ibadites dont la ville de Ghardaïa était la principale résidence.
Comme les Djerbi ils s'expatriaient dans toute l'Algérie pour pratiquer le commerce. A Aïn-Beïda, leur activité unique était la vente de textiles.
Sérieux en affaires, courtois et "sans histoires", ils jouissaient de la considération générale. Il travaillaient, eux aussi, par roulement dans le village, et retournaient périodiquement au pays. Ils étaient considérés comme non orthodoxes par les autres musulmans et étaient enterrés dans un cimetière particulier.
Les deux magasins qu'ils tenaient sur le boulevard Magenta, étaient situés presque en vis-à-vis: le premier entre la Pharmacie et le magasin de Vins et spiritueux "Faletti et Solomiac", le second, entre la Bijouterie Morio et le marchand de beignets.
Ils présentaient le même agencement avec un large comptoir et des étagères escaladant les murs jusqu'au plafond, sur lesquelles s'entassaient des monceaux de tissus de toutes les couleurs. Les femmes algériennes raffolaient de vêtements chatoyants pour l'intérieur ou pour les fêtes, contrastant avec le noir obligatoire des haïks qui les enveloppaient pour sortir. Les magasins détenaient peu de riches taffetas et velours de Gênes, mais débordaient de tarlatanes, d'organdis et autres mousselines achetés à l'avance, en prévision de la prochaine fête religieuse ou d'un mariage annoncé ...
Aïn-Beïda avait ses tailleurs et confectionneurs en tous genres.
Le principal tailleur européen était installé sur le boulevard Magenta, en face de chez nous. Italien, il se nommait Giganti mais tout le monde l'appelait Coco. Vieux célibataire il logeait dans son arrière-boutique. En raison de la courte distance qui séparait nos deux maisons, et de mon attirance pour les travaux manuels, je passais souvent mon temps à le regarder tirer sur son aiguille, bâtir des vestes sur un mannequin et arracher une manche faufilée d'un geste large tel un magicien. D'ailleurs, il avait la réputation d'être un peu sorcier. Cela était corroboré par la présence d'une image phosphorescente représentant un squelette, pendue à la porte de communication avec son logement.
Sur une table de repassage massive, attendaient en permanence deux énormes fers de fonte, chargés de braise qui, lorsque le tailleur les utilisait avec des pattemouilles, me paraissaient dans le souffle de la vapeur aussi puissants que des locomotives.
Mes camarades se demandaient comment je pouvais oser entrer dans cette boutique, et lever les yeux vers la sentinelle verdâtre qui veillait sur la porte. Je rêvais et redoutais à la fois d'entrevoir dans la pièce du fond, une casserole où cuirait quelque crapaud ou tarente. Mais de l'autre côté du miroir, il n'y eut jamais sur le kanoun du tailleur qu'un "osso bucco" ou des jarrets "à la napolitana", mijotant longuement et répandant de fausses odeurs d'élixir.
Coco Giganti entretenait avec art le mystère en racontant de vieilles histoires calabraises dégageant des relents de soufre qui faute de sortilège, semaient la crainte et la suspicion chez ses auditeurs par trop crédules.
Les confectionneurs de vêtements traditionnels avaient leurs boutiques dans les rues où se tenaient les marchands de tissus algériens et juifs. L’atelier de l’un d’eux était mitoyen de notre maison. Il attirait toute mon attention. Le maître était un vieillard chenu aux gestes élégants qui, hormis les salutations d'usage, travaillait en silence et paraissait en pleine méditation.
Lorsque le mauvais temps ne me permettait pas de jouer à l'extérieur, j'allais me réfugier dans sa boutique. Le sol était couvert de nattes de jonc. Des étagères recelaient des pièces de tissus de coton, de soie et de rayonne. Une grande armoire contenait des fils de couleur enroulés sur des bobineaux ou serrés en écheveaux.
L'infinie variété des tons sur lesquels tranchaient les ors constituait une atmosphère très étrange car la pénombre régnait dans le magasin et le "mahlem", assis sur un coussin de laine, les jambes repliées sous lui s'arrangeait pour changer de position, afin de toujours recevoir la lumière en incidence oblique sur son ouvrage
La nuit tombée, une seule ampoule projetait une lumière incertaine sur le vêtement en cours, et tous les yeux se fixaient sur les mains fines et sèches qui s'activaient en gestes précis et efficaces.
Le tissu s'étalait sur le sol devant les genoux de l'artisan, dont la tâche la plus délicate était la mise en place de longues soutaches sur les bords des gandourahs ou des burnous. Un enfant tressait les fils qui les constituaient, tendus depuis le vêtement sur une longueur de plusieurs mètres. Pour ce faire, il était obligé de se tenir à l'extérieur de l'atelier, jonglant avec les bobineaux en prenant bien garde de ne pas emmêler les fils, ni confondre les couleurs.
Fasciné par cette activité, je passais de longues heures, souvent avec Paule, dans la contemplation du maître, oubliant qu'il fallait rentrer à la maison et obligeant mon père à venir me chercher et à me sermonner.
La fois suivante, le "mahlem" ne manquait pas de me montrer le vêtement achevé tant il savait combien j'appréciais son travail. Je me contentais de dire : "C'est beau !", et je le voyais plisser ses yeux clairs, comme s'il recevait le plus beau compliment du monde. Il savait que j'admirais sa tâche délicate et que j'en connaissais toutes les difficultés.
Qu'Allah t'ait en Sa Sainte garde Si Chérif !
Bijouterie
L'activité commerciale à Aïn-Beïda couvrait aussi le domaine de la bijouterie. Comme partout en Afrique du Nord, c'était les artisans juifs qui y excellaient.
Ils fabriquaient l'ensemble de ce qu'ils vendaient. Les techniques de façonnage des métaux précieux s'acquéraient grâce à un apprentissage traditionnel.
Le bijoutier travaillait derrière le comptoir de son magasin. Celui-ci était en général très exigu, et ne comprenait qu'une minuscule vitrine sur la rue. Dans cette vitrine, étaient déposés des bagues, des pendentifs et des boucles d'oreilles, tandis que sur des traverses étaient enfilés des bracelets. Ces derniers bijoux allaient souvent par séries de sept, des "semaines" que les femmes appréciaient tout particulièrement.
Les deux bijouteries principales se trouvaient dans la rue de Tébessa, l'une, à deux pas de la rue de Batna, l'autre, dans cette rue même. Messieurs Zaoui et Guigue en étaient les artisans.
L'or en bijoux ou en pièces de monnaie était très en faveur, tant dans la communauté juive que dans la population algérienne. Il constituait une part importante des dots, et servait souvent de complément dans les arrangements matrimoniaux.
Cependant, l'argent servait aussi à la fabrication de beaux bijoux, avec un travail de filigranes aussi beau que celui de l'or. Des broches ornées d'inscriptions en élégant graphisme arabe, permettaient à certains orfèvres d'exprimer toute leur habileté. De gros bracelets de chevilles "Khrôlkhrôl" ornaient aussi les vitrines.
La clientèle féminine algérienne profitait de sorties échappant à la surveillance familiale, pour venir contempler et négocier des achats, en d'interminables tractations. Les échanges avaient une grande part dans ces opérations commerciales.
Le bijoutier habile complice d'achats discrets, fidélisait ainsi la clientèle féminine. Il connaissait tout le pouvoir du bouche à oreille dans la prospérité de cette activité "de richesse et de prestige" ...
Caprices météorologiques
Toute la vie d'Aïn-Beïda dépendait de l'agriculture. Toute l'agriculture était tributaire du climat. Tout le climat était conditionné par deux facteurs : la pluie et le vent.
Lorsque l'on disait pluie, on pensait sécheresse. Celle-ci avait pour cause le régime des pluies caractérisé par une absence à peu près totale de précipitations, pendant la saison chaude.
Sur l'Algérie, la répartition des pressions s'oppose en été, aux échanges atmosphériques entre l'Atlantique et le Sahara. Les vents soufflant du nord, du nord-est et de l'est, peu chargés en humidité, rafraîchissent le littoral mais, n'apportent aucune pluie aux Hauts-Plateaux surchauffés. Juillet et Août sont complètement secs, Juin et Septembre ne connaissent que des orages locaux.
Les pluies apparaissent en Octobre, et décroissent de Janvier à Juin. L'influence océanique intercale une petite saison de moindre pluie en Février, et une recrudescence des précipitations en Mars.
Dans les cycles de pluviosité normale, les grandes pluies tombent en deux périodes, en Automne et au début de l'hiver, puis au printemps. Les premières sont les plus profitables, car elles imprègnent profondément le sol déjà labouré, et constituent des réserves d'humidité. Les secondes le mouillent beaucoup moins, et la température augmentant, elles deviennent la proie de l'évaporation. Elles sont cependant, aussi nécessaires, car elles se produisent au moment où les céréales entrent dans la période active de végétation. De leur abondance, dépendent les bonnes récoltes. Les années où ces pluies sont rares, sont des années de disette.
Rien n'est plus capricieux que la pluviosité. La hauteur des précipitations varie d'une année à l'autre, sans raison apparente et dans de grandes proportions.
En outre, même les années où la pluviométrie semble bonne, il arrive que les pluies tombent aux époques normales, mais qu'une forte sécheresse et de très fortes chaleurs en été, ou peu de pluies au cœur de l'hiver entraînent des récoltes catastrophiques.
L'hiver est très rude à Aïn-Beïda. La température moyenne en Janvier, ne dépasse pas 3°. Le nombre de jours de gelée est considérable. Le thermomètre descend jusqu'à moins 16°. La neige tombe souvent et entrave les activités, mais ses effets sur les céréales sont bénéfiques.
Un dernier phénomène, mais non le moindre, contribue à amplifier les conséquences de l'aridité, c'est le sirocco. Ce vent du sud extrêmement chaud et très sec, se déchaîne par à-coups plus ou moins longs. Il est souvent violent et accompagné de tourbillons qui soulèvent des nuages de poussière rouge. Il souffle pendant des cycles ternaires.
Sous un tel climat le sirocco, comme les autres vents, exagère encore l'évaporation et ainsi contribue à raccourcir la période végétative. Les arbres ne peuvent survivre que dans les montagnes qui bordent la région au sud-est, vers La Meskiana ou au sud-ouest, dans les Aurès.
Les épineux formés en buissons ne parviennent jamais à couvrir le sol d'un tapis continu. L'alfa propage ses touffes de couleur verte virant au blanchâtre, lorsque la saison s'avance. Elles coiffent de leurs plumets, les buttes minuscules que le vent déchausse.
Sur les sols argileux et plus salés, aux abords du Chott Gerâa-Et-Tarf, poussent l'armoise blanche (artesemia), au parfum violent et aux prétendues vertus médicinales, souvent confondue avec le thym, le chih des Algériens, et le diss (arundofestucoides) dont on fait des ouvrages tressés, remplaçant l'alfa. La neige et la pluie s'accumulent en hiver, dans cette dépression mais l'évaporation transforme en couches de sel l'eau qui n'y séjourne ainsi qu'une courte partie de l'année.
En hiver, le vent s'établit au nord pour une longue période, figeant toute la nature et transformant les humains en fantômes enveloppés dans leurs burnous, courbés sous l'effort nécessaire pour le contrer et avancer.
A cette époque, les maisons n'étaient pas équipées pour lutter contre le froid, chacun cherchait un peu de réconfort autour de l'unique poêle dispensant un peu de chaleur, dans un volume restreint. L'air glacial s'engouffrait par toutes les interstices, et le seul vrai refuge était le lit où s'amoncelaient de lourdes couvertures en laine locale, mais dont on avait du mal à s'extraire au petit matin, dans la crainte de retrouver des pièces non chauffées, et surtout l'eau froide du robinet, pour une toilette redoutée.
Lorsqu'il neigeait, seul le devant des portes et une petite partie des trottoirs étaient dégagés. Le chemin de l'école empruntait le milieu de la chaussée, où la neige se verglaçait sous l'effet du vent de la nuit. Peu de véhicules roulaient, et le village était souvent isolé pendant plusieurs jours. Les trains eux-mêmes circulaient par intermittence, en raison des congères bloquant les tranchées de la voie ferrée. Début 1945, je repartis vers Constantine par le train, la route étant bloquée. A partir d'Ouled Rahmoun, le train venant d'Alger étant complet, Charlot Xicluna, de retour de permission, resta avec moi sur le marche pied enneigé d'un wagon, et me cramponna par le bras jusqu'à Constantine.
Face aux éléments tout était suspendu, chacun se faisait une raison, espérant que cette neige abondante était, inch'Allah! le présage d'une bonne récolte.
La gare par Djamel Louafi
le plein d'eau des locomotives
La gare
Agriculture... agriculture...
Dans la région d’Aïn-Beïda, l'agriculture était quasiment inexistante avant l'arrivée des Français. Les Chaouïa de la tribu des Haracta étant essentiellement des nomades éleveurs de moutons, ne cultivaient que de rares portions de leur territoire. Ils utilisaient une araire ou charrue "arabe", comme on pouvait en voir encore dans les vignobles du Midi de la France.
Tirée par un âne ou un mulet, elle était constituée d'une longue branche fourchue, dont une petite partie taillée grattait le sol pour l'amender. Les résultats étaient proportionnels au moyen employé, c'est-à-dire bien maigres.
Les Européens introduisirent les charrues métalliques avec mancherons de direction, et tirées par des bœufs ou des chevaux co-attelés. Un coutre découpait la terre tandis qu'un versoir la retournait, et qu'un soc la tranchait horizontalement.
Le système se modernisa au fil du temps avec la mécanisation. Les charrues Brabant simples puis doubles firent leur apparition.
Les années quarante virent le développement de la puissance des tracteurs, permettant l'utilisation de charrues défonceuses, labourant profondément le sol. Le nombre de socs sera multiplié, réduisant la quantité de passages pour une même surface labourée.
Le soin apporté au traitement des champs fut accru avec l'utilisation de machines spécialisées, déchaumeuses aux contres circulaires, et herses brisant mécaniquement les mottes, permettant d'obtenir des surfaces "propres" dès la fin des moissons, afin de recueillir la moindre pluie d'été.
Avant la mécanisation, on put voir dans les champs labourés, les semeurs isolés ou en ligne de quatre ou six, avancer d'un bon pas, en projetant amplement les grains puisés dans leur sac de toile porté en bandoulière. Personnages familiers des Hauts-Plateaux, la monotonie de leur geste inspirait à la fois sérénité et mélancolie.
Plus tard, les semoirs tirés par des tracteurs les remplacèrent. Heureusement pour la nostalgie, certains continuèrent leur tâche sur des emprises de faible surface, et des parcelles trop escarpées pour les tracteurs.
Après les travaux de labourage et les semailles, une période de répit commençait dans l'activité des champs. On ne voyait plus dans la campagne, que des troupeaux de moutons et de chèvres, les bovins restant aux abords des fermes. Une longue attente marquait la vie des agriculteurs et par conséquent, celle de l'ensemble de la population.
Toute l'attention était désormais tournée vers le ciel. Comme il n'existait pas de prévisions météorologiques, les pronostics sur l'humeur du temps devenaient, comme chaque année à pareille époque, le sport favori pratiqué par les membres des trois communautés quelle que soit leur profession.
Lorsque par malheur, la sécheresse s'installait pendant un cycle de plusieurs années, comme ce fut le cas durant la guerre, on voyait errer dans la campagne, de pauvres gens à la recherche de la moindre herbe, pouvant se substituer misérablement aux céréales devenues inaccessibles.
À Aïn-Beïda, la vie économique s'assoupissait et les affaires étaient "au point mort". Chacun se demandait comment "tenir le coup". Une année agricole devait se passer avant que ne se manifeste la moindre reprise, à condition que la pluie fît sa réapparition.
Les agriculteurs qui avaient eu la chance de faire de bonnes récoltes, pendant quelques années consécutives, et d'épargner une partie de leurs revenus, espéraient pouvoir attendre. Les autres devaient emprunter, hypothéquer et souvent vendre une parcelle de leur exploitation.
Les Algériens dans leur majorité, souffraient plus que les autres, en raison de leurs revenus plus faibles et de leur mentalité moins encline à la prévoyance. Ils s'en remettaient au ciel pour pourvoir à leurs besoins vitaux."Allah pourvoira !"
Cependant, lorsque leur attente avait un peu trop duré, un vendredi, un groupe d'impatients sortaient de la Mosquée en cortège, portant un immense drapeau vert psalmodiant la "Châada" :"La ilahaill Allah ou Moh'ammedRassoulAllah","Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohamed est son prophète", et frappant sur des tambourins en cadence.
La procession faisait le tour du village, quelques mendiants en profitaient pour récupérer au passage, des aumônes bienvenues en ces temps de disette. Malheureusement, le Bon Dieu ayant déjà planifié ses bienfaits, et cette cérémonie n'avait que peu d'effet sur la pluie. Elle permettait cependant, de diminuer un peu l'angoisse des Croyants.
Enfin, un matin les nuages se décidaient à interrompre leur voyage vers ailleurs et éclataient sur le village et sa région. On pouvait voir toute la population admirer béatement ce phénomène, comme si c'était la première pluie du monde. Les enfants, très longtemps privés, tendaient leur visage et leurs mains vers le ciel, pour en recevoir leur part de miracle. Ils pouvaient patauger joyeusement dans les flaques, sous le regard bienveillant des adultes qui se reprenaient à espérer.
Souvent, il ne s'agissait que de pluies d'orage, qui se répandaient violemment sur le sol desséché, et rapidement, gonflaient les oueds et couraient dans la plaine , rencontrant sur un chemin improvisé, des troupeaux conduits par des bergers inconscients de la montée des eaux. Le flux puissant emportait tout sur son passage, bêtes, arabas, mulets et gens, aggravant encore la situation, et la changeant en désastre.
Lorsque le ciel dans sa bonté, avait dispensé tout au long de l'année, avec régularité la pluie espérée, on voyait au printemps, reverdir la campagne. Au fil des jours, les céréales hissaient hors de terre de fines feuilles, que les agriculteurs observaient quotidiennement, guettant la moindre progression et s'inquiétant du moindre jaunissement.
Le spectacle de la nature faisait l'objet de la contemplation générale. Tandis que les champs ensemencés prenaient une teinte uniforme, les parcelles laissées en jachère se couvraient pour une gloire éphémère, de fleurs aux couleurs variées, pâquerettes blanches et rosées, centaurées bleues, gentianes jaunes, coquelicots rouge sang et campanules violacées. Sur les bords des fossés, triomphaient des chardons somptueux d'argenture, rivalisant de hauteur avec des asphodèles, dont les têtes blanches attendaient le souffle du vent, pour disperser dans l'air leurs étamines diaphanes.
Le Bordj
Ain-Beida sous la neige
Ain-Beida sous la neige
Les langues tout à coup se déliaient. Ceux que les soucis du temps avaient enfermés dans le silence, retrouvaient le goût de converser. Les liens suspendus se renouaient. Mais, le sujet de toutes les conversations était toujours le même, la récolte. Le ciel allait-il continuer de se montrer clément? Chacun avait-il vraiment labouré au bon moment? Puis semé..? Puis hersé..? Puis roulé..? N'aurait-il pas mieux valu cette année, choisir telle parcelle plutôt que d'ensemencer telle autre..? Comme il n'y avait plus qu'à attendre, que le cycle des saisons s'accomplît, tous avaient le temps de ruminer et de s'angoisser malgré tout.
Quand, par bonheur, la végétation parvenait à un développement idéal, on se prenait à redouter qu'à la fin du printemps ou au début de l'été, un orage de grêle ne réduisît d'un coup les espoirs de toute une année. Trop de tension minait la raison...
L'heure des moissons sonnait enfin. Les travaux s'effectuaient alors, dans une ambiance de bonheur retrouvé. Tôt le matin, les moissonneurs prenaient la route des champs. Ils étaient à pied d'œuvre avant que le soleil ne se lève. Pourtant, le jour éclairait déjà l'horizon de lueurs roses et jaunes.
Les hommes se déployaient en larges lignes, et avançaient sans relâche, pressés d'abattre le plus de surface, avant que la chaleur torride ne vienne ralentir leur effort. Des tas formés de gerbes marquaient leur passage. Sans attendre, lorsque la saison était très avancée, une charrette suivait et le ramassage s'effectuait. Mais plus généralement, les tas restaient dans les champs, permettant une meilleure dessiccation des épis, et aussi, abritant les couvées de cailles qui malheureusement, seraient débusquées par les chasseurs, une fois les moissons terminées.
Près de la ferme, sur l'aire à battre, la locomobile était installée, et le combustible, bois ou briquettes faites de coke et de goudron, s'entassait. Cette grosse machine ressemblant à une locomotive, fit longtemps partie du décor des campagnes des Hauts-Plateaux.
Montée sur quatre roues, deux grosses à l'avant, et deux plus petites à l'arrière, elle était constituée d'une chaudière avec un énorme foyer, et de serpentins qui conduisaient la vapeur vers un cylindre, dans lequel se déplaçait un piston. Celui-ci faisait tourner deux roues surélevées, dont l'une servait à équilibrer la seconde qui animait la courroie transmettant la force à la batteuse.
Celle-ci était une espèce de charrette carénée. Elle était alimentée en gerbes de céréales, par une table d'approvisionnement située sur son toit. Un batteur broyait les épis les grains passaient par un contre batteur, et s'écoulaient dans une cheminée, vers un plan incliné, tandis que la partie non traitée circulait jusqu'à des secoueurs mobiles puis, rejoignait les grains déjà traités, dans le bas de la structure. Là, un tarare la ventilait, et projetait les impuretés à l'extérieur.
Tandis que les grains passaient dans un second tarare, qui assurait un nettoyage complet, la paille séparée dès le premier circuit, s'évacuait pour être assemblée en bottes compactées puis liées.
Les ouvriers qui alimentaient la batteuse avaient la tâche la plus dure. Il leur fallait prendre à la fourche les gerbes, et les projeter en l'air, en direction de la table d'approvisionnement. Ce travail de force s'effectuait par une température élevée, et dans une atmosphère remplie de fines particules de paille et de balle de céréales. Ils se protégeaient tant bien que mal, en portant des lunettes hermétiques et en enveloppant leur tête dans un chèche.
"Espicadora"
Une batteuse
Avec la mécanisation, on vit ces grosses locomobiles abandonnées sur les aires devenues, elles aussi, inutiles. Elles rouillèrent tristement, et un jour, disparurent du paysage agricole. Aujourd'hui, on en voit figurer dans certains films britanniques, comme un symbole de l'activité des campagnes.
Ces puissantes machines furent remplacées par des moissonneuses-batteuses automotrices. Sur leur avant, tournaient des rabatteurs d'épis propulsant les tiges vers des barres de coupe. Une vis sans fin les dirigeait sur un convoyeur interne. Elles subissaient alors, un cycle analogue à celui des batteuses traditionnelles. Les grains étaient ensachés automatiquement après ventilation, tandis que la paille était conditionnée par une presse.
L'utilisation des moissonneuses-batteuses accélérait bien évidemment, les travaux mais, réduisait considérablement la main d'œuvre. Dans une région uniquement agricole, cela n'allait pas dans le bon sens sur le plan social. La mise rapide sur le marché de la récolte nouvelle était un facteur important, surtout en période de production quantitativement médiocre, les "ruptures de stock" favorisant la disette.
Il était cependant nécessaire de bien préparer les champs, afin que les barres de coupe puissent descendre très près du sol. Certains agriculteurs entreprirent de débarrasser régulièrement leur terrains des cailloux qui tendent à remonter en surface après chaque labour, force centrifuge oblige...M Siméon, garagiste converti à l'agriculture, fut le premier à se livrer à ces travaux, malgré les ricanements des sceptiques. D'énormes tas de pierres flanquèrent ses champs. Il en tira un double profit, par les rendements en récolte obtenus, et par le produit de la vente aux Ponts et Chaussées, de la caillasse nécessaire à la réfection des routes.
Pour tous, il devint évident que les temps de l'agriculture d'avant-guerre étaient accomplis. Mais, ceux qui ont grandi dans un tel pays, gardent un respect profond pour la nature dont ils connaissent les caprices, et les tourments qu'ils occasionnent aux agriculteurs. Ils ne pourront jamais regarder comme une denrée banale les céréales "transformées" pour la consommation quotidienne. Rien ne sera jamais plus emblématique pour eux, que l’image de la mère pétrissant de la pâte avec la farine issue du blé du bled.
Il faut souligner que parmi les concessionnaires urbains du village d’avant 1870, figuraient tous les patronymes juifs qui nous sont familiers : Allouch, Attali, Cohen, Doukhan, Guedj, Nakach, et Zerbib, tandis que parmi les premiers Européens, seuls Balmély, Gesta, Mosca, et Xicluna étaient encore Aïn-Beïdéens dans les années trente et quarante.
La déchra
Plein Est du village, un quartier particulier, la "déchra", était formé de maisons en pisé. Ses habitants étaient les descendants de noirs emmenés en esclavage, au temps des Turcs. La population les appelait les "Soudani" bien que leur origine géographique fût incertaine mais par référence à "Es Soued", Noirs en arabe. Malgré leur pauvreté, ils avaient une grande joie de vivre contrastant avec l'austérité des autres Algériens.
Les hommes, secs et robustes, exécutaient des travaux de force, tandis que les femmes servaient le plus souvent de lavandières. Comme dans les pays d'Afrique noire, leur vie communautaire était très développée.
Ils profitaient de la moindre occasion pour chanter et danser. Les "bendirs","derboukas", "raïtas"et autres instruments à percussion improvisés, retentissaient souvent des nuits entières, faisant un bruit de fond que la police tolérait, en raison de son éloignement du centre du village.
Lorsque le Ramadan tombait à la belle saison, les ruelles de la "déchra" ne désemplissaient pas jusqu'à l'heure de la dernière collation de la nuit. Sitôt les premières lueurs de l'aube, le calme enveloppait tout le quartier. Il fallait attendre le coup de canon de la rupture du jeûne pour que l'animation renaquît.
C'était pour les fêtes musulmanes que l'on pouvait se rendre compte de la particularité de la mentalité de ses habitants. On assistait à une débauche de couleurs de vêtements, et une ambiance de carnaval régnait pendant plusieurs jours. Il devenait impossible de décider quelqu'un à travailler. Cependant, la dure loi de la vie reprenait rapidement le dessus, et tout finissait par rentrer dans l'ordre. Avec la guerre, des Chaouïa vinrent des campagnes, espérant mieux vivre dans le village. Ils s'établirent dans la "déchra", et progressivement, les choses changèrent. La bonhomie disparut et la pauvreté devint triste et bientôt sinistre.
Deux personnages issus de ce quartier, occupaient une place particulière dans la vie d'Aïn-Beida.
Le premier allait à travers les rues, de maison en maison portant un encensoir en fer, suspendu à de lourdes chaînes. Il le balançait régulièrement, répandant une odeur de bois de santal et d'encens. Il accompagnait son geste des formules rituelles de bénédiction et repartait, en serrant dans une petite "diébira", les pièces de bronze que l'on ne manquait pas de lui donner.
Le second était beaucoup plus légendaire. C'était "Négro-Batata". À la fois derviche, musicien et bateleur, il était revêtu d'un sarouel et d'une espèce de chemise, sans manche et sans col. Une ceinture de queues de chacals et de renards enserrait sa taille. Il portait un grand chapeau berbère décoré de petits miroirs, de grelots et de longs fils sur lesquels étaient fixés des pompons multicolores.
Il frappait avec un bâton recourbé, terminé par une boule sur un tambour, et martelait du pied le sol. Tournant et virevoltant, il tirait la langue et roulait ses gros yeux, dont le blanc contrastait avec le noir de son visage. Parfois, il soufflait dans une espèce de cornemuse faite d'une raïta fixée à une outre en peau de chèvre. Il présentait aux enfants l'image redoutée de l'effrayant personnage chargé d'emporter les méchants garnements, qui désobéissaient aux parents.
Il prenait soin de déposer sur le sol, une petite sébile en cuivre oxydée de vert de gris, dans laquelle nos parents nous forçaient à déposer une petite pièce, afin de prendre une assurance sur les conséquences de la prochaine bêtise, que l'on ne manquerait pas de faire. Il perdit à mes yeux, toute sa force de dissuasion, lorsque je le reconnus un jour, dans ses fonctions quotidiennes de pacifique portefaix.
Ces deux personnages ne survécurent pas à la guerre. Comme s'il fallait que tout folklore dût disparaître. A la réflexion, après tant d'années, aucune explication ne peut être trouvée à cette lente évolution psychologique de toute une population. Est-ce les difficultés économiques, les "insufflations" de la politique dans les esprits des Algériens, ou tout simplement, l'évolution dérivante des mœurs qui fit qu'ils craignaient désormais d'être en butte à la dérision ? Je n'ai pas trouvé la véritable raison de cette dégradation des choses dont en temps réel, personne ne s'est vraiment rendu compte.
Le cinéma
J'ai évoqué le précurseur du développement du cinéma, M.Gabarre. Mais, il a rapidement eu un concurrent en la personne de M. Allaoua Benkedèche. Originaire de Canrobert, centre trop petit pour un entrepreneur plein d'ambition, il choisit Aïn-Beïda pour donner libre cours à son esprit d'entreprise. Il marquera la "vie artistique" du village et de la région.
En effet, il copiera l'idée du cinéma ambulant de M.Gabarre, en y ajoutant une dose d'improvisation permanente. Toute sa carrière pourrait s'intituler "Les impromptus d'Allaoua".
Il sera le roi des rendez-vous manqués, car tantôt à cause des pannes du véhicule trimbalant son équipement, tantôt en raison de la mauvaise qualité des copies des films présentés. Au fil des soirs, les séances étaient annulées, différées ou écourtées. Après chaque faillite technique et financière, il disparaissait pendant quelques mois, voire quelques années, puis réapparaissait avec de nouveaux projets et un nouvel équipement toujours précaire. Et le miracle se produisait à nouveau, les clients revenaient, lui faisaient confiance et cent fois encore, se voyaient entraînés dans de nouvelles tribulations pelliculaires.
Sa dernière aventure fut la création au sortir de la guerre, d’une salle toute neuve, dont la programmation annoncée défiait toute concurrence. Je n'ai pas su comment cela s'était terminé, car je vivais déjà éloigné du village.
J'ai pourtant, une foisassisté à une séance au cours de laquelle on projetait un film à suspense. Malgré les nombreuses coupures dans la projection, le rallumage de la salle qui s'ensuivait et le concert des sifflets, le public patientait pour connaître la fin de l'action qui malgré tout l'avait captivé.
Au bout de la quatrième interruption, on vit apparaître notre Allaoua, rendu tout ébouriffé par les travaux auxquels il se livrait dans la cabine de projection qui d'une voix de stentor pour couvrir les huées, s'écria :"Y’a rien à faire…J’peux plus réparer, la séance, elle est finie ... mais qua même, je vous dis la fin…vous savez le grand barbu... eh ben, c'est lui qui a tué !" et il disparut sans attendre son reste dans la crainte d’être contraint de rembourser.
C'est vers 1935, que le premier “ vrai ” cinéma s'était installé dans la Salle des Fêtes récemment construite. On dut tout de suite, draper sur le plafond des vagues de tissu car l'acoustique était mauvaise. Le "Régent" fut le nom dont le baptisa M.Rey, un entrepreneur algérois.
Le balcon et le fond du parterre étaient réservés aux familles et aux gens"sérieux". Les premiers rangs à faible tarif recevaient le reste de la clientèle.
La foule des enfants algériens, des "yaouleds", enfants pauvres et petits cireurs, et des adultes peu argentés occupaient les premiers rangs. Chaque travée comportait une série de sièges à bascule solidarisés. Ces rangées pouvaient être enlevées pour disposer d'une salle nue, et leur remise en place comportait souvent quelques mauvaises manipulations. En cas de surcharge ou de gesticulation, l'ensemble cédait sous l'effort et s'effondrait dans un grand fracas.
C'est ce qui arrivait lorsqu'une séquence entraînait une participation trop intense du public à l'action du film. Les gosses tapaient des pieds au rythme du galop des chevaux, ou se hissaient sur la partie mobile de leur siège, et tout se répandait brutalement.
Ceux qui voulaient ne rien perdre du film, se mettaient alors debout, obstruant le champ de vision des rangs suivants, et le projectionniste était contraint d'interrompre la séance, pendant que la police évacuait les perturbateurs, qui s’efforçaient de revenir assister à la fin de la séance.49
Le public était surtout, friand de films d'action, mais ceux-ci comportaient toujours des séquences plus lentes dans lesquelles systématiquement, le "jeune homme" embrassait la "jeune fille", ou bien le "méchant" avançait à pas de loup, pour surprendre le "gentil". C'est là que se déclenchaient les commentaires du parterre, hurlements et sifflets dans le premier cas, et avertissements dans le second. Et lorsque la bagarre éclatait enfin, les travées s'effondraient, renouvelant un processus immuable.
Les spectateurs algériens ne comprenaient pas tous le français, à cause du vocabulaire trop recherché, ou des accents différant de ceux auxquels ils étaient habitués. De même, comprenaient-ils mal l'arabe des films égyptiens. Fort heureusement pour eux, et au grand dam des autres spectateurs, de place en place, un traducteur synthétisait les dialogues en les accompagnant au passage, de ses commentaires ... Cela ne manquait pas de sel, surtout lorsqu'il s'agissait d'interpréter de surcroît, les sous-titres français des dialogues arabes .
L'engouement pour le cinéma était tel que toute la population, sans distinction d’origine, allait voir ces films égyptiens, dont les thèmes étaient toujours les mêmes, que l'histoire fût moderne ou bédouine. L'action s'interrompait sans cesse, pour laisser chanter les vedettes. Ces chansons devenaient ensuite, des rengaines que les phonographes à pavillon des cafés maures, hurlaient dans toutes les rues d'Aïn-Beïda.
Les artistes préférés du public étaient Oum Keltoum, Abdel Wahab et Farid ElAttrache. Mais, c’est un film tunisien qui obtint un succès foudroyant, et resta dans toutes les mémoires. Son titre était "Le fou de Kairouan". Il faut dire qu'il présentait l'avantage d'être dans un dialecte que tous comprenaient, et son humour était celui que chacun pratiquait.
Le 14 Juillet
Le 14 Juillet représentait la principale occasion pour Aïn-Beïda, de prendre un air de fête populaire. On épiloguera plus tard, longuement sur le côté "patriotard" des gens d'Algérie. Il est certain qu'il fallait peu de choses pour que l'esprit cocardier se manifestât dans le village. Et la Fête nationale qui tombait bien heureusement, au moment où s'étaient achevés les travaux de la récolte, constituait la meilleure occasion pour tous, de se détendre.
Durant la semaine qui précédait le 14, des travaux préparatoires avaient lieu dans tout le village. Des mâts tricolores étaient dressés sur le bord des rues principales, et des guirlandes de petits drapeaux étaient tendues entre eux. Autour du Cours Willigens, une haie de fines lattes de bois délimitait la future piste de danse. Elle permettrait de tenir à distance la foule des gosses, qui voudrait ne rien perdre du spectacle des danseurs.
Le Monument aux Morts était lui aussi largement pavoisé, ainsi que les bâtiments publics. La Mairie et les écoles étaient ornées d'écus avec trois drapeaux tricolores.
Le 13 au soir, avait lieu la retraite aux flambeaux, à laquelle participaient "l'Harmonie des Haracta" et une foule d'enfants attirés par les feux de Bengale illuminant les trottoirs et les façades des maisons. Les sportifs de la J.S.A.B étaient mobilisés, pour porter les longs bâtons auxquels étaient suspendus des lampions de papier.
Les rues du village semblaient métamorphosées par le tremblotement des lumières, et le cortège d'ombres qu'elles projetaient vers les murs et les arbres. Une fumée de couleur amarante enveloppait le défilé, et le spectacle ainsi donné réjouissait nos cœurs et exaltait nos sentiments patriotiques.
Le matin du 14 Juillet, très tôt, la Nouba du 3è. Régiment de Tirailleurs Algériens commençait sa ronde pour donner l'aubade au Maire, au Commandant d'Armes et aux personnalités. Nous avions la chance d'habiter non loin du Maire et de M. Zedda, son premier adjoint de l’époque. Nous profitions donc de deux aubades.
Les musiciens arrivaient au seul rythme des tambours, et prenaient place en face de la maison. Ils portaient la tenue de tradition, pantalon ample à plis bleu et guêtres blanches, gilet bleu à soutaches jaunes, ceinture de flanelle rouge garance, chéchia rouge recouverte d'un turban orné de l'insigne de cuivre, croissant et étoile à cinq branches portant la devise en lettres arabes "Hata el mout" "Jusqu'à la mort".
Ils jouaient un premier air assez court puis, le Maire apparaissait à son balcon, et les saluait à la manière militaire. La Nouba exécutait alors, une marche régimentaire. L'aubade terminée, elle repartait au son des tambours, poursuivant son tour du village.
A dix heures, avait lieu la cérémonie au Monument aux Morts, dont le rituel traditionnel comportait un dépôt de gerbes, l'appel des Morts de la Guerre de 14-18, la sonnerie aux Morts et la minute de silence et enfin la Marseillaise.
Avant une cérémonie aux monument aux Morts en 1941 le conseil municipal devant la boulangerie Murienne : Messieurs Benaboud-Coppolani-Zedda maire et Dr. Boumali (derrière les deux agents de police
Le même groupe de devant l’Hôtel d’Orient
M.Allaoua Boudjabi (Mai 2013 : 92 ans)
JSAB : Légende par G.Coppolani
Debout (de gauche à droite) : Charlot Xicluna-Lucien Faletti-x-Allaoua Boudjabi-Paul Vigo-x.
Accroupis 2ème rang (de gauche à droite) : x-Charloi- x
Premier rang (de gauche à droite) : x-Paul Follacci-Rémi Faletti
Les Anciens Combattants de toutes origines, participaient à cette cérémonie entourant leur porte-drapeau, un algérien grand mutilé de guerre. Des délégations d'enfants des Ecoles y assistaient, accompagnés par leurs instituteurs et leurs institutrices. Un détachement de Tirailleurs en tenue kaki encadrait le Monument sur trois côtés. Les enfants n'avaient d'yeux que pour leurs longs fusils Lebel, surmontés de longues baïonnettes. La foule des spectateurs restait à l'extérieur, derrière la bordure de balustres de pierre.
Sitôt la cérémonie terminée, la foule refluait vers le Cours pour assister au défilé militaire.
Précédant la troupe, le Goum des Haracta était conduit par l'Agha Brahim Benbouzid. monté sur un alezan, il portait sa tenue de Capitaine de Spahis, vareuse rouge aux manches ornées de trois galons, montant en pointe jusqu'à quelques centimètres de la cassure du bras, double burnous blanc dessous et rouge dessus, aux capuchons reposant sur les épaules.
Il tenait de la main droite, son sabre verticalement, les rênes à peine maintenues de la main gauche. Il chaussait des bottes de filali couleur rubis, les pieds engagés dans des étriers traditionnels d'argent massif. La petite selle de cuir, sur laquelle il était assis, reposait sur un tapis ovale bordé de soutaches rouge et jaune.
Il portait un chapeau berbère à larges bords surmonté de plumes d'autruche faisant comme un haut bonnet frissonnant dans le vent relatif. Tous les cavaliers du Goum portaient la même coiffure dont l'usage se perdait dans la nuit des temps.
Les autres cavaliers le suivaient sur trois files, montés sur des barbes gris. Enveloppés dans des burnous noirs, ils tenaient leur carabine de cavalerie en travers de la selle, à la mode arabe.
Les chevaux marchaient d'un pas nerveux mais retenu, donnant à leur escadron une allure impressionnante de puissance maîtrisée.
Dès qu'ils avaient disparu, la Nouba entamait la "Marche du 3è.R.T.A" et le défilé militaire commençait.
Devant les musiciens, marchait un magnifique bélier blanc, portant sur le dos, un tapis bleu soutaché de jaune et marqué de part et d'autre de l'insigne du régiment. Ses cornes étaient dorées et sa toison peignée. Il avançait sans être guidé, connaissant le parcours que le défilé devait emprunter.
Les instruments étaient essentiellement des tambours, des raïtas et des clairons. Au milieu des musiciens, marchait le porteur du "chapeau chinois", un instrument à percussion constitué d'une longue hampe coiffée d'une calotte ressemblant à un chapeau asiatique, à laquelle étaient suspendues des clochettes. L'ensemble était paré de deux queues de cheval évoquant les trophées rapportés du combat. Le musicien scandait la marche comme avec des cymbales, les clochettes sonnaient en cadence, tandis que les crins volaient dans le vent.
Les soldats marchaient jusqu'à la fin du boulevard Magenta, puis, revenaient le long du Cours, avant de rejoindre leurs casernes. La population ne ménageait pas ses ovations, appréciant un spectacle qui ne se reproduirait pas avant le prochain Onze Novembre.
Spahi des goums des Haracta en 1914
pendant la bataille de la Marne.
Défilé dans les années 30. Le maire
Dr Willigens à droite du drapeau
En fin d'après-midi, lorsque la chaleur se faisait un peu moins lourde, les jeux commençaient. Tout d'abord, une course à bicyclette réunissait tous les "Lapébie" et "Vietto" en herbe. Ceux qui ne possédaient pas de vélo, les petits algériens en particulier, pouvaient en louer chez Lalouani, le "cycliste" de la rue de Khenchela. Le Tour de France battant son plein, chaque enfant se prenait à rêver d'exploit. La course se déroulait selon un circuit à l'intérieur du village. Le vainqueur recevait un petit agneau, dont il semblait rapidement, bien embarrassé. Mais, la gloire dont il se trouvait auréolé durerait jusqu'à la prochaine Fête Nationale.
Le concours suivant était le mât de cocagne. Un poteau téléphonique en bois était planté sur le Cours. Il était enduit de savon noir pour le rendre très glissant. Le jeu consistait à grimper le plus haut possible, jusqu'au point d'attache de la prime, un petit sac contenant des friandises. Malgré leur agilité et un entraînement quotidien dans les arbres, les gamins avaient beaucoup de difficulté à monter au-delà de la moitié du mât.
Les nombreuses tentatives produisaient la disparition du savon augmentant ainsi, les chances des derniers candidats. Le plus malin, souvent le plus patient, qui s'était mis en queue de la file d'attente, réussissait à remporter le prix. Il lui restait ensuite, à se débarrasser de ses copains malchanceux qui tenaient à partager le contenu du sac.
Le clou de l'après-midi était deux jeux pour lesquels des fils étaient tendus entre des poteaux.
Pour le premier jeu des marmites de terre y étaient suspendues. Il fallait, les yeux bandés, frapper et casser les poteries avec un bâton. Les unes contenaient de l'eau et les autres du sable ou des pièces de monnaie. Naturellement, la foule conseillait et guidait les joueurs. Ceux-ci étaient pris entre le désir d'écouter leurs "complices" et la crainte d'une "trahison". Prendre une douche, en cette saison, n'était pas une épreuve redoutable, mais, le souci de gagner à moindre risque incitait à la prudence, car il était désagréable de recevoir un flot de sable sur un corps mouillé de transpiration.
Pour le second jeu, des poêles à frire étaient pendues sur les fils. Elles étaient enduites de noir de fumée, et en leur milieu, une belle pièce de monnaie de cent sous était collée. Les mains liées derrière le dos, les joueurs devaient à l'aide de leur seule bouche, tenter de récupérer la pièce.
Les candidats étaient pratiquement tous, des enfants pauvres habitant la "déchra", que la coloration de leur peau mettait largement à l'abri du ridicule de se retrouver le visage noir de suie.
La jovialité et l'habileté grimacière de ces yaouleds créaient lors de ces jeux une véritable ambiance de cirque. Les spectateurs contribuaient à la fête par leurs lazzis. Ils faisaient preuve de cocasserie dans leurs commentaires Certaines formules restaient par la suite accrochées aux gamins, comme des surnoms dont ils n'arriveraient plus à se défaire.
Le soir venu, le Cours était débarrassé des installations utilisées pour les jeux, des débris de poteries et des traces diverses résultant de l'activité de l'après-midi. La place devait être nette pour que les couples puissent évoluer toute la nuit. Les terrasses des deux cafés fréquentées par les danseurs et les simples spectateurs ne désemplissaient pas jusqu'à l'aube.
Le 15 Juillet, Aïn-Beïda se réveillait dans une agitation fébrile de remise en ordre. Toute la matinée était consacrée à enlever poteaux, drapeaux et barrières.
Les enfants assistaient avec regret à ces travaux, car ils savaient qu'il leur faudrait attendre longtemps avant de revoir de telles festivités.
Seule la fête champêtre du "Petit cheminot à la montagne", organisée par les employés des Chemins de Fer d'Algérie, mettait une ambiance joyeuse dans le quartier de la Pépinière, où elle se tenait à la mi-Août. Ils s'agissait d'une kermesse avec baraques foraines comportant des jeux des anneaux, de la pêche "miraculeuse" et des tombolas diverses.
Il y avait aussi un stand de tir à la carabine. Ma mère était très adroite à ce jeu, et elle gagnait chaque fois, le concours réservé aux dames, ce qui me remplissait d'une légitime fierté. J’en ai conservé précieusement, un petit réveil ‘Jaz’ de 1936, qui a renoncé depuis des années, à marquer le temps qui s’est pourtant écoulé…malgré lui ! Un bal clôturait cette fête qui attirait du monde venu de toute la région.
La guerre fit disparaître ces réjouissances populaires, ces dernières à cause de la réduction de l'activité des Chemins de fer et du nombre de cheminots pouvant participer à son organisation.
Quant au 14 juillet, seule restait la cérémonie au Monument aux Morts réduite au minimum en l'absence de garnison depuis 1945.Un bal avait néanmoins lieu tantôt sur le Cours et tantôt sur la place à côté de l'Eglise. Sans être inclus dans d'autres activités ludiques, il attirait toujours autant de monde.
Monument aux Morts 14/18
Les transports par car
Avant la guerre de 39-45, les déplacements s'effectuaient par le train, surtout quand il s'agissait de voyages longs. Mais les gens qui se rendaient dans les villages environnants et à Constantine ou Bône, empruntaient l'autobus baptisé "car" dans la terminologie locale.
Les lignes Constantine-Aïn-Beïda-Tébessa et Khenchela étaient desservies par une grande société l’ATAN "l'Auto-traction de l'Afrique du Nord". Elles seront ultérieurement, rachetées par un entrepreneur local, Chentli Salah, qui les développera très largement. Elles avaient un rôle important car elles assuraient aussi le transport du courrier et des journaux.
D'autres entreprises offraient leurs services sur les lignes vers Sédrata et Souk-Ahras (Bendada Hocine), La Meskiana (Debrincat et Dokhan), Khenchela (Messous Salah ) et Oued-Zenati-Guelma-Bône (Bensiahmed Salah et Negli Tahar). Cette activité de transport n'employait que des Algériens. Elle enrichit pratiquement tous ses entrepreneurs.
Je prenais le car pour me rendre au Lycée à Constantine et en revenir pour les vacances. Pendant la guerre couvrir les 110 kilomètres séparant Aïn-Beïda du chef lieu était une véritable expédition.
Les véhicules de transport de voyageurs avaient été transformés pour fonctionner au gazogène. L'installation du lourd fourneau sur l'avant droit, recevant le bois ou le charbon, avait réduit les performances des machines. En outre, l'alimentation en gaz pauvre ne permettait plus aux moteurs de tirer aisément des véhicules en surcharge permanente. La rareté des transports conduisait en effet, à remplir non seulement, l'intérieur de la cabine, mais encore, à entasser sur l'impériale, voyageurs et bagages. Il fallait que les Chaouïa fussent robustes pour voyager dans de telles conditions, sous la pluie, dans le vent glacial de l'hiver, et sous le soleil implacable de l'été.
Fort heureusement, le convoyeur receveur avait pitié des Européens et les regroupait toujours à l'avant, à l'abri de tout encombrement. On mettait de quatre à cinq heures pour faire la route. Cela obligeait à partir tôt le matin, vers 5 heures 30, afin que le car pût faire un aller-retour dans la journée.
Je me souviens de l'angoisse qui m'étreignait la veille du départ, les vacances terminées et toute cette liberté à laquelle il fallait renoncer, pour vivre loin des miens, en internat dans un Lycée datant du milieu du XIXè siècle, austère et froid. Cette angoisse était largement partagée par ma mère. Elle ne s'habitua d'ailleurs jamais, à une séparation qui ne faisait que commencer.
Dans ces années de guerre, le village était plongé dans un black-out aggravé par l'hiver. Le faible éclairage public faisait luire le goudron de la chaussée, souvent recouvert de gelée blanche ou même de verglas. Les murs des maisons étaient plongés dans une totale obscurité.
Le bureau des cars était situé rue Nationale, au-delà de la rue St-Athanase. Mon père portait ma valise, les mains engourdies sous l'effet du vent glacial soufflant sans interruption en cette saison. Je marchais à son côté, sans dire un seul mot. J'appliquais à la lettre, la recommandation de ma mère de "bien fermer la bouche pour ne pas prendre froid". Plongé dans mes tristes pensées, j'aurais été bien incapable de dire le moindre mot sans être submergé par les larmes.
Les hommes étaient en majorité assis sur le sol, dans une immobilité totale, le capuchon rabattu sur le visage.
Mon père achetait mon billet et faisait enregistrer ma valise, puis me rejoignait sur le trottoir au grand air. Certains voyageurs se tenaient près de la portière du véhicule, pour être sûrs d'embarquer, précaution qui s'avérait toujours inutile.
Le chauffeur arrivait enfin, peu avant l'heure du départ. Il s'installait posément sur son siège, et avec l'air de quelqu'un qui doutait du résultat de son geste, tirait vigoureusement la commande du démarreur. Celui-ci geignait puis l'on entendait des raclements et des crachotements, qui en disaient long sur la difficulté pour les pistons de se mettre en mouvement.
Dès qu'ils entendaient la machine ronfler, les voyageurs se précipitaient tous ensemble, en hurlant contre ceux-là mêmes qu'ils bousculaient. Le convoyeur se frayait un passage à travers les burnous, puis se retournait vers l'amoncellement laineux en équilibre instable, et d'un seul mouvement des deux mains, le repoussait vigoureusement, en proférant lui-même des invectives dans lesquelles n'étaient ménagés ni les pères, ni les grands-pères, ni aucun des ancêtres des candidats au voyage. Seule l'évidente menace de rester en plan avait finalement raison de l'impatience des invectivés. Tout à coup, le calme se faisait, et les visages burinés prenaient un air d'innocence enfantine.
Cependant, chaque voyageur recommençait à se prévaloir d'une attente de plusieurs heures, d'une destination ultérieure fort éloignée, voire d'une affaire très urgente à régler, pour tenter de se faire embarquer en priorité, mais personne n'écoutait personne...
Je restais à l'écart de la bousculade avec les autres Européens, et quelques Algériens policés. Cette attitude disciplinée était toujours récompensée par l’octroi des places situées à l’avant du véhicule.
Lorsque le car était plein, un certain nombre de voyageurs étaient chargés sur l'impériale avec leurs bagages. Le départ avait enfin lieu. Le véhicule s'arrêtait en chemin pour faire descendre ou embarquer un voyageur, mais aussi, pour laisser le moteur refroidir et respecter les escales dans chaque village.
A chaque voyage, les mêmes incidents se reproduisaient. Le plus fréquemment, le convoyeur se rendait compte qu'un resquilleur tentait de se faire transporter plus loin que prévu par son billet. Une empoignade avait alors lieu. Comme cela se passait souvent sur l'impériale, le contrevenant était expulsé sans passer par l'échelle .On restait étonné de voir l'homme se relever de sa chute prestement, et rassembler ses bagages qui avaient suivi le même chemin.
L'homme prenait à travers champ, non sans avoir adressé au convoyeur quelques injures, et en le menaçant à voix basse d’un mauvais sort, s’il lui arrivait de se trouver en panne, en pleine nuit, seul, quelque part dans ce bled perdu… Il espérait pourtant que celui-ci ne lui en tiendrait pas rigueur et qu'il pourrait une prochaine fois, prendre le car sans s'entendre reprocher son incartade et ses propos.
Nous arrivions toujours une demi-heure avant le départ. Le fourneau du car ronronnait déjà, et une foule de burnous attendait en silence dans LLesLMon
Il fallait là encore, toute l'autorité du convoyeur pour empêcher les voyageurs de se ruer vers les portières, d'un seul mouvement subversif, afin de fouler avant tout le monde, le pavé de la ville.
Je récupérais ma valise et je prenais la direction de la place de la Brèche puis par la rue Caraman et l'impossible rue de France encombrée de la foule habituelle dans laquelle dominait la communauté juive, je regagnais le Lycée, la bouche amère et l'humeur morose, comme tous les enfants contraints de vivre derrière les hauts murs gris d'un "bahut".
B.12, B.14, C.4 et Rosalie...
La dispersion des douars dans le bled, loin des grands axes, créait un courant de trafic important, entre le village et ces lieux d'habitation.
Aïn-Beïda disposait d'une importante "flotte" de taxis appartenant à des Algériens. La majorité était des Citroën de modèles des années vingt, B.12 et B.14, mais aussi des véhicules plus récents, C.4 et C.4F. Dès 1932, il y eut surtout les increvables Rosalie à "moteur flottant", au capot orné d'un bouchon de radiateur en forme de cygne, et à la calandre à fines baguettes chromées, portant le double chevron qui acquit une grande célébrité quand les Traction-Avant en furent équipées
Nombre de ces voitures circulèrent encore bien après la guerre, en compagnie des "11 cv." familiales et des "Vedette".
La majorité des taxis stationnaient dans le haut de la rue Montebello, derrière notre maison. Les clients venaient discuter longuement les conditions de leur transport. C'était un spectacle permanent auquel j'aimais assister. Il était fait d'allées et venues, d'hésitations, de marchandages, d'altercations, puis de tapes dans les mains pour sceller un accord. Les chauffeurs chargeaient sans scrupules un grand nombre de voyageurs. Leurs bagages souvent très encombrants débordaient des malles arrière peu conçues pour de tels chargements, et s'entassaient sur les porte-bagages des toits parfois en promiscuité caquetante ou bêlante.
Lorsque l'on circulait sur les pistes, on pouvait les voir arriver de loin, dans un nuage de poussière. Il valait mieux se ranger prudemment, pour les laisser passer car ils n'hésitaient pas à occuper toute la largeur du chemin, pressés de faire leur voyage dans le minimum de temps afin de pouvoir charger quelques nouveaux clients en attente au village.
Cependant, en ces temps bénis, si l'on avait la moindre panne, on était assuré que le premier taxi venu s'arrêterait. Son temps semblait tout à coup ne plus compter. Vous aider à réparer, toujours avec les risques de l'improvisation chaouïa, prévalait sur toute autre obligation. Devant les techniques employées, vous aviez beau protester, le dépannage vous était imposé. Vous vous exposiez ainsi à un bricolage qui laisserait perplexe votre mécanicien.
Cette envie de dépanner à tout prix était communicative. Pendant la guerre, l'essence était naturellement aussi rare que les autorisations de circuler. Mon père, ayant un besoin urgent de traiter une affaire à La Meskiana, obtint quelques litres du précieux liquide et un sauf-conduit.
Il y avait peu de circulation et il me laissa conduire. Dans une descente, nous vîmes avec un certain étonnement, une roue courir devant nous, et dans le même temps, la voiture se mit à tanguer. J'interrogeai mon père qui me conseilla de bien tenir le volant, et de freiner doucement. J'arrêtai et descendis chercher la fugueuse dans le fossé.
Mon père n'étant pas très versé dans l'art de la mécanique, commença à regarder d'un air désapprobateur, la fusée de la roue plantée dans le macadam. Un taxi arriva et m'emmena chercher du secours au village.
Lorsque après plusieurs heures, je revins accompagné d'un ami mécanicien, Lolo Casali, mon père finissait sa réparation. Comme le cric ne passait pas sous la carrosserie sur ses trois pattes, il avait ramassé des cailloux de différentes tailles puis, soulevant un peu plus chaque fois le véhicule, il les avait poussés, l'un après l'autre, du bout du pied sous le châssis.
La CitroënC4F
L’inoubliable Traction
La Cinq Chevaux Citroën Trèfle
Lorsque après plusieurs heures, je revins accompagné d'un ami mécanicien, Lolo Casali, mon père finissait sa réparation. Comme le cric ne passait pas sous la carrosserie sur ses trois pattes, il avait ramassé des cailloux de différentes tailles puis, soulevant un peu plus chaque fois le véhicule, il les avait poussés, l'un après l'autre, du bout du pied sous le châssis, jusqu'à ce que le cric pût enfin prendre sa place.
Notre ami, tout en le félicitant pour son ingéniosité, lui demanda s'il avait bien mis en place la clavette sur l'axe de la roue. Mon père n'avait pas pu voir qu'elle manquait car elle avait été sectionnée tout net. Il fallut démonter et remonter l'ensemble, ce qui prit peu de temps au spécialiste, mais démontra les limites de la méthode chaouïa.
On peut cependant, dire que c'est grâce à cette débrouillardise, et une certaine audace inconsciente, que bien des véhicules purent continuer de circuler, malgré les pénuries en tout genre. On vit ainsi, souder des bras de bielle raccourcis, et mettre des emplâtres boulonnés sur de vieux pneus de camion. Il fallait que "ça passe ou que ça casse", selon un principe qui aurait pu être chaoui garanti d'origine.
Fondouk et Achaba
Pour garer sa voiture, mon père louait une remise, derrière l'hôtel, dans l'enceinte d'un fondouk tenu par un kabyle. Passé le porche, on se trouvait dans une vaste cour dallée de pierres et entourée d'une série de préaux, pouvant accueillir de nombreuses têtes de bétail.
Dans la semaine, seuls quelques chevaux et un petit troupeau de moutons ou de chèvres y étaient hébergés. L'accès à notre garage était alors aisé. Mais dès le dimanche matin, commençait à arriver le cheptel qui devait être proposé au marché du lundi.
Il s'agissait surtout d'ovins serrés les uns contre les autres, bêlant longuement leur dépaysement, de chevaux et de mulets que l'on avait débarrassés de leur selle ou de leur bât et qui restaient sur leurs pattes, l'air pensif, la peau frissonnant par réflexe pour chasser les mouches, et frappant périodiquement le sol d'un sabot impatient. Il devenait impossible de rentrer ou de sortir la voiture, et en cas de besoin, il fallait anticiper et garer à l'extérieur.
Le lundi soir, l'enceinte vidée de ses occupants offrait un spectacle épouvantable... Il fallait tout le zèle du tenancier kabyle et de quelques aides, pour que ce lieu redevînt fréquentable.
A l'entrée du fondouk, une petite pièce obscure servait de logis à l'homme qui y vivait seul. Sur le sol en terre battue, une natte, un coussin et quelques couvertures l'accueillaient pour son repos.
Tout près de la porte, sur un kanoun toujours allumé, cuisaient à petit feu longuement des tagines, qui répandaient de bonnes odeurs, vous faisant venir l'eau à la bouche. Le Kabyle semblait passer son temps à préparer de savantes recettes, et près d'un demi-siècle plus tard, mon père évoquait encore dans les derniers jours de sa vie le spectacle du couscoussier de terre cuite vernissée dans lequel une graine blonde, parsemée de pois chiches et de tendres courgettes, et surmontée d'un morceau de collier d'agneau, qui cuisait délicatement dans la pénombre.
C'est dans ce fondouk, que je vis pour l'unique fois, une femelle de dromadaire blanche mettre bas. Ce fut un ravissement pour mes yeux d'enfant, de voir se redresser sur ses jambes trop longues, le nouveau-né titubant aussitôt, sous le regard frangé de longs cils de sa mère. Un long personnage, vêtu d'un grande gandourah noire, regardait d'un air attendri le couple installé sous un des préaux dont le sol avait été pour la circonstance, tapissé de paille fraîche. Il s'agissait d'une femelle appartenant à un notable de l'Achaba.
À l'approche de l'été, sur les pistes du bled, on commençait à voir de longues caravanes de nomades qui se déplaçaient vers le nord pour trouver des pâturages. On appelait "Achaba" cette transhumance des tribus d'une même circonscription administrative des Territoires du Sud.
Chaque caravane était constituée de dizaines de dromadaires, dont certains étaient surmontés de volumineux "houdej", sorte de palanquin fixé sur un bât de bois et d'osier dans lequel étaient installées les femmes enceintes et celles qui avaient récemment accouché, avec leurs nourrissons serrés dans des bandes de tissu, comme l'enfant Jésus de certains tableaux anciens.
Des hommes portaient, avec une certaine ostentation, leur fusils en travers de la "rahla", selle dont l'arçon avant était surmonté d'un "kerbous" en forme de Croix du Sud, leur permettant de se tenir lorsqu'ils faisaient baraquer l'animal.
Les caravaniers
Des chiens faméliques accrochés à des cordes en poil de chèvre pendant sur le côté des dromadaires, trottinaient en tirant la langue... Parfois un petit âne suivait, la tête basse, attendant la prochaine halte, pour être débarrassé de la pyramide d'objets hétéroclites assemblés sur son pauvre dos.
L'Achaba était administrée pendant son séjour dans la région d'Aïn-Beïda par des méharistes des Affaires Sahariennes. Ils faisaient toute leur carrière dans la même circonscription, et connaissaient parfaitement leur monde. Chacun d'eux était capable de reconnaître bêtes et gens, à des dizaines de mètres de distance, et jonglait avec les filiations et les démêlés de toutes les familles.
Les méharistes déterminaient avec les Autorités locales les lieux de stationnement des groupements de tentes, les droits de pacage et les modalités d'une coexistence sans incident. Ils "marquaient" étroitement les individus douteux, afin de les empêcher de se livrer à des chapardages et à des menus larcins, qui pourraient susciter des "chikayas" avec les populations des douars qui les toléraient.
En même temps que ces tribus, estivait à Aïn-Beïda, un des chefs de la puissante confrérie religieuse Tidjanïa qui résidait à Laghouat. Celui-ci était entouré d'une cohorte de parents, de "moqaddim" et de "tolba", qui profitaient de leur séjour pour renforcer les liens avec les membres de leur confrère, et faire du prosélytisme dans la région, où ils comptaient déjà plus de dix mille fidèles.
Si Mohamed Tidjani avait l'allure d'un grand seigneur. Il tenait sans doute sa prestance et sa "baraka" de son grand ancêtre Abou Al Abbas, qui prêcha l'Islam dans les pays d'Afrique noire, en particulier au Soudan. Au siècle dernier, son grand-père s'était rendu célèbre par le siège qu'il soutint, dans son ksar d'Aïn-Mahdi, contre l'Emir Abdelkader. Tous ceux qui l'abordaient lui témoignaient beaucoup de déférence.
La chasse
L'abondance de gibier et la rareté des distractions ont dès le début des années trente, provoqué le développement des activités de chasse. Une société "La Diane des Haracta", gérait la pratique de ce sport..
Il s'agissait réellement d'un sport en raison de la géographie de la région. En effet, la structure des Hauts-plateaux mêlait vallées, plaines et djebels. D'importants efforts physiques étaient nécessaires pour rechercher le gibier, et le poursuivre dans ses longs déplacements à travers le maquis ou les amoncellements rocheux. Les automobiles étant encore rares, les chasseurs se groupaient pour aller du village aux lieux de chasse souvent, très éloignés du village.
Selon la nature du gibier, on distinguait deux périodes. La première, correspondait aux passages de certaines espèces comme le gibier d'eau : canards, pluviers, vanneaux, bécasses, sarcelles et bécassines, ainsi que les cailles, qui suivaient le cycle de mûrissement des céréales. La seconde, concernait les espèces sédentaires comme les perdrix dont il existait deux sortes : les "grises" dites anglaises et les "rouges" bartavelles. Durant la même période, on chassait aussi le lièvre qui en général, était de petite taille sauf, aux abords des fermes de colons, où des croisements avec des lapins engendraient d'énormes "capucins".
Dans de rares endroits, il y avait du sanglier mais les battues n'étaient pas courantes, en raison de la prétendue sauvagerie des bêtes, qui chargeaient lorsqu'elles étaient cernées, mais surtout, en l'absence de chiens adaptés à ce type de chasse.
Lorsque j'étais en vacances, mon père m'emmenait avec lui. Il fallait se lever de très bonne heure car, en raison de son travail, il devait revenir au début de la matinée. La veille, il y avait le rituel de la préparation des cartouches. Un bon chasseur "faisait" lui-même ses cartouches, soucieux du parfait dosage de chacun des composants. Il me confiait une partie de cette tâche, ce qui équivalait à un véritable adoubement.
J'alignais les cartouches devant moi, comme je le faisais avec mes soldats de plomb. Avec une mesurette de cuivre à petit manche de bois, je recueillais la poudre dans un récipient, et je la faisais couler dans les petits tubes de carton. Il me fallait ensuite, introduire une bourre de feutre cirée que je tassais pour comprimer l'explosif. Je chargeais enfin, le plomb et occultais la cartouche avec un carton de fermeture. La dernière opération restait à faire. Il m'avait fallu démontrer mon sérieux dans l'accomplissement des premières manipulations, pour qu'elle me fût confiée. Il s'agissait de sertir l'extrémité de la cartouche. L'appareil utilisé portait le nom magique pour moi de sertisseur. C'était un dispositif fixé à la table par deux serre-joints. Il comportait une gorge dans laquelle on déposait la cartouche, le culot de cuivre armé de son amorce coincé à 1 'extrémité fixe de la machine. On tournait une manivelle qui rabattait le carton, et le formait en un petit bourrelet. J'étais convaincu que du soin apporté à cette mission, dépendait le résultat de la partie de chasse.
Mon impatience à voir le jour se lever n'avait d'égale que celles des chiens, qui sentaient que c'était un jour de chasse. Comme moi, ils ne dormaient que d'un œil, de crainte que mon père ne s'en aille sans les emmener. Un matin, il avait décidé de ne prendre qu'un seul des deux chiens. Il crut avoir enfermé correctement le second, mais lorsque la voiture démarra, il le vit sauter d'un bond, sur le capot et s'y maintenir en équilibre. Mon père dut céder et le faire monter.
Il fallait une demi-heure pour se rendre sur le lieu de chasse le plus rapproché. Chacun essayait de trouver le meilleur endroit, pour rayonner tant dans les champs que dans les parties couvertes de chênes verts et de lentisques.
Un secteur très favorable se trouvait dans légère dépression baptisée par les chasseurs "l'enclave d'Amor" à cause du propriétaire lui-même "grand" chasseur, Amor Belkhiri. Celui-ci disposait de gardiens rabatteurs, qui ne se contentaient pas seulement d'orienter le gibier vers leur employeur. En effet, chaque fois qu'ils étaient interrogés sur la présence de gibier, selon une formule habituelle : "Tu as vu des perdreaux ce matin?", les rabatteurs répondaient d'une seule voix : "Je te jure qu'il y a au moins quinze jours que je n' ai pas vu un seul perdreau !"
Dans d'autres lieux, lorsque l'on questionnaient les bergers, la réponse s'accompagnait de moues complices : "Si tu veux en trouver comme des mouches, va derrière le djebel, c'est pas loin et il y a plusieurs compagnies "faciles", avec leurs petits qui ne volent même pas...Il s'agissait en fait de vous expédier à une dizaine de kilomètres vers un endroit inaccessible en voiture. Il faut dire que les Algériens s'étant mis en nombre à chasser, les Chaouïa s'abstenaient par solidarité, de renseigner les Européens sur les passages et remises du gibier.
Mon père faisait des parties de chasse courtes. Il ne cherchait pas à faire des "tableaux", et ne s'acharnait pas pour revenir coûte que coûte avec du gibier. J'aimais l'accompagner pour profiter des prémices de l'aurore sur la campagne, et avoir le plaisir de la voir s'animer, avec les premiers appels des bergers, les premiers chants d'oiseaux et les premiers rayons du soleil à l'horizon.
Je trouvais que ce pays, si rude au climat implacable et à la végétation souffreteuse, était le plus beau du monde. Je sais maintenant, que c'était seulement parce que c'était "mon pays".
Je savourais aussi délicieusement les rares instants de complicité virile que ces sorties avec mon père m'offraient. Je sais maintenant, qu'il n'y en aurait plus jamais d'autres.
J'étais plein d'admiration quand je voyais les grandes distances qu'il parcourait, décrivant un large cercle pour revenir à la voiture où il me laissait seul. J'entendais les détonations de son fusil, je voyais le gibier s'envoler, et je percevais les jappements joyeux des chiens excités par l'envie de rapporter quelque proie. J'essayais de suivre des yeux son cheminement à travers les escarpements rocheux, et de deviner à quel endroit il allait réapparaître.
Parfois, nous roulions lentement dans la plaine d'Oued-Nini, à la recherche de rassemblements de gibier d'eau. On voyait briller de loin, les plumes au soleil, et l'on essayait de se rapprocher le plus discrètement possible. Lorsqu'il jugeait la distance favorable, mon père descendait de l'auto, et s'efforçait de progresser à pied jusqu'à distance de tir. Au début de la saison de chasse, les oiseaux effrayés par les coups de feu s'envolaient mais, ignorant le danger, ils faisaient un grand tour et revenaient se poser dans le même coin, sûr d'y retrouver leur nourriture. Il suffisait de patienter pour tenter de les tirer à nouveau.
C'était sur le Tarf que les colverts se rassemblaient. Ils cohabitaient avec d'autres migrateurs. A date fixe, de grands vols de grues survolaient le village et s'orientaient vers le lac salé. Un jour, mon père m'emmena les voir. Il fut impossible de s'en approcher, leurs "mqaraïnef" donnant l'alerte au moindre mouvement suspect, à partir d'environ 300 mètres. Dans ces conditions, il s'avéra difficile de les tirer.
Un de ses compagnons de chasse en blessa une, et entama une course poursuite de plus d'une heure pour la ramener. Il l'entreposa dans notre buanderie, en espérant la relâcher lorsqu'elle ne serait plus choquée, au lieu de la laisser sur son asile naturel. J'essayais de l'approcher, mais elle fonçait sur la porte à claires-voies, pointant son bec comme une lance, et me faisant battre en retraite. Elle me tenait à distance, me fixant d'un œil rond et noir comme pour me mettre en garde.
C'était la difficulté qui incitait les chasseurs à les tirer, elles n'étaient d’ailleurs pas comestibles. Nous trouvions quant à nous, que le gibier d'eau avait un trop fort goût de vase, et mon père distribuait le produit de cette chasse à ses clients. Ma mère ne cuisinait que les bécassines à la chair très fine, mais qui demandaient une adresse au tir très particulière, en raison des crochets qu'elles décrivaient dès leur envol.
La chasse à la caille, dans les champs récemment moissonnés, était la plus spectaculaire. On pouvait voir les chiens marquer l'arrêt devant les tas de gerbes de céréales. Elle était moins fatigante, à cause de l'ab86sence de relief. Cependant, la température croissant rapidement, dans les premières heures de la matinée, il fallait ne pas prolonger l’exposition au soleil. D'ailleurs, les chiens qui multipliaient les allées et venues, accusaient vite la fatigue, et l'on devait s'arrêter avant d'être trop incommodé par la chaleur.
Mon père attendait souvent la sortie des classes pour emmener toute la famille "faire un petit tour", pour nous faire participer à quelques instants de détente. Lorsque l'on apercevait du gibier, il laissait ma mère faire une approche et s'exercer au tir. Ces sorties me marquaient profondément, car elles étaient très rares, à cause des contraintes professionnelles de mes parents.
Le retour des chasseurs, le dimanche, alors que toute la population profitait du repos hebdomadaire, s'effectuait selon un rituel savamment organisé et exécuté. Les voitures étaient décorées avant l'entrée du village, de porte-gibiers pendus aux portières entre les poignées. Les pièces nouées par le cou pendaient, et celles plus volumineuses comme les lièvres, étaient fixées isolément, pour être mieux vues par les passants.
L'arrivée des voitures s'effectuait à grand renfort d'avertisseurs. Elles s'arrêtaient sur le Cours, les portières claquaient, tous s’interpellaient, avant d'aller se désaltérer aux terrasses des cafés, laissant le gibier en vue.
C'étaient des moments de liesse collective, qui avaient un côté puéril mais, lorsque le gibier devint plus rare et que de nouveaux soucis accaparèrent les esprits, cette distraction perdit de son importance. Aïn-Beïda plongea alors un peu plus, dans la morosité qui petit à petit enveloppait la vie de tous ses habitants.
Les sauterelles
Un maquignon kabyle arrivant du Sud, avait osé en parler le premier. Il fallait être un étranger au village pour propager une telle nouvelle. Personne n'y accorda foi mais on ne savait jamais... C'était comme un secret de famille que quelqu'un se serait décidé à révéler.
"C'est comme en mille neuf cent... ou en mille neuf cent..."
Petit à petit, chacun se prenait à chuchoter. Peut-être aurait-il mieux valu en parler enfin pour l'exorciser.
Un matin alors que je partais pour l'école, le plus jeune de nos chats déposa en offrande à mes pieds, un petit insecte brillant, une sauterelle en réduction. Pas une de ces longues bêtes vertes, non, bien plus mignonne et toute dorée. Je la ramassai et la mis dans ma poche, bien décidé à épater mes camarades. Je fus vite déçu car le premier d’entre eux Seghir en avait déjà deux dans son plumier.
Avec des airs de conspirateur il me dit : "C'est pas une sauterelle, c'est un "criqui".
-"C'est pas un cri-cri, un grillon. C'est un bébé sauterelle."
-"C'est un "criqui" marocain. C'est mon oncle le capitaine qui me l'a dit. Mais il faut pas en parler, ça porte malheur !"
Je restai interloqué devant tant d'assurance et tant de mystère:
-"Tu veux dire un criquet sans doute : c'est donc un bébé de sauterelle. Mais je me demande comment il a pu arriver ici. Ce n'est qu'une bête et ça ne peut pas porter malheur!"
Mais tout de même, comment avait-t-il pu venir de si loin? Les seuls Marocains que l'on connaissait étaient de malheureux glaneurs qui arrivaient au moment des moissons et que leur long voyage épuisait. Alors, des criquets !
Le mystère s'épaissit. Seule la maîtresse, Madame Millet, pourrait nous éclairer sur un sujet qui désormais nous préoccupait tant. Encore faudrait-il ne pas l'effrayer avec toutes ces bestioles insolites que chacun des élèves transportait alors que je croyais en avoir l'exclusivité.
Entrés en classe, ce fut Seghir qui osa le premier aborder un sujet d'une si brûlante actualité. L'effet de surprise fut nul. Le fils de la maîtresse lui en avait déjà montré.
-"C'est un criquet. C'est nouveau pour vous. Nous allons donc l'étudier."
Voici comment une distraction devint un sujet d'anxiété!
-"Vous avez bien fait d'en apporter car ce sera un bon sujet de leçon de choses."
Je n'étais pas revenu de ma surprise d'entendre appeler choses des êtres si animés que je me retrouvais désigné pour aller au tableau écrire sous la dictée ce qu'était ce "personnage" si important qu'il pouvait figurer dans nos cahiers.
-"Le criquet est le nom vulgaire que l'on donne à des insectes orthoptères sauteurs."
Sauteurs, on le savait déjà mais orthoptères, c'était plus impressionnant, surtout pour moi qui étais contraint de l'écrire devant une classe perplexe... La maîtresse se vit obligée de voler à mon secours.
Et nous voici tous, entomologistes en herbe, en train de remarquer les antennes courtes, de distinguer les ailes et les élytres inclinés", et d'afficher un certain scepticisme quant "aux cuisses postérieures renflées et robustes". Pas si robustes que ça, puisque l'on en avait démontées plusieurs douzaines avec une grande facilité, et qui traînaient misérablement maintenant sur nos tables.
La révélation fut décisive quand on apprit que les criquets étaient "voyageurs et pèlerins". Seghir commenta en gloussant :
-"Comme mon grand-père qui est allé à La Mecque!"
Toute la classe tendue par la complexité de l'étude en cours, éclata de rire à la révélation que notre camarade avait dans sa famille, un stauronotus marocanus...
Cependant, notre hilarité cessa brusquement quand la maîtresse nous annonça que les criquets étaient l’une des dix plaies d'Egypte. On ne voyait pas très bien le rapport mais on subodora qu'elle allait nous asséner quelque révélation que l'on aurait beaucoup de mal à digérer
-"Ce fut l'une des dix plaies d'Egypte. Ici, vous entendrez parler de péril acridien."
Ça y était : on avait compris ce devait être quelque chose comme le péril jaune dont on entendait les adultes parler avec des moues qui ne disaient rien de bon.
Mais tout à coup avoir à portée de main, même à moitié écrabouillée, une petite bestiole que l'on affublait d'une réputation aussi lourde de menace, ça vous tétanisait une classe et la plongeait dans des regrets d'avoir ramassé inconsidérément un descendant de ceux dont la malfaisance avait traversé les millénaires.
On s'attendait désormais à tout. Et à la sortie de l'école, notre premier geste fut de lever la tête vers le ciel...
Il avait pris une coloration étrange, pareille à celle de ces jours d'été lorsqu'il se chargeait de la poussière rouge du Sahara. Le soleil semblait filtré et le sol était jonché d'une multitude de criquets qui le rendaient glissant.
Tout là-haut, il y avait comme des vagues qu'une tempête brasserait et projetterait sur les grands pins du Square. Notre surprise était grande de voir les rues pleines de gens observant le ciel, l’air figés de terreur, la bouche ouverte, les yeux plissés, impuissants face aux envahisseurs.
La nuée semblait alimentée comme par la fumée d'un immense feu. Le soleil lui-même abandonnait et disparaissait.
Revenu enfin de ma stupeur, je perçus le bruissement continu du frottement de millions d'ailes sur l'air chaud. Et j'entendis comme en un murmure mille bouches qui geignaient : "Djerada... djerada... djerada..." identifiant en arabe le criquet maudit. "Djerada... djerada... djerada..."ce nom que l'on croirait celui d'un djinn maléfique.
J'entendis des commentaires dérisoires:
-Il faut taper sur des bidons, pour les empêcher de se poser !
-Il faut allumer du feu avec de l'huile de vidange pour les faire aller ailleurs !
-Il faut mettre des mellafahs dans les champs, sinon elles vont tout bouffer !
Je pris conscience que les petits ventres mous que l'on palpait tout à l'heure, devraient à un moment ou à un autre, être remplis d'énormes quantités de verdure sacrifiée.
Des soldats passaient se dirigeant vers la plaine "pour creuser des tranchées, pour brûler les sauterelles". Une voix s'éleva pour demander "pourquoi qu'elles vont pas vers Bône où qu'y a beaucoup à bouffer ?" Chacun approuva une idée aussi vaine ...
Il aurait fallu pouvoir interroger les adultes d'habitude si savants, pour connaître leurs pronostics sur la suite des évènements. Mais ils étaient indisponibles...
J'étais surtout désireux de savoir si on devait s'attendre à endurer les neuf autres plaies d'Egypte. Je consultai le "Dictionnaire du XXè siècle" que mes parents avaient depuis longtemps érigé en maître souverain devant répondre à toutes les questions.
J'en appris que "l'Egypte dut affronter les dix plaies parce que le Pharaon refusait de laisser les Hébreux sortir de son pays".
C'était donc cela. Il y avait sûrement quelqu'un qui avait empêché les Juifs de sortir d'Aïn-Beïda, pour les dernières célébrations de leur fête. Je crus tenir une explication aux malheurs qui s'abattaient sur nous.
Mais, il me faudrait attendre le lendemain pour interroger mon camarade Yves Ichaï. Je lui demanderai s'il avait entendu dire quelque chose à ce propos. Si c'était un secret, je l'échangerais contre la révélation que le curé buvait du vin pendant la messe. Il ne le savait sûrement pas. S'il ne me répondait pas, je lui apprendrais que pendant la messe, le curé portait une calotte comme la kippa du rabbin. Peut-être pourra-t-il aussi m'informer sur les neuf autres plaies d'Egypte, qui ne vont pas tarder à nous tomber dessus si l’on ne fait rien.
Je finis par m'endormir sur ces bonnes résolutions. Mais mon sommeil fut rapidement tourmenté par les évènements de la journée.
"Sachant qu'un criquet mange 48 grammes de blé par jour et qu'un hectare produit 12 quintaux, si 10 hectares sont envahis par 28 millions de criquets, combien de quintaux une propriété de 284 hectares dont seuls les trois-quarts ont été ensemencés aura perdu d'argent, le blé étant payé 35 francs les cent kilogrammes." Pendant que la maîtresse s'acharne à nous poser ce problème dont je ne trouverai jamais la solution, un immense cortège s'est formé.
Tous les Juifs du village sont en route vers le bois de pins. C'est Soukkot la "Fête des Tabernacles". Tous portent des roseaux et d'immenses plateaux chargés de beaux gâteaux dorés.
En tête du rassemblement, marche Sassa, toute gandourah flottant au vent, étrange Saint-Christophe, trimbalant sur ses épaules la statue de Jeanne d'Arc, sortie de l'Église pour la première fois.
Abrité sous le grand parasol du Sultan du Maroc porté par l'oncle de Seghir, le rabbin coiffé de la calotte du curé, marche dignement, abreuvé de vin blanc par l'abbé.
Derrière le cortège, installées sur des carrioles des fillettes, parées de robes multicolores frappent sur des bendirs et scandent "Djerada, djerada, djerada " au lieu de 1eur traditionne1 "Gabarre, chlaram el far…"
Des glaneurs marocains suivent la foule et ramassent au passage, les morceaux de roseaux abandonnés en chemin.
Soudain le miracle se produit : les millions de criquets qui tournoyaient là-haut dans le ciel, s'alignent tout à coup et orientent leur dangereux pèlerinage dans la direction du nord, pour aller sans doute s'abattre sur la plaine de Bône où il y "beaucoup à bouffer".
Je me réveillai brutalement, échappant enfin à l'impossible solution de mon problème, je fonçai vers ma fenêtre: tout me sembla normal. Mais hélas ! le printemps s'était transformé en automne: les criquets avaient dévoré toutes les feuilles des arbres, et toute l'herbe du Square, tandis que dans la plaine la récolte avait été pillée. Dans la rue, comme s'ils n'avaient pas bougé depuis la veille, les mêmes gens étaient statufiés ne pouvant s'arracher à la contemplation du désastre.
J'eus ainsi, la révélation de l'étendue des conséquences du fléau à la funeste réputation.
Convois en tous genres
Eté 1938.Tandis que les démocraties faisaient semblant "d'y croire", les Allemands procédaient à des répétitions générales, en vraie grandeur, après avoir annexé l'Autriche.
Ain-Beïda commençait à vivre l'époque des convois. De grandes manœuvres devaient se dérouler en Tunisie, aux confins avec la Tripolitaine, colonisée par l'Italie. Il s'agissait de déployer des troupes sur la Ligne Mareth, dont venaient d'être construits des points d'appui, au sud de Gabès, dans une région désertique, dont les noms les plus connus étaient Foum-Tataouine, Ben Gardanne et Déhibat.
Une mobilisation semi générale fut proclamée, et le village fut traversé par des convois de camions militaires ou civils réquisitionnés. Des milliers de soldats furent ainsi transportés : tirailleurs, zouaves, artilleurs, chasseurs d'Afrique, "tringlots", ambulanciers, escortant des canons, des chevaux, des véhicules blindés ou sanitaires, des cuisines roulantes, des camions-grues, tout ce qui était nécessaire pour faire la guerre.
Toute une belle jeunesse qui croyait ce qu'on lui disait : "La der des der c'était en 14, là on montre sa force..."(sans vouloir)"s'en servir".
Le plus fort, c'est que ce fut vrai jusqu'à la prochaine fois. Et sitôt l'été passé, Aïn-Beïda revît les mêmes, en sens inverse, toujours aussi jeunes, encore plus insouciants et surtout désormais convaincus que M. Daladier était un grand homme.
Eté 1939. On prit les mêmes et on recommença. Encore plus de camions militaires ou civils réquisitionnés. Encore plus de soldats, encore plus de tout ce qui était nécessaire pour faire la guerre ... Mais cette fois, les visages étaient plus tendus, car c'était la guerre et ça serait peut-être, comme les Anciens de 14-18 le racontaient les soirs de 11 Novembre.
Les convois succédaient aux convois, et nous les gosses, nous nous remplissions les yeux. Nous comptions, nous évaluions, nous mémorisions pour être sûrs de tout identifier au prochain passage. Et nous prenions pour normales, ces bandes molletières vieillottes, ces "leggins" de cuir épais, ces canons aux roues de charrettes, ces fusils trop longs et trop lourds, ces uniformes au tissu trop épais pour affronter le climat du désert ...
Les choses avaient changé. Mon père était mobilisé à Sétif. Le chef cuisinier partit à son tour...Ma mère dut faire face aux problèmes que posait la conduite des affaires de l'établissement. La pression était grande. Mon père lui disait de fermer au moins le restaurant. Mais elle croyait que c'était impossible.
Elle remplaça le cuisinier. Le fourneau fonctionnait au coke. La chaleur dégagée était insupportable pour elle. Le rayonnement l'empêchait d'en approcher. Les garçons trouvèrent un palliatif pour qu'elle pût cuisiner. Ils mouillaient des sacs de jute, et les accrochaient à la rampe de cuivre, qui courait le long du fourneau.
Des heures passées ainsi provoquaient une intense fatigue, des courbatures et de violents maux de tête. Il lui était en outre, impossible d'échapper aux brusques retours de flammes, qui se produisaient lorsque de l'huile tombait sur les plaques portées au rouge. Ce fut une expérience qu'elle ne put jamais oublier. Mais, il s'agissait d'une génération de commerçants qui croyaient n'avoir que des obligations envers la clientèle, même lorsque celle-ci, et c'était le cas, n'était que de passage.
Dans les salles du restaurant, les soldats faisant halte, mangeaient, chahutaient, fauchaient les salières et les couverts. Leur encadrement n'avait d'autre souci que de pouvoir les rassembler pour reprendre la route.
Enfin, mon père fut démobilisé. On avait fini par se préoccuper de sa dysenterie amibienne, ramenée des Dardanelles. Au moment même où l'on se rendit compte par hasard, qu'il n'était plus mobilisable. Allez être militariste après cela ! Heureusement aussi, l'acheminement des troupes prenait fin. Il ne resterait plus que des passages de permissionnaires. Le village reprit son calme sous la lumière bleue du "black-out".
Printemps 1940. Le mois de mai arriva, et avec lui une immense rage : l'Italie entrait en guerre au bon moment pour elle. On nous avait tellement rebattu les oreilles avec "notre sœur latine", qu'on y croyait autant qu'aux accords de Munich, aux compétences du Général Gamelin et à l'invincibilité de la Ligne Maginot...c'est dire si l'on était intoxiqué par la propagande.
Voici que débarque une escadre de l'Aviation équipée de nouveaux chasseurs-bombardiers américains, des bimoteurs Glenn-Martin. Pour ma plus grande joie, ils installent leur mess dans notre établissement. Je découvre "en vrai" ce que les récits de Kessel sur Jean Mermoz, les photos des reporters de Match et les dessins des journaux illustrés ne m'avaient fait qu'entrevoir.
Tous les matins et tous les soirs, les avions décollaient, pour aller nous disait-on, bombarder Trapani, une base importante située à la pointe nord-ouest de la Sicile et l'Ile de Pantelleria, à une soixantaine de kilomètres à l'est du cap Bon.
A leur retour, ils survolaient à basse hauteur le village, en sautant par dessus la colline du fortin. Je me glissais dans leur salle à manger, afin de ne rien perdre des récits de leurs missions. Comme tout se terminait par des chansons, et malgré les interdictions de mes parents, je faisais provision de ces chansons d'aviateurs, une décennie avant de le devenir moi-même. J'enrichissais ainsi mon vocabulaire de mots et d'expressions dont le dictionnaire, pourtant "du XXè siècle", refusait absolument de me révéler le sens.
Les jours où leur activité se ralentissait, mes parents acceptaient qu'ils m'emmènent jusqu'au "champ d'aviation", afin que je puisse voir et toucher leurs avions. J'en profitais pour ramasser tout ce qui de près ou de loin, pouvait avoir un rapport avec les machines volantes : morceaux de duraluminium- que rien ne pouvait couper- écrous chromés et fils électriques multicolores.
Malheureusement, l'armistice arriva et j'assistai avec tout Aïn-Beïda rassemblé sur le Cours, à leur dernière prise d'armes, au cours de laquelle se fit l'appel de leurs morts. Ils désarmèrent leurs avions, et partirent vers les aérodromes de l'Algérois, d'Oranie puis enfin du Maroc. Trente ans plus tard, étant officier de l'Armée de l'Air, j'ai retrouvé l'un d'entre eux, André Forot, qui racontait les larmes dans les yeux, le souvenir de cette cérémonie à Aïn-Beïda.
Dans le courant de l'été, le village vit revenir les mêmes soldats qu'en 1939, mais cette fois-ci, la joie de rentrer chez eux cachait mal leur immense déception et leur angoisse quant à l'avenir. Aucun n'avait vu la moindre plume du moindre bonnet de "bersaglieri". Ils se retrouvaient vaincus sans avoir combattu, et la revanche semblait une perspective sans avenir.
Glenn-Martin de Groupe de Bombardement 1/63- Aïn-Beïda Juin 1940
Fort heureusement, celle-ci devait finir par arriver. Et en Novembre 1942, Aïn-Beïda revit de nouveaux convois mais cette fois-ci, une armée hétéroclite empruntait la direction de l'est. Il y avait toujours les mêmes uniformes, les mêmes bandes molletières, les mêmes longs fusils, le même mélange de soldats européens, algériens et marocains. Mais, les véhicules ne ressemblaient que de loin à ceux de 1939. C'étaient des camions plus civils que militaires, fonctionnant au gazogène, des autobus avec leur gros fourneau accroché à leur arrière, les impériales chargées de matériels divers. Certains tiraient des canons de 75 sur les mêmes roues de charrettes. Une armée bricolée mais sans complexe et remplie de courage et d'audace. Les blonds guerriers teutons de Rommel n'en croiraient pas leurs yeux, en les affrontant dans les djebels de Tunisie.
Cette troupe aurait pu en avoir des complexes, si elle avait vu ce qui arrivait derrière elle. Une grande armée de riches la suivait. Des véhicules aux formes inimaginables, Jeeps, Command-cars, G.M.C rutilants, puissants et étoilés, en files interminables, qui jour et nuit, remplissaient les rues du village de ronflements de moteurs, transportant des soldats dans de belles tenues toutes neuves, aux plis impeccables, des extra-terrestres pour nous !
Tout sentait le moderne, le nouveau, le "jamais servi", en fait l'opulence face à la misère de ceux qui devant, subissaient le choc frontal de soldats puissamment équipés, et totalement aguerris. D'incroyables machines à trains de roues multiples, ne ressemblant à rien de connu, suivies de porte-tanks, on ne disait pas encore chars, à la queue leu leu, étaient exposées à nos regards étonnés.
Et à leur volant, d'immenses gaillards, noirs de peau, le casque penché sur l'oreille, aux chaussures de cuir souple briquées, et éternellement assoiffés de vin muscat d'Algérie, qu'ils découvraient et dont ils semblaient ne plus pouvoir se passer. Tous fuyaient l'eau, même celle d'Aïn-Beïda, dont ils disaient, suprême offense, qu'elle n'était pas potable!
Sur leur passage, la foule des gosses découvrait tout à coup, leur condition de sous-développés, et cueillaient au vol des bonbons au parfum chimique, du chocolat immangeable en d'autres circonstances et du chewing-gum.
Nos parents comprirent tout de suite qu'il fallait sauvegarder notre dignité et nous interdirent de ramasser ce que les GI's balançaient si généreusement sur leur passage. Nous nous fîmes une raison, mais, nous acceptions malgré tout, de partager avec ceux qui avaient si ce n'est moins de dignité que nous, en tout cas, moins d'esprit d'obéissance.
La gare d'Aïn-Beïda voyait, elle aussi, passer d'immenses trains de plusieurs centaines de mètres de long avec deux locomotives américaines en tête et deux en queue, chargés de munitions de toutes sortes.
Lorsqu'en Tunisie, grâce à l'abnégation de l'Armée d'Afrique, la bataille changea d'âme et la victoire changea de camp, on vit des trains entiers, transportant des prisonniers italiens d'abord, puis allemands ensuite, les premiers heureux que la guerre ait une telle fin pour eux, les autres n’en revenant pas encore de leur surprise, et restant prostrés, inquiets du sort qui leur serait réservé. Tristesse des aléas de la guerre... lorsque l'on n'a pas l'habitude d'être parmi les vaincus.
Quant aux Européens, ils étaient trop occupés par ce spectacle pour en évaluer l'impact sur l'esprit des Algériens. La comparaison était au désavantage de la France et la propagande des nouveaux débarqués fera le reste.
Les Anglais ont débarqué
C'est par un courrier provenant d'Aïn-Beïda que j'appris cette non nouvelle : "Les Anglais ont débarqué". Nous étions en Janvier 1943 et je venais à peine de rejoindre le Lycée à Constantine, après les vacances de Noël. Le vrai débarquement avait eu lieu le 8 Novembre 1942.
Je m'interrogeais sur le sens d'un tel message.
En fait, il me fallut attendre les vacances de Mardi-Gras pour en découvrir le sens. Il s'agissait de la réquisition de l'hôtel de mes parents et de tout ce qui s'y rattachait pour les besoins de la R.A.F, la Royal Air Force, en langage simple : l'Aviation anglaise.
La bataille de Tunisie faisait rage. Rommel, le chouchou d'Adolf (tant que trois mille kilomètres les séparaient, dont mille de sable et mille de Méditerranée), grand soldat blindé pressé par le Rat du désert Montgomery, aidé par Leclerc, se trouvait affronté à l'Armée d'Afrique accompagnée de chars américains. C'était l'hiver, et à là grande surprise des anglo-américains, l'Afrique du Nord était un pays froid où le soleil était chaud.
Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'aviation est une arme qui a besoin de recul, car elle a la mobilité et la vitesse pour elle. L'anglaise intégrait donc absolument cet élément dans son déploiement. Elle campait ainsi à Aïn-Beïda, au lieu de s'établir tout près du front. Les Américains, par ignorance, et les Français, par insouciance, s'étaient installés au plus près du front à Youks-les-Bains, au risque de se faire canarder par la Luftwaffe, toujours présente dans le ciel tunisien.
Et voici pourquoi, les Anglais avaient débarqué dans notre maison, et nous nous retrouvions occupés! La famille était réduite à ne plus disposer que d'une seule pièce, au rez-de-chaussée, avec des toilettes communes...Heureusement, ses chambres à l'étage, étaient épargnées. Les Anglais disposaient des vingt autres...
On avait dû dire aux soldats peu gracieux de Sa Majesté, que les Français d'Afrique du Nord n'aimaient pas les Anglais depuis "Mers-el-Kébir". Je peux jurer qu'en ce qui nous concerne, c'était totalement faux. Cela remontait à Trafalgar et Waterloo, en passant par Fachoda ! Aussi adoptèrent-ils avec nous une attitude hautaine qui n'était absolument pas dans leur nature... parait-il.
Quant à nous, on ne pouvait pas dire que nous ne pouvions pas les voir, car ils étaient partout.
Ils étaient partout ou plutôt nous n'étions plus nulle part chez nous. Une odeur de bière et de tabac blond se partageait l'espace avec la vapeur d'eau. Au début, je pensais que nostalgiques, ils essayaient de reconstituer artificiellement le "fog" de leur "sweet home".
Il n'en était rien. Il y avait partout d'énormes brûleurs à essence, ressemblant comme des frères à nos petits réchauds à pétrole, mais, en dix fois plus gros. Pour nous, le pétrole, ce n'était pas dangereux, mais l'essence ! Les Anglais, eux, n'avaient peur de rien...en tout cas pas de l'essence.
Ces feux étaient "pompés" par de blonds éphèbes tout bouclés, penchant la tête sur le côté pour que leur calot ne tombât point, même quand celui-ci, passé sous la patte d'épaule de leur "battle dress", ne risquait rien. Et sur ces réchauds, dans tous les récipients du restaurant, dans des marmites à l'origine indéterminée, sans doute réquisitionnées ailleurs, de l'eau bouillait en permanence. C'était là, l'origine de ce brouillard qui créait un micro climat dans notre maison.
Il s'agissait d'une nécessité vitale pour ces guerriers. En effet, dans une partie des marmites, à certaines heures, chauffaient des boîtes de conserves dont les couvercles avaient été ôtés, laissant s'échapper de riches odeurs de ragoût de je-ne-sais-quoi, ayant au moins pour vertu de calmer notre appétit de J3.
Mais, tout le reste du temps, quand plus rien ne trempait dans le "bath Mary", cette eau était destinée à l'indispensable thé qui, contrairement à ce que croient les ignares, ne se consomme pas à cinq heures, mais bien au contraire, toute la journée.
Si les Américains avaient mis des pancartes "Out of bounds", pour interdire l'accès de certains endroits, les Anglais, chez nous, installèrent un lourd rideau pour nous empêcher de voir dans la grande salle du Café. Il me fallut donc plusieurs jours, pour apercevoir le "machin" dont j'entendais le vacarme depuis mon lit et qui ressemblait à un piano. Son origine était sans doute anglaise, car les sons qu’il produisait n'avaient rien de commun avec ceux émis par un piano français. Des mélodies nostalgiques reprises en chœur, s'élevaient par moment, puis s'interrompaient brusquement pour laisser place à une musique syncopée, que nous avons eu le privilège de découvrir avant quelle n'inondât l'univers.
Je me rendis compte dès le premier jour, que les relations avec nos locataires devaient être réduites à de brèves salutations. Ma mère m'avait bien averti :"Ce n'est pas parce que ce sont nos Alliés, que tu ne dois pas être poli avec eux". Le conseil était superflu, car j'avais l'habitude de dire bonjour à n'importe qui.
A mon salut, chacun, du simple soldat au "wing commander" moustachu, répondait "Hello", seule la modulation changeait. Comme je voulais avoir le dernier mot, je répondais toujours : "Elle bout!" Il n'y avait aucune chance pour que cette astuce fût comprise, je ne pratiquais pas l'humour anglais mais seulement, l'humour algérien. Quand j'en avais assez de ne plus pouvoir aller jouer, dans une de nos deux cours, par crainte de me brûler, j'ajoutais : "Elle bout, l'eau", ce qui était plus explicite, mais hélas ! N’avait pas plus de chance d'être compris.
En fait, cela voulait surtout dire : "Et le boulot?" par allusion venimeuse au "travail" mortel que faisaient nos tirailleurs en Tunisie. Ils étaient par chance, privés de ragoût à la rhubarbe. En effet, l'intendance française avait déstocké des boîtes de "singe", soigneusement conservées depuis la guerre du Rif de 1925...
Je peux avancer, pour me justifier, que pendant mes deux séjours à Aïn-Beïda, aux vacances de Mardi-gras et de Pâques, je n'ai jamais vu les Anglais voler. Cela n'a pas été le cas pour ma famille. Lorsqu'ils ont reçu l'ordre de déménager, ces fiers soldats se sont fait un devoir de charger méthodiquement dans leurs beaux camions, toute la vaisselle du restaurant qui pourtant ne portait pas de label "Made in England", tous les ustensiles de cuisine, toutes les tables de nuit et les matelas de l'hôtel. Mon père qui n'avait pas vu cela depuis la retraite des Bulgares en 1916 à Salonique, risqua un semblant de protestation, à laquelle il fut répondu un "Ça ne fait rien, c'est la guerre !" avec ce flegme anglais qui fait merveille face à tous les dangers. Comme quoi, s'ils veulent apprendre les langues barbares, les Anglais y arrivent bien, à la longue.
Mes parents, qui avaient été pendant plusieurs mois totalement privés de leur gagne-pain, voyaient s'en aller ainsi, en quelques heures, l'essentiel de leur outil de travail. Pour la petite histoire, ils ne furent jamais dédommagés. On leur versa des années plus tard, généreusement, une indemnité "d'occupation des lieux" ne couvrant ni les dommages aux biens, ni les "enlèvements". Le terme d'occupation était sans doute de l'humour involontaire.
Cependant, le pire fut évité, au cours de cette période. Afin de tenter de gagner sa vie, mon père décida d'ouvrir un café, dans un petit local précédemment à usage de café maure, boulevard Magenta, non loin de l'hôtel. Quelques clients venaient y faire une partie de cartes, tout en consommant des apéritifs de remplacement, les grandes marques faisant défaut. Des militaires, revenant du front, s'arrêtaient de temps en temps.
Enfin la bataille de Tunisie s'acheva victorieusement. Après les Anglais de la R.A.F, nous fîmes connaissance avec les soldats britanniques de la 8è. Armée.
Il faut dire qu'il y avait une grande différence entre eux. Les Anglais avaient le teint clair, ils étaient impeccables, les chaussures cirées et la moustache brossée...et réciproquement. Ils avaient l'air un peu hautain de ceux qui étaient là pour faire ce qu'eux seuls savaient faire.
Les Britanniques, tels qu'ils nous apparurent sous la forme de soldats de la 8è. Armée, étaient totalement différents. Directement issus de cet Empire sur lequel le soleil n’arrivait toujours pas à se coucher : Maoris, Gurkas, Sikhs, Pakistanais, Néo-Zélandais, Australiens, bronzés, bridés, débraillés, enfin de vrais combattants ayant traîné leurs guêtres, leurs shorts, leurs chapeaux de "la Patrouille de l'Ivoire" et leurs casques plats dans le désert de Cyrénaïque.
Seulement voilà, à force de bourlinguer au delà des mers, ils n'avaient plus de repères et ils ne savaient pas distinguer en matière politico administrative, entre la Tripolitaine, la Tunisie et l'Algérie."A la guerre comme à la guerre!" aurait dit le "Wingcommander". Pour eux, tant qu'on n'était pas revenu à la case départ, qui pour la majorité d’entre eux était à au moins dix milles kilomètres, on faisait ce que l'on voulait et puis, armé comme l’on était, ce n'était pas des "pékins" qui auraient pu dire et encore moins faire quelque chose.
Le jour où nous fîmes leur connaissance longtemps différée, ils se répandirent dans le village, commencèrent à s'abreuver à droite et à gauche, et le soir tombé, ils avisèrent le petit café de mon père « L’Etoile filante ». Ils envahirent la salle et commandèrent à boire. Depuis Tobrouk, ils avaient appris le verbe "drink" dans la langue de Shakespeare qu'en tant que natives, ils n’avaient jamais possédée.
Mon père sentit vite que la pression montait, et chercha en vain, le moindre galon sur la moindre veste qui indiquât la présence d'un vieux briscard, comme il yen a toujours un au moment où les bidasses en folie commencent à dépasser les bornes... Brusquement les armes se pointèrent vers lui et le contraignirent à donner sa caisse. Il réussit à s'échapper tandis que les mains palpaient les billets et fou de rage et craignant pour sa vie, il voulut aller chercher son fusil de chasse à la maison. Heureusement, Moustique son garçon, le rejoignit et avec ma mère ils firent obstacle à son retour au Café qui se serait transformé en lieu de tragédie.
Il parait que tous les soldats du monde...mais alors les british…
La vie au fil des jours : Couscous-partie
Dans les années trente, mon père était client d'un coiffeur situé dans la rue de Batna, à l'enseigne de "Au bon cœur".
Au cours d'une séance chez le barbier, la conversation dériva vers la gastronomie, et celui-ci évoqua la réputation d'amateur de couscous que l'on prêtait à mon père. Le coiffeur vanta la qualité exceptionnelle de celui que cuisinait son épouse, et invita mon père à venir un certain jour en déguster un.
Mon père se rendit à l'invitation avec un voyageur de commerce fin gastronome. La préparation étant à la hauteur de la promesse, les deux invités dégustèrent de fort bel appétit le premier plat. Tout heureux le maître de maison les invita à continuer avec un deuxième plat auquel les convives firent honneur. Ce que voyant, le barbier demanda un troisième service qui le temps aidant et les dosages plus méticuleusement ajustés, fut consommé de fort bonne manière ...
Lorsque les cuillères commencèrent à sonner sur le fond des assiettes, l'hôte se leva et s'écria en direction de la cuisine : "Anna ! Porte la salade..." redoutant que les convives n'aient encore un boyau de vide.
Après force compliments, les deux invités se retirèrent pour une sieste amplement justifiée. Mais le lendemain, un premier client salua mon père d'un :
-"Il parait que vous aimez le couscous !"
-"Oui, répondit-il, quand il est bon!"
Après quelques instants, un deuxième client :
-"Alors ce couscous, il était bon?"
-"Eh oui, il était même excellent!"
Jour après jour, mon père s'efforçait de garder son sang-froid chaque fois qu'il était question du repas chez le barbier, de qualité ou de quantité.
Au bout d'une semaine, n'y tenant plus, il envoya au bavard un sac de cinquante kilos de semoule, afin qu'Anna pût rouler du couscous jusqu'à la fin de l'année.
Cependant mon père resta client du "Bon Cœur" car il avait la barbe dure et l'épiderme délicat.
Le percheron
L'enlèvement des ordures ménagères était effectué par un énorme tombereau auquel était attelé un magnifique percheron. L'animal était exceptionnel en force et en beauté. Son conducteur le menait calmement à la voix et lui vouait une véritable passion. Dans ce pays de beaux chevaux arabes fins et nerveux et de barbes vigoureux, le percheron semblait ne pas être un équidé.
Le "marchand d'ordures" comme tout le monde l'appelait, faisait le tour du village, en s'arrêtant devant chaque maison. A son passage, chacun sortait le récipient qui servait de poubelle, que le bonhomme hissait et vidait dans le tombereau. Le cheval marquait chaque arrêt puis avançait de quelques mètres. Lorsque la collecte était faite, le conducteur partait pour on ne savait où...En effet, personne n'a jamais vu à Aïn-Beïda de tas d'ordures comme on peut en voir maintenant un peu partout sur la planète.
Sur le chemin de l'école, je voyais ici ou là le lourd véhicule et j'étais plein d'admiration pour le cheval. Celui-ci me semblait aussi utile que celui de "Germinal" en plus heureux, et je lui prêtais les mêmes sentiments qu'à celui que Victor Hugo décrit évitant le crapaud de la fondrière...
Un jour, j'assistais à un drame. Des travaux avaient été entrepris dans une rue encaillassée et les ouvriers n'avaient pas balisé un trou réduisant encore la chaussée, d’ailleurs chez nous il n’y avait pas besoin de balisage, on regardait toujours où nous mettions les pieds. Le tombereau s'y était engagé et une roue était tombée dans l'ornière.
-"Zid ya oueldi! Vas y, mon fils!" dit doucement le conducteur qui n'avait pas évalué correctement la situation. Le cheval s'arc-bouta, mais la roue resta bloquée dans fondrière.
Le bonhomme réitéra sur le ton de l’encouragement, sans le moindre résultat. Il crut bon d'élever la voix ce qui ne lui arrivait jamais. Le cheval sentit qu'il lui fallait se surpasser. Il donna toute la puissance de ses muscles, mais hélas, c'est la roue qui s'arracha ...
Je vis l'animal étonné s'arrêter et regarder en arrière, rencontrant le regard incrédule de son maître. Tous deux avaient la même attitude désolée. Lorsque je repassai à la sortie de l'école, il ne restait plus de trace de la "catastrophe".
Le lendemain l'homme, le cheval et le véhicule étaient à nouveau au travail.
Près de soixante ans plus tard lorsque j’ai raconté en France cette mésaventure à M. Perri qui avait géré à l’époque cette activité, il m’avoua qu’il n’en avait rien su. À Aïn-Beïda on trouvait même des chefs naïfs face à des Chaouïa discrets.
Le Téléphone et la sirène
Le dispositif de défense passive mis en place dans la perspective de raids aériens, comportait le déclenchement à partir de la Poste, d'une sirène installée dans le clocher de l'Eglise.
La jeune fille employée au Central téléphonique avait été dotée par la Nature d'une jolie voix et d'atours avantageux. Elle avait horreur de rester inactive entre deux appels. Elle contactait donc de temps en temps, un abonné et lui proposait gentiment de lui chanter une chanson. C'était la "chanson des auditeurs" avant la lettre.
Le local du Central était de dimensions réduites, et pour se dégourdir les jambes ou récupérer un document, il fallait se glisser délicatement, entre les encombrements du bureau. Les attributs de la standardiste l'obligeaient à beaucoup de précautions pour évoluer dans un tel espace.
Un jour de presse, elle actionna avec ses fesses sans s'en apercevoir, le bouton de déclenchement de la sirène. Le village entier crut à une alerte.
Au bout d'un moment, se rendant compte qu'elle était à l'origine de l'incident, elle eut le bon réflexe de rapidement sonner la fin de l'alerte.
Cette sirène ne servit qu'une seule fois pour une véritable alerte, pendant la campagne de Tunisie s'était égaré dans le ciel d'Aïn-Beïda, avait déjà largué une bombe au hasard, dans un champ.
Personne ne s'était avisé de sa présence inopportune.
Les cloches sonnèrent le tocsin. Le village fut en émoi, mais l'attaquant s'étant éloigné en direction de la frontière, tout rentra dans l'ordre.
Qui sait si l'équipage reçut pour cette glorieuse mission la médaille des "Fatica della guerra"?
Traction contre bourricot
Mon père revenait dans sa voiture, d'une visite à la ferme Ceccaldi située dans les environs de Berriche. Pressé par le temps, il roulait assez vite sur la piste et se trouva, en abordant la route goudronnée, en présence d'un âne de belles proportions, qui se tenait en plein milieu de la chaussée.
Tant bien que mal, il réussit à ralentir son véhicule jusqu'à arriver au contact de l'animal. Celui-ci prit peur, fit un écart et heurta de son arrière-train l'avant de la Traction.
Mon père descendit, se rendit compte que la calendre était enfoncée, et que le radiateur avait reculé et bloqué le ventilateur. Jetant un coup d'œil dans le champ, il vit l'âne brouter de l'herbe pour se remettre de ses émotions. Il fallut batailler pour réussir à dégager le ventilateur et remettre en route. Alors qu'il démarrait, mon père constata que l'âne, les quatre fers en l'air, se grattait voluptueusement le dos dans la prairie.
A quelques jours de là, une lettre lui parvint adressée par une paysanne d'origine ardéchoise, connue pour sa jolie carriole et son chapeau en corbeille noire renversée.
Il y était écrit : "Monsieur, tel jour, au volant de votre véhicule automobile (sic) fonctionnant au gaz de pétrole (resic), vous avez écrasé le fils de la coopérative..."suivait une injonction dont j'ai oublié les termes.
Mon père eut la délicatesse de ne pas envoyer à la demanderesse la facture de la réparation comprenant une belle calendre toute neuve.
Il n'entendit plus parler du brave Cadichon, qui dut couler des jours heureux dans la plaine de Berriche. A moins que, ne pouvant réfréné son tempérament voluptueux, il ait brouté le joli bouquet de fleurs de soie qui ornait le chapeau de sa propriétaire et ait été condamné, nonobstant sa rare filiation à servir de complément de chair à saucisson "pur porc". Cela arrivait, parait-il, à certains de ses congénères et faisait...la réputation du saucisson d'Aïn-Beïda.
Le Voleur de poules
Il était fréquent que de menus larcins fussent perpétrés dans le village, surtout dans les quartiers périphériques ne bénéficiant pas d'un éclairage efficace.
Il s'agissait le plus souvent, de vols d'objets oubliés dans les jardins, de linge à l'étendage et d'animaux de basse-cour.
Tout près de la Gare, à la Cité Susini, une série de vols furent commis, concernant essentiellement des poules et des dindes. La Police établit des rondes, surveilla les abords arrêta quelques suspects, mais en vain.
La Gendarmerie se mit en chasse à son tour, pensant qu'il s'agissait de gens venus de la campagne, s'esquivant une fois leur forfait accompli. Les propriétaires furent mis à contribution pour tenter de reconnaître, lors de la revente, leurs gallinacés.
Les enquêteurs étaient troublés par le fait que même les renards n'arrivaient pas à dérober leur gibier sans le faire crier, alors que personne n'entendait jamais le moindre couinement pendant les "opérations".
L'affaire aurait conservé son mystère sans la perspicacité d'un tripier qui s'étonna de voir un "client" ne s'intéressant qu'aux boyaux de très grande longueur, et restant muet sur l'usage qu'il en faisait. La maréchaussée informée, le suspect fut pris en filature. On découvrit ainsi ce qu'il faisait de ces boyaux.
Il attendait que la nuit s'avance suffisamment, pour venir se mettre au pied de la clôture d'une maison dans laquelle il avait repéré une basse-cour. Il balançait par dessus le mur, un boyau très long qui attirait l'attention des volailles. Lorsque le voleur sentait que l'on tirait sur cette extrémité, il soufflait dans le boyau, qui se gonflait jusque dans le gosier de la proie. Celle-ci en restait tout interloquée. Il suffisait de la ramener, et de recommencer l'opération silencieuse ...
Le malandrin fut arrêté mais il entra malgré tout dans la légende.
L'air de la réaction
Il y avait en face de chez nous, entre le salon de coiffure Gréco et l'atelier de Coco Giganti, une pompe à essence appartenant à M.Sebbah, de marque "Stelline", dont certains croyaient d’ailleurs, qu’elle vendait du carburant russe ! C'était une belle installation rouge, avec deux globes qui se remplissaient alternativement, sous l'action d'un système de type Japy.
Des véhicules de toutes sortes se ravitaillaient là. Un gonfleur en forme de charriot à deux roues à bandage plein permettait de procéder à des rééquilibrages de pression et était utilisé lors des réparations de chambre à air.
Le jeudi et le dimanche, il n'était pas rare de voir traîner devant le petit magasin, un des neveux du propriétaire. Celui-ci se faisait aider pour l'occuper un peu et selon 1'usage l'initier à quelques petits travaux.
Un après-midi de grande chaleur, un camion s'arrêta et déposa une grosse roue qui avait besoin d'être regonflée.
Profitant du relâchement de la vigilance de son oncle, le gamin entreprit d'aider le chauffeur au gonflage.
Il fit comme il l'avait vu faire par les hommes : il monta sur la roue, posée à plat sur le trottoir et sautilla sur le pneu pour croyait-il, faire circuler l'air !
Tout à coup dans le silence de l'heure de la sieste, on entendit comme une explosion. La chambre à air malmenée avait éclaté et quelques rares spectateurs ahuris, levant la tête dans la direction de braillements, virent que le gamin avait été projeté sur le toit du magasin. Il se retrouvait assis, les jambes pendant le long du mur de la façade, heureusement indemne, mais vociférant tragiquement.
Chaque fois que j'ai depuis lors assisté à des démonstrations de déplacement dans l'air à l'aide de systèmes comportant des bouteilles de gaz comprimé, je me suis dit que c'était à Aïn-Beïda que l'on avait les premiers expérimenté ce type de propulsion, mais à la chaouïa, avec des moyens plus rudimentaires...
Une épidémie d'appendicite
Dans l'immédiat avant-guerre, le village habitué aux bons soins de "vieux" médecins, vit débarquer un jeune docteur. Grand, mince, bon enfant, il avait tout pour réussir. Il avait été plus ou moins, l'élève d'un chirurgien en renom de Constantine, chez lequel allaient tous ceux qui finissaient par accepter de subir une intervention chirurgicale. Cette fréquentation lui avait laissé un goût certain pour la manipulation du bistouri !
Dès qu'il commença à consulter il découvrit un cas d'appendicite. Qui aurait pu ne pas s'en étonner ? Personne de mémoire d'Aïn-Beïdéen, n'avait jamais eu d'appendicite. C'était un "truc" qui ne pouvait arriver qu'en ville, c'est-à-dire là où il y a des chirurgiens.
Enfin, comme ce n'était pas vraiment une maladie et que l'opération était présentée comme banale, le médecin put y procéder. Le patient en tira une gloire, comme s'il se fût agi d'une blessure de guerre.
Cependant, le cas ne s'avéra pas exceptionnel et un deuxième patient dut subir la même intervention.
Je me souviens très bien d'un troisième cas particulièrement aigu, qui se déclencha publiquement, pendant une séance de cinéma et dont toute l'assistance fut témoin.
Le cri poussé par une jeune fille résonna en plein milieu d'un film de Fernandel, et angoissa le public pendant les dix minutes d'entracte forcé, nécessaire à l'évacuation de la foudroyée.
Ma mère craignant de me voir soumis à un sort analogue se mit à vérifier que je n'avalais pas les noyaux de cerise, pratique enfantine que j'avais pourtant abandonnée à son insu depuis bien longtemps...
Cependant, le sort devait lui être contraire car elle se décida à consulter pour son foie le nouveau médecin. Il reçut mes parents avec la gentillesse qui le caractérisait, examina la patiente puis enfonça promptement son index au niveau de l'abdomen douloureux, lui arrachant un cri aussi aigu qu'une appendicite.
Déployant sa grande taille, le médecin rendit son diagnostic : "Vous allez rire, madame, mais vous avez lune appendicite!"
Ma mère redoutant toutes les maladies, les plus courantes comme les plus rares, les bénignes comme les incurables, ne rit pas du tout. Fort heureusement son appendicite guérit toute seule, au bout de quelques jours, le temps que revienne une bonne "crise de foie" toute banale et identifiée de toute éternité.
Le fontainier et le petit rabbin
Pendant la guerre, les journaux étaient rares. La "Dépêche de Constantine" réduite à une seule feuille était attendue chaque jour, avec une grande impatience. Il faut dire que les postes de "T.S.F" étaient peu nombreux, et chacun essayait d'avoir des nouvelles, tandis que des évènements importants se déroulaient un peu partout dans le monde.
Le magasin de vente des journaux des frères Bentounsi était situé rue de Batna, à quelques mètres du coin du Boulevard Magenta. Bien avant la livraison des quotidiens arrivant par le car, à une heure conditionnée par les aléas de la route, une foule nombreuse stationnait dans le coin.
Pendant les vacances, nous nous asseyions sur un banc de pierre placé sur le Cours, juste en face de la rue de Batna. Nous étions aux premières loges.
Au beau milieu de la chaussée, il y avait une plaque de fonte ronde qui occultait l'entrée d'un "forage" dans lequel une vanne permettait de fermer l'alimentation en eau du quartier. Elle était manœuvrée par Ameur, le fontainier, un Marocain athlétique et aussi gentil que fort.
La circulation étant rare, Ameur déplaçait la plaque pour descendre dans le trou, mais ne signalait pas sa présence, comme on a l'habitude de le faire maintenant.
Ce jour là, nous attendions la livraison des journaux en surveillant le comportement de chacun.
Dans l'assistance, un jeune rabbin, nouvellement arrivé pour une suppléance sans doute, attendait lui aussi. Comme il n'était pas de chez nous, nous étions assez critiques envers son accoutrement. Il portait un costume sombre malgré la canicule, un petit feutre noir comme sa chevelure, sa barbe, sa moustache et même ses chaussures. Il fronçait les sourcils et plissait ses yeux myopes derrière ses lunettes "en fil de fer". Il nous paraissait cocasse, et on imaginait qu'il ne pouvait que lui arriver des mésaventures.
La distribution des journaux s'effectua enfin. Le petit rabbin se plongea immédiatement dans sa lecture, et s'engagea sur la chaussée, le nez collé à son journal. Sans s'en rendre compte, il se dirigea vers le trou de la vanne, et mit un pied dans le vide puis disparut. On entendit un hurlement sortant de la gorge puissante d'Ameur, et le malheureux rabbin se trouva propulsé sur le macadam, en désordre, chapeau, journal et lunettes.
Puis, l'on vit surgir le brave Ameur, qui s'était rendu compte tardivement de la situation. Il releva le petit homme, rassembla ses affaires, l'époussetant, le réconfortant et se confondant en salamalecs. Quant à nous, nous restâmes médusés, ne pouvant réaliser qu'un tel incident ait pu se dérouler sous nos yeux ...
La Visite du Nonce
Le Nonce apostolique Monseigneur Roncali, le futur Jean XXIII, effectuait une visite en Algérie. Une étape à Aïn-Beïda étant prévue, le village fut pavoisé et l'accueil par les Autorités devait avoir lieu sur le Boulevard Magenta.
Le Maire, M.Elie Dokhan, avait délégué pour le recevoir un de ses adjoints, M. Falcou plus instruit en religion catholique que lui-même. Cependant, à la dernière minute il tint à s'informer des fonctions exactes de l'ecclésiastique. On lui dit qu'il s'agissait en fait d'un ambassadeur. N'ayant jamais eu le privilège de fréquenter de personnage d'un tel rang, il décida d'aller lui-même l'accueillir.
Une longue limousine noire s'arrêta au coin du Cours, et son chauffeur se précipita pour en ouvrir la portière. Le Nonce descendit et se présenta devant le Maire. Celui-ci dit quelques mots de vague salutation mais faute de préparation, ne put improviser une suite à son accueil.
Un lourd silence pesa un long moment sur la foule et subitement le Maire eut comme une illumination.
On l'entendit dire d'une petite voix intimidée : -"Et si vous nous donniez...tout de même...une petite bénédiction".
L'atmosphère se détendit tout à coup. Les membres du conseil municipal se reprirent à respirer. Certains osèrent même sourire, se réservant de pouvoir rire ultérieurement.
Le visage du Nonce s'illumina. Il étendit largement les bras, joignit les mains, et bénit la foule sans distinction de croyances.
Jean XXIII
Angelo Giuseppe Roncalli
1881-1963
pape de 1958 à 1963 bienheureux
Conseils à un emprunteur-
Bien que diplômé et propriétaire, on peut se retrouver à court de liquidités. C'est ce qui arriva à un habitant d'Aïn-Beïda qui était pourtant prudent et prévoyant puisqu'il mettait du Vichy dans son anisette.
Il demanda conseil à son chaouch un homme d'expérience. Celui-ci n'ayant pas pu obtenir d'emploi administratif s'était retrouvé réduit au rôle de pourvoyeur en clients pour son plaideur de patron.
Le chaouch rendit son avis, après avoir consommé une douzaine d'anisettes, l'anis étant comme chacun sait, un activateur des neurones.
-"Maître, lui dit-il, il suffit d'aller voir le grand ami de feu votre père -qu'Allah lui accorde Sa miséricorde! Vous prétexterez que vous avez besoin de cinq cents francs pour acheter de la semence pour votre dernière parcelle qui vient d'être labourée. Il ne pourra pas refuser de vous les prêter jusqu'à la récolte".
Le conseil parut excellent et notre homme se demanda comment il n'y avait pas pensé avant. Il guetta la première occasion pour rencontrer le grand ami de son père.
Il n'eut pas longtemps à attendre, en raison du voisinage de leurs maisons, dans la rue de Tébessa.
-"Je n'ai pas encore ensemencé ma dernière parcelle", lui dit-il, après les salutations d'usage.
-"Mon fils, il faut te presser car la pluie ne va pas tarder et ce serait dommage de ne pas en profiter" lui répondit le vieux sage.
-"Mon père avait raison. Il me disait toujours de m'adresser à vous si j'avais besoin de quelque chose."
-Ton père -que le Bon Dieu l'ait auprès de lui ! - C'était un homme comme on n'en voit plus. Il faisait tout en temps et en heure, sans avoir besoin de personne, mon fils."
-"Justement, ce n'est pas facile de lui succéder et pour arriver à...
-"Ton père -que le Bon Dieu lui soit clément! - me disait toujours:
Si un jour, mon fils vient te demander de l'argent, surtout ne lui en prête pas, car avec ce que je lui laisserai, il ne devrait pas en avoir besoin.
Si tu lui avançais une somme qu'il puisse te rendre, cela prouverait qu'en faisant attention à ses revenus, il aurait pu se dispenser d'en emprunter.
Mais s'il ne pouvait pas te la rendre, il n'oserait plus passer devant toi et tu aurais perdu ton argent et un ami... Et moi, je me retournerais dans ma tombe !
Maintenant, si par hasard, tu avais besoin de quelques quintaux de blé pour ensemencer ta dernière parcelle, alors n'hésite pas, envoie-moi ton chaouch et je les lui ferai remettre ...
Allez, Chalom, mon fils..."
Loin d'Aïn-Beïda
A partir de 1942, je passais la plus grande partie de l'année loin d'Aïn-Beïda. En effet, j'avais été obtenu mon Certificat d'études en 1941, mais ma mère avait réussi à convaincre mon père d'attendre un an avant de m'envoyer en pension au Lycée de Constantine.
Pour elle comme pour moi, ce ne fut que reculer pour mieux sauter. Je n'avais jamais quitté ma famille et mon village, jusqu'à ce moment là, à part pour quelques jours en camp scout dans la forêt d'Aïn-Sedjra, à vingt kilomètres d'Aïn-Beïda.
Il s'agissait en fait, d'un arrachement du milieu familial et de l'environnement sécurisant du village. Les circonstances étaient défavorables. Nous étions en pleine guerre et les liaisons entre les deux agglomérations, distantes de 110 kilomètres, étaient difficiles. Le seul point favorable était que Seghir Benbouzid intégrait le Lycée en même temps que moi.
Mon père se chargea de me conduire au "bahut". Je n'ai gardé aucun souvenir de la séparation d'avec ma mère. Mon subconscient a réussi à effacer toute trace de cette épreuve trop douloureuse.
Je découvris un bâtiment du Second Empire, à la structure imposante de couleur grise, situé à l'extrémité de la rue de France, en périphérie du centre de la ville, au bord des gorges du Rhumel.
Au Nord, au-delà d'une Synagogue, le lycée était séparé du boulevard de l'Abîme par la Kasbah dans laquelle se trouvaient l'Arsenal et l'Hôpital militaire. La place Négrier le bordait à l'Ouest.
L'emprise était constituée d'un carré sur lequel avait été initialement construit le premier corps de bâtiment et d'un trapèze qui avait reçu, après la guerre de 14-18 le prolongement de l'ensemble. Cette dernière partie était appelé par les Anciens, le petit Lycée.
En 1942,1'entrée principale était située sur la rue de France. Une grille de "château" donnait accès à une allée bordée de plates-bandes, conduisant à deux escaliers de pierre. Le portail monumental s'ouvrait sur un hall, avec le guichet de la loge du concierge, et une salle qui servait au Conseil des Professeurs, à l'attente des visiteurs et au transit des internes, lorsque leurs correspondants venaient les chercher pour les sorties du jeudi et du dimanche.
Cette entrée perdit sa vocation première en 1943, lorsque la cour qui la bordait sur la gauche, fut transformée en un stade modeste qui donnait sur la salle de gymnastique.
Dans les premiers temps de mon "incarcération", j'ai passé de longues minutes, au niveau de la grille d'entrée dans la cour de récréation, à verser des larmes dans l'attente vaine d'une visite non programmée. Je n'ai jamais osé tenter une escapade. Le courage m'en a toujours manqué sinon l'envie ... mais pour aller où?
Passé le hall, on se trouvait dans une galerie à arcades, fermant l'un des côtés du quadrangle servant de cour des grands. Pendant des années, je l'arpenterai en compagnie de condisciples bien décidés comme moi à refaire le monde. Ce furent de beaux exercices de rhétorique et de dialectique, qui nous formèrent à accepter et à porter la contradiction ...
Lycée d’Aumale
Constantine -Le Lycée en perspective du pont suspendu de Sidi M’Cid
Le bâtiment que l'on découvrait avait plusieurs étages structurés de bas en haut : vie de jour des internes et laboratoire de sciences au rez-de-chaussée, administration et salles de classe sur deux étages, lingerie et dortoirs des grands au-dessus.
Le second corps de bâtiment prolongeait la partie Nord du premier, et disposait d'une petite passerelle. Au rez-de-chaussée, un grand réfectoire débouchait sur une cour qu'une galerie à structure métallique bordait dans l'alignement de celle du premier corps. Elle assurait la liaison avec l'entrée de la place Négrier, qui remplaça en 1943 celle de la rue de France.
Les externes empruntaient à l'Est, le portail du boulevard de Belgique. De là, on découvrait, de l'autre côté du Rhumel, l'Hôpital civil et ses dômes rouges, le Monument aux Morts rappelant l'Arc de Triomphe de Trajan à Lambèse, surmonté d'une Victoire ailée de bronze, dite de Cirta, inspirée d'une statue romaine dédiée à la Tertia Augusta. Au pied du monument, le pont suspendu de Sidi M’Cid, long de 168 mètres enjambait la gorge de l'oued coulant à 175 mètres au-dessous.
Cette porte était interdite aux internes. Parfois, un surveillant tolérait une sortie furtive pour acheter une pâtisserie aux petits marchands, dont les carrioles stationnaient le long du trottoir.
Sur la façade Nord du bâtiment, une horloge marquait et sonnait les heures. La nuit, depuis le dortoir, lorsque je restais éveillé, chaque quart d'heure sonné me rassurait un peu, et finissait par rétablir en moi le calme nécessaire pour retrouver le sommeil.
Tôt le matin en hiver, lorsque je m'étais réveillé prématurément, je redoutais de l'entendre annoncer qu'il ne restait plus qu'un quart d'heure avant les fatidiques 6 heures 30 du lever, qui m'obligeraient à me plonger dans l'ambiance froide et humide de la journée.
Les internes étaient nombreux et venaient de tous les villages et villes du département. Leur effectif comprenait une grande partie d'Algériens, dont la majorité était originaire de Petite Kabylie. Je garde toujours la nostalgie de ces relations fraternelles disparues dans les remous de l'Histoire.
Nos condisciples algériens avaient beaucoup plus de traits communs avec nous que les externes, sans doute en raison des différences de comportement entre les gens du bled et ceux de la ville. Ils présentaient en général, des aptitudes pour les études qui en faisaient des camarades avec lesquels l'on pouvait effectuer en commun un travail très profitable.
Le système pluri professoral de l'enseignement secondaire provoquait un changement total des habitudes scolaires. Heureusement, les professeurs titulaires étaient dans leur majorité, des enseignants de haut niveau.
Cependant, avec la reprise des hostilités entraînant une mobilisation générale, des maîtres auxiliaires et des femmes les remplacèrent jusqu'à la rentrée de 1945, où la Victoire nous rendit les titulaires.
Dans le laboratoire des Sciences, officiait un professeur très ancien "le père" Hauvet, qui disparut un jour sans que l'on en connût les raisons, retraite ou maladie. Des générations d'élèves avaient travaillé sous sa férule dans une ambiance éloignée de l'application studieuse.
Lycée d’Aumale 1947
Malmassari-Nakache-Chéraqui
Coppolani-Gozlan
Flosi-Paganelli
Son domaine était envahi d'un fouillis de cornues, d'éprouvettes et de récipients de cuivre. Des gerboises, des musaraignes, des chatons presque à terme, et toutes sortes de mammifères non identifiés, baignaient dans le formol de bocaux poussiéreux et nous inspiraient de l'aversion.
Lorsque l'on évoquait son nom avec des adultes ayant fréquenté jadis le Lycée, ils ne manquaient jamais de nous dire qu'ils l'avaient connu, sans que nous puissions apprendre si c'était comme professeur ou bien comme élève.
Un autre personnage mythique survolait le siècle. C'était "Cheikh" Lentin dont l'enseignement de l'arabe comportait des performances culturelles exceptionnelles. Il était capable de réciter des pages entières du Coran et sans fin, des vers de poètes arabes ou persans. Il jonglait avec toutes les finesses de la langue, inspirant respect et admiration. J'ai toujours regretté de ne pas avoir pu suivre son enseignement autrement qu'en me glissant à l'improviste au milieu de ses élèves sans que cela lui semblât anormal.
Autant ma mémoire se refuse-t-elle à me restituer une liste exhaustive des noms de mes professeurs, autant quelques noms y restent gravés. Le premier est celui de madame Hartz qui révéla en moi, un goût imprévisible pour le latin. Je lui dois les plus belles découvertes qu'un enfant puisse faire dans une matière aussi nouvelle.
Dans les autres disciplines, des maîtres dévoués et compétents obtenaient de nous des résultats témoignant de la qualité de leur enseignement.
En mathématiques, messieurs Ristori, Recouly et Senkeisen; en latin et français, messieurs Camboulive et Vega Ritter; en histoire et géographie, messieurs Martin et Marion; en physique et chimie, monsieur Serror un khenchelois et enfin, monsieur Mirada qui aurait dû nous enseigner le dessin, mais qui fit mieux en nous faisant discuter de tous les sujets possibles tandis que nous copiions avec application des feuilles d’acanthe et des bustes de plâtre.
Passé le cap des premières semaines, les relations entre des garçons venant de tous horizons trouvaient de justes accommodements, pour rendre acceptable la vie communautaire. Des liens amicaux s'établissaient avec certains, tandis que des antipathies, inexplicables à priori, entraînaient des antagonismes que le temps ne parviendrait jamais à atténuer.
Par chance, je trouvai rapidement les moyens de me rapprocher des premiers et de me tenir à bonne distance des autres. Dès la deuxième année, je pus ainsi m'installer au dortoir dans un voisinage reposant sur des liens de camaraderie noués l'année précédente.
Il faut dire qu'en ce lieu se constituait un mini territoire affectif se substituant à la cellule familiale. Dans ce refuge nocturne, on devait se sentir en sécurité, pour trouver calme et repos. Savoir qu'à deux pas de votre lit, dormaient vos amis, contribuait à éloigner de vous toute forme d'angoisse enfantine.
La sonnerie générale déclenchait brutalement le réveil. Commençait alors ce qui fut pour moi le plus insupportable : le lancinant bruit, fait par le pion frappant dans ses mains, pour ponctuer tout le rituel disciplinaire de nos actions. Deux coups pour se mettre au pied du lit, deux pour s'aligner vers la porte des lavabos, deux pour y entrer et avoir le droit de se laver, deux pour marquer la fin de la toilette, deux se repositionner au pied du lit, deux pour faire son lit et s'habiller, deux pour se mettre au pied du lit, deux pour former les rangs pour quitter le dortoir...
Longtemps après ces années, j'ai entendu ces battements qui étaient devenus, dans les derniers temps de mon internat, la manifestation la plus insupportable d'une autorité que personne ne pouvait d'ailleurs contester.
Les instants les plus agréables étaient ceux que je volais à mon sommeil le matin très tôt au printemps, et que je consacrais à la contemplation du spectacle mille fois renouvelé, offert par les gorges du Rhumel. Pour cela, je me glissais furtivement dans la salle des lavabos, qui donnait sur le boulevard de Belgique, et émerveillé, je regardais les rochers prendre toutes les nuances de l'ocre et du rose, au fur et à mesure que le soleil se levait.
Les internes disposaient d'une salle "d'études" qui leur était affectée par groupe de classes. Des placards individuels étaient disposés sur les murs, et chacun y rangeait ses affaires de cours et quelques objets personnels, dont du "ravitaillement" envoyé par les parents afin de compléter l'ordinaire.
L'arrivée du colis que le convoyeur du car m'apportait chaque semaine, était un moment privilégié. Je retrouvais toute l'attention maternelle dans les friandises confectionnées malgré la rareté de certains ingrédients. Ma mère m'envoyait aussi, du pain qu'elle faisait griller, et qui constituait un apport nutritif précieux. Entre camarades proches, avait lieu le rituel du partage, qui permettait de renforcer la cohésion des groupes.
A l'internat, il y avait naturellement des enfants d'Aïn-Beïda. Je découvris ainsi des garçons que je ne connaissais pas auparavant, en raison de la différence d'âge. Des liens fraternels se nouèrent avec certains, plus âgé comme Dédé Boutégège ou plus jeune comme Fonfon Murienne.
Je garde une reconnaissance toute particulière envers Omar Bendali, qui fit de moi un "intouchable". En effet la première année, nous jouions dans la cour du bas et il n'était pas rare de voir des grands y faire irruption pour perturber nos jeux, en chapardant nos balles ou simplement, en nous bousculant pour faire prévaloir leur supériorité physique. Enfants du bled nous n'étions pas très impressionnés par des comportements violents, mais nous n'avions pas forcément les aptitudes pour faire instantanément battre en retraite le perturbateur.
Connaissant l'esprit de solidarité des gens d'Aïn-Beïda, Salah Zerdani plus âgé, André Boutégège et Maurice Fourment. Je trouvai une parade efficace. Je choisis Omar qui était le plus grand et le plus amical, pour intervenir dans nos conflits. Bravant l'attention du surveillant, je m'échappais vers la cour des grands et ramenais mon Zorro, qui avait tôt fait de rétablir l'ordre. Comme les perturbateurs étaient toujours les mêmes, au bout de quelques fois, l'effet Omar avait définitivement assuré ma protection... vis-à-vis des grands seulement. Je gardais la libre disposition de mes propres moyens envers ceux de mon âge.
Les sorties autorisées avaient lieu le jeudi après-midi et toute la journée du dimanche. Il fallait qu'un correspondant désigné par les parents, vînt vous chercher. Dès 1943, ce fut Rémi Faletti, mobilisé à Constantine qui joua ce rôle. Un de ses camarades le remplaçait parfois. Par la suite, un de mes condisciples, Marc Bonhoure, me présenta à sa correspondante madame Masson, qui joua le rôle d'une bonne grand'mère pour moi des années durant. C'est son fils qui vint régulièrement me chercher jusqu'à ce que mes sorties devinssent libres.
Dans les premières années, ces sorties nous permettaient de nous aérer un peu et d'aller au cinéma. Mais hélas, nous devions au retour traverser le quartier juif où traînaient des GI's en goguette et des bandes d'adolescents dont le faible éclairage de la rue de France favorisait les audaces. Il nous fallait nous organiser en groupes solidaires pour affronter les barrages qui se constituaient sur notre chemin. Heureusement, nous avions en la personne de Seghir Benbouzid, un fin tacticien qui, habitué aux démêlés avec les petits chaouïa manœuvrait en faisant le coup de poing, tandis que nous bousculions les héros de l'ombre, peu habitués à des réactions brutales.
Avec le temps, les choses s'arrangèrent, un peu parce que la fin de la guerre avait dépeuplé le quartier de son marché noir favorisant la constitution des bandes et beaucoup parce nous avions grandi en stature, et que nous avions pris l'allure de jeunes hommes.
L'internat fut pour moi le lieu unique où je pus me "frotter" à toutes les formes de caractères. Ce fut un microcosme où tous les comportements, toutes les attitudes, toutes les qualités, tous les défauts, toutes les facettes de l'âme humaine s'offraient à l'analyse. Par la suite, je n'ai jamais rencontré autre chose que la réplique du monde enfantin que j'y ai connu, seules les circonstances furent différentes.
Mais ce fut aussi l'apprentissage de la solitude morale et de l'ennui qui me gagnait lorsque je n'avais rien d'autre à faire que de déambuler dans ce Constantine austère, dont la tristesse ruisselait sur des murs trop hauts et trop indifférents aux errances du petit Aïn-Beïdéen que j'étais. Je préférais finalement être au Lycée, je trouvais que là au moins je pouvais passer mon temps utilement.
L'internat fut pour moi une rude épreuve psychologique mais ce fut en définitive la salutaire école de la responsabilité.
Les retours à Aïn-Beïda s'effectuaient au rythme des saisons. Je laissais en Octobre les premiers vents de l'automne s'acharner sur les feuilles des platanes du Cours. Je découvrais à Noël tout le village badigeonné de sucre glace, que lissait une forte bise permanente. Pâques me rendait un univers de verdure, de couleurs douces avec comme un air de fête renouvelé. Et enfin je revenais aux premiers jours de l'été pour des vacances qui ne finiraient jamais...
Tout était beau. Chacun avait un nom qui m'était familier. Les années passaient et toutes les choses tendaient à prendre leur forme véritable, celle qu'elles garderaient définitivement pour moi qui étais sans m'en rendre compte, devenu "grand".
Et elles laissaient dans ma mémoire ces traces profondes qui en feraient un jour des souvenirs ineffaçables
In memoriam
Je demande à ma mémoire de me rappeler quelques-unes des personnes, qu'au fil de ces pages, je n'ai pas citées et qui pourtant auraient dû l'être. Elle égrène des noms associés à des faits, souvent anodins d'apparence mais qui y ont laissé une trace indélébile.
Lorsqu'elle me cite un nom, c'est tel souvenir qu'elle veut évoquer. Elle l'y associe automatiquement.
Lucien Faletti me haussait sur ses épaules pour me faire voir le monde au niveau des adultes et répondait sans relâche à (presque) toutes les questions que je ne cessais de lui poser.
Claudine sa sœur me gâtait de chocolat Menier lorsque je n'étais encore qu'un tout petit enfant. Plus tard elle me combla du plaisir de m'accompagner à l'harmonium, tandis que je chantais le "Minuit Chrétien" à la messe de Noël.
Monsieur Soual me fit le merveilleux cadeau d'un vrai faux permis de conduire que je garde précieusement.
Madame Soual me laissait tout interloqué, quand elle répondait systématiquement "Bonjour" lorsque je lui disais "Au revoir".
René Casali fut l'inoubliable complice qui m'apprit à conduire alors que je n'avais que douze ans.
Maurice Solomiac se révéla à moi fin érudit, sous son aspect de colon miséreux, ce jour d'hiver où je le trouvai dans sa ferme gourbi, tentant de réchauffer ses pieds dans un couffin rempli de paille, "Voyage en Italie" de Montaigne ouvert sur ses genoux.
Jo et Raymonde Perri et Charlot et Gracieuse Xicluna, nos tout proches voisins successifs, dispersés par le temps et toujours si présents.
Et Maurice Saurré modulant ses tyroliennes.
Et le "père" Négroni, sous un soleil écrasant, conduisant les travaux de construction des chaussées de ses dameurs, poussant en continu leurs "Ya’llah, Moulana! Ya’llah, Moulana ! Ya’llah, Moulana !"
Et le "père" Lleu et ses angoisses météorologiques.
Et le "père" et la "mère" Xicluna dansant leurs valses chaloupées.
Et le malheureux Bourmis et ses indispensables œuvres malodorantes...
Et les frères Surle décimés par un cruel destin.
Et le Caïd Bourahli, comme Harith-ibn-Abi-Hâlah, le premier martyr de l'Islam, exécuté à genoux et en prosternation, dans la Mosquée.
Et Salah Zerdani, l'ami discret, longtemps après martyrisé.
Et René Bonnotte meurtri dans la chair de ses vingt ans, sur son lit de l'Hôpital Laveran, souriant courageusement à mes visites d'adolescent, qui ignore encore que pour faire son devoir dans la guerre, il faut plus d'abnégation que d'héroïsme.
Et Charles Néglio, Bozzi l'aîné, Albert Allouche, Mohamed, Hocine, Tahar, S.N.P, Sans Nom Patronymique, tombés au Champ d'Honneur pour une Patrie dont ils n'ont même pas pu foulé le sol.
Quelques familles ayant vécu à Aïn-Beïda dans les années 30 et 40
A. AGIUS- AIT SI SELMI- AKOUKA- ALBA- ALLOUCHE- ANCAROLA- ARMERIGO- ASSOULINE-ATTALI- AUDIBERT- AUGER
B. BARKATZ- BARNAVON- RARACCO- BARRET- BATKOUN- BECKER- BEDET- BELHADJ- BENBOUZID- BENBOUDRIOU- BENABYLES- BELGHRIS-BELKHIRI- BENDAL1- BENISTI- BENKEDECHE- BENMECHRI- BENSACI – BENSIAHMED - BENTATA- BENTAYEB- BENTROUDI
C. CAGGIA- CALENDREY- CAPO- CARRÉ- CARCASSONNE- CASABO- CASALI- CASANOVA- CAUSSIDIÈRE- CECCALDI- CHAMSON- CHARBONNEAU- CHARPENTIER- CHARLOI- CHEBAT-CHEMAIK- CHEMLA- CHEMOUNI- CHENTLI- CHETRIT- CHIARINI- CHOUCHANA-CISTERNINO-COHEN
D. DAOUDI- DARMON-DEBOHER- DEBRINCAT- DELVAS- DEMARIA- DEMONDION- DESBANS- DIDIER- DIMEGLIO- DEVISE- DOGHRI- DOKHAN- DOMINICI- DOUMANDJI- DOUVRELEUR-DOYONNARD- DRAGACCI- DESCHIZEAUX-
E. ELKAIM- ESPOSITO- ESPIO
F. FABREGUES- FAGGIANELLI- FALCOU- FALETTI- FERLET- FERONE- FILLOL- FINALTERI- FINIDORI- FIORE - FLENNER-FLORI- FOLACCI -FOUCHER-FOURMENT
G. GABARRE – GABRIELLl- GAMBA- GANDOET- GARDIOLE- GARDON- GARNIERI- GARREAU de LOUBRESSE- GESTA- GIACCOBI- GIORGETTI- GRECO- GRESSET- GRIMALDI- GUEDJ- GUIGUE-GUETALA- GUILLOT
H. HADJHADJ- HAOUZI
I. ICHAI- INGLESE- IMHOFF- IRAX
J.JOUVET
K. KALIFA- KHELIFA- KHENFAR- KHOLADI- KUSSY
L. LAFONT- LAGANA- LAGARDE- LALOUANI- LANASPRE- LAZABI- LAGIER-LABARTHE-LEBOUBE- LECERF-LECOQ-LEROUGE-LLEU- LECERF-LHERITIER- LIPSIN- LO- LOVICHI- LUCAS- LUCCHINI
M. MAGNANI- MAGNOLFI- MANCHES- MANGION- MANEGLIER- MARCEL- MARCHETTI-MARGAGLIOTTA- MARTIN-MASSEUBE- MATTEI- MAUGET-MAURER- MAURIN- MELLOUL-MERCURI-MERMAZ- MESSOUS-MESTRES- MEZIANI- MEDIONI- MIFSUD- MIGNUCCI – MONEGLIA-MORIO- MONNIN - MOSCA- MUGLIONI- MURIENNE- MAURIN- MESSAOUDI-
N. NAKACHE- NAMIA - NAVARRO-NEGLI- NEGLIO-NEGRONI- NOYELLE- NAUD-
P. PALISSER- PASSANANTE- PELISSON- PELLEGRINI- PERRI -PINELLI- PINOT- PRADEILLES- PREA-PRINCE
Q. QUILICI
R. RAFFIN- RAHMANI- RENUCCI- REYNAUD- RIGAL- ROMANI- RUSSO
S. SABATHIER- SALLES- SANCHEZ- SANTONI- SAURE- SCANDER- SIACCI- SILVE- SAUCEROTTE- SEMIDEI- SILVANI- SIMEON - SOUAL- SOULLIARD - SOULIE- SPITERI- SWINEY-STORA
T.TAIEB- TARRIET- TEBESSI- TENOUDJI- TISNE- TIPHINE-THIRIET-THETAUD-TOMATI- TROJANI- TUZZOLINO
V.VASSALO-VAUDEY-VALENTIN-VICIROSSI-VIGO -VIDAL-VESPERINI-VELLA- \IIAL
W. WILLIGENS- WINBRECK-
X. XICLUNA
Z. ZAOUI- ZEDDA -ZERATHE- ZERBIB -ZERDANI- ZERDOUN- ZEMMOUCHI- ZUCCHELI-
Table de matières
1-Avant-Propos
2- Écrire... Pourquoi ? Pour qui ?
3- Photographie aérienne 1960
4- Schéma régional
5- Plan de la ville
6-La création d’Aïn-Beïda
7-Aïn-Beïda et ses environs
8-Structure du village
10- Aïn-Beïda, commune et chef-lieu de canton
13-L'École de la République
17-Après l'école
19- Le boulevard Magenta
22-L’Activité économique
27-Lieux de rencontre
30-Autarcie
32-Menuiserie et bourrellerie
35-Ferblanterie et cordonnerie
37-Tissus etconfection
38-Tissus et confection
39-Bijouterie
40-Caprices météorologiques
42-Agriculture... agriculture…
46-La déchra
48-Le cinéma
50-Le 14 Juillet
54-Les transports par car
56-B.12, B.14, C.4 et Rosalie...
58-Fondouk et Achaba
60-La chasse
63-Les sauterelles
66-Convois en tous genres
69- Les Anglais ont débarqué
72- La vie au fil des jours-Couscous partie
73-Le percheron
74-Le Téléphone et la sirène
75-Traction contre bourricot
76-Le Voleur de poules
77- L’air de la réaction
78-Une épidémie d'appendicites
79-Le fontainier et le petit rabbin
80-La Visite du Nonce
81- Conseils à un emprunteur
82-Loin d'Aïn-Beïda
87-In memoriam
88 -Quelques familles ayant vécu à Aïn-Beïda dans les années 30 et 40
AÏN-BEÏDA-PERSONNAGES
Au champ de courses vers 1930 Monsieur Joseph Renucci notaire et Monsieur Etienne Murienne. Le pilote est Monsieur Colovret de Canrobert.
L’illustration sur l’avion « Mektoub » en lettres arabes
1935-Le Patriarche Benbouzid et Monsieur
Barnavon sur la terrasse de l’Hôtel Coppolani
Dominique Coppolani
Georges Coppolani dans le square en 1947
Georges Coppolani Meknès 1956
Rémy Faletti (debout)-Lucien Faletti(debout)
Coppolani (de dos) Masseube
Méchoui à la Ferme Vincent en 1936
Pascal Inglèse-Allouche-Murienne
Georges et Dominique Coppolani 1962
1941
Bernardini-Gamba-Mignucci-Capo
Gréco-Coppolani-Bernardini
Willigens
Pierre Mercuri-Fonfon Murienne-G.Coppolani
Albert Allouche
André Boutégège
Par Georges Coppolani
|
Georges COPPOLANI
MON PÈRE
M'A DIT
BABBU M' H
À DETTU
Edition
d’Extraits
en
Français, de la version bilingue Corse-Français
Tous
droits réservés ®
|
||||||
La Corse
A V A N T - P R O P O S
Mon père Dominique, né en 1894 à Marignana (Corse) a
84 ans lorsque je le décide à enregistrer les cassettes qui vont servir de
support à ce document.
Je ne l'avais jamais entendu raconter aucune des
histoires ainsi rapportées ni durant mon enfance à Aïn-Beida en Algérie ni
plus tard après 1961 lorsque nous nous sommes rencontrés de façon régulière.
Je l'ai convaincu de se raconter pour plusieurs
raisons.
La première résultait de la prise de conscience du
fait que sur les six enfants de mes grands-parents trois frères avaient déjà
disparu et seules restaient en vie les deux surs plus jeunes que mon père
mais déjà octogénaires.
Le temps faisant son œuvre je craignais que notre
génération ne conserve aucune trace de l'histoire de l'expatriation de notre
famille de Corse vers l'Algérie.
Je l'avais certes entendu parler le corse à diverses
occasions d'une part, avec les compatriotes du village de mon enfance mais
sans que ce fussent de longues conversations et d'autre part, au téléphone
lorsqu'il voulait que ses propos ne fussent pas compris d'un éventuel
indiscret sur la ligne, en ces temps de centraux téléphoniques manuels. En
tout cas, il n'avait pas parlé le Corse depuis la disparition de son frère
François en 1962, donc vingt ans auparavant.
C'est la raison pour laquelle je lui ai demandé de
s'exprimer dans sa langue maternelle, dans la mesure du possible, le
soumettant ainsi à une rude épreuve intellectuelle en raison de son grand
âge, espérant la surprise et le plaisir de voir mon entreprise couronnée de
succès.
Cependant seule la première partie de ses propos est
en Corse. Est-ce le fait d'un curieux hasard ou bien est-ce dû à la fatigue,
mais la coupure correspond à l'époque de son éloignement de la cellule
familiale.
Enfin le dernier motif de cette opération était que
mon père n'avait jamais raconté "sa" guerre et que ne semblait
devoir en rester que quelques souvenirs matériels comme son Livret matricule
une copie de sa Citation et enfin le cadre commémoratif avec sa Croix de
Guerre et ses autres décorations qui d'ailleurs n'avaient jamais trouvé de
place sur un mur. En tant qu'officier j'avais toujours regretté de tout
ignorer du jeune combattant courageux qu'il avait été.
Sur ce dernier point il ne nous a livré qu'une seule
anecdote, décevant ainsi notre attente mais confirmant ce que nous savions
déjà de sa réticence à "jouer les anciens combattants".
Les enregistrements ont été effectués au cours de
soirées dans la maison de La Colle-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes où mon
père vivait seul depuis le décès de ma mère en 1971,avec comme deux seuls
auditeurs quasiment muets mon épouse Gil et moi-même. Les moyens en étaient
rudimentaires.
Il n'y avait naturellement aucun canevas. Les propos
se sont donc succédés de façon naturelle, sans ordre chronologique et avec le
minimum d’interventions de notre part afin de ne pas risquer de faire perdre
le fil du récit ou compromettre la nécessaire concentration de mon père
surtout lorsqu'il s'exprimait en corse.
L'enregistrement commençant tout-à-trac par des
"histoires" sans liens de lieu ni de temps entre elles, j'ai
résisté à la tentation de les replacer dans leur contexte réel. De même
n'ai-je pas voulu corriger l'oralité. du style et entreprendre une espèce de
réécriture.
J'ai laissé aux rares paroles des auditeurs leur
forme syncopée inhabituelle dans un texte conventionnel.
En ce qui concerne la langue corse, j'en ai
transcrit les phrases telles que je les ai comprises selon l'orthographe
actuellement admise et le vocabulaire en usage dans la piève d'Evisa.Le texte
n'a fait l'objet d'aucune relecture « savante »,les erreurs en seront ainsi
facilement pardonnées.
Ce document comporte trois parties:
-la première précise quelques éléments relatifs à la
Corse et à Marignana village d'origine des Coppolani à l'établissement de la
famille à Colbert et aux lendemains de la Grande-Guerre.
- la deuxième est la transcription des récits de mon
père
|
||||||
|
La Corse et Marignana, le village
d’origine des Coppolani
|
||||||
Montagne dans la mer, la Corse au début du XXè
siècleétait constituée de villages accrochés sur des pitons dominant de
profondes vallées. Peu de routes empierrées. Quant au maquis fait d'essences
diverses : genévriers, chênes verts, lentisques, arbousiers, on ne le prenait
pas, on prenait ses sentiers muletiers.
Les villages vivaient en autarcie totale. L'économie
de subsistance reposait sur l'élevage et une petite agriculture de montagne.
Les côtes infestées de moustiques étaient désertées. Tout ce qui venait de la
mer était suspect ... et pour cause.
La langue et la religion formaient le ciment du
peuple corse. Chaque individu avait le sentiment d'appartenir à une
communauté solidaire dans laquelle s'entrecroisaient les liens familiaux de
la "sterpa", la lignée. Ces liens pouvaient s'étendre aux villages
voisins de la "pieve" qui deviendra le canton. Le "pater
familias" réglait la vie de la famille.
Les hommes mourant tôt, les vieillards étaient rares. Ils vivaient
entourés d'une aura résultant de leur expérience et de leur sagesse: austérité
et mesure dans le langage et les gestes, la violence verbale entraînant
immanquablement la violence physique. La langue Corse, unique et intangible
depuis le bas-latin du Vé siècle, traduisait admirablement dans sa richesse
pratique les récits légendaires peuplés d'énigmes, de mythes et de mystères. Elle
véhiculait la tradition, elle était l'âme du peuple Corse et symbolise
l'attachement à la mère, à la famille, au village et à la patrie Corse. Elle
persistait au delà du développement de l'Ecole de la IIIè République. Dans
l'expatriation sur le continent et sur les terres lointaines de l'Empire
colonial français, elle était le signe de reconnaissance entre les
insulaires.
Marignana est un village situé dans la
"piève" d'Evisa, à six cents mètres d'altitude, "à
1'umbria", face au nord, sur la rive sud de la vallée du Porto.
Le village est réparti en plusieurs quartiers. Celui
où est bâtie la maison ancestrale des Coppolani "u capu supranu ".
Cette maison, comme nombre de celles du village,
jouxtait une maison mitoyenne sur cette butte supérieure. Elle était située aux abords d'une espèce
de rotondité, une coupole qui a donné leur nom aux Coppolani en 1700.
Fait unique, cette maison disposait de la seule
place privée du village peut-être une survivance du droit du premier
occupant.
On est surpris par l'étroitesse des lieux, tandis
que les familles sont nombreuses. Il faut dire que les Coppolani possèdent
une autre petite maison à Revinda, sur le chemin de transhumance vers le
Golfe de Chjuni, dans laquelle séjournent ceux qui accompagnent le chef de
famille et les troupeaux.
|
||||||
|
Érigé en 1935 à Marignana à la
mémoire de
Xavier COPPOLANI, Fondateur de la
Mauritanie
|
||||||
À la maison restent durant une grande partie de
l'année, en hivernage la mère, les filles et les tout jeunes enfants.
Les villageois vivaient essentiellement de
l'élevage. Ils disposaient de jardins potagers, à proximité et d'enclos plus
éloignés, permettant de cultiver le foin et la luzerne et de planter quelques
arbres fruitiers. Mais l'économie profite du véritable arbre à pain qu'est le
châtaignier dont on tire la nourriture et aussi le bois nécessaire aux
charpentes et aux planchers des maisons.
Séchées grâce l'âtre mobile, la charcuterie et les
châtaignes, moulues en farine servent d'échange avec les colporteurs qui
apportent quelques ustensiles indispensables, des outils fabriqués en
Castagniccia et des tissus de coton servant à confectionner des robes et des
chemises.
Quand les troupeaux séjournaient aux environs du
village, les fromages étaient fabriqués à la maison, mais le plus souvent
dans une cabane de pierre au toit de bardeaux, laissant s'échapper la fumée
du foyer. Le fromage frais provenant de la recuisson du lait de chèvre était
mis à égoutter dans des faisselles de jonc tressé, puis à sécher dans une
grotte. Ils étaient ensuite périodiquement ramenés au village.
Les Coppolani disposaient à proximité de Marignana,
sur une colline descendant jusqu'à la rivière du Porto, de terrains qu'ils
démaquisaient puis labouraient à l'araire, charrue sans roue dite arabe en Afrique du Nord, tirée par un âne ou un
mulet, plus rarement par un bœuf.
Ils y cultivaient de l'orge ou du maïs, puis du
froment les deux années suivantes. Ils laissaient ensuite, comme tous les
villageois, repousser le maquis jusqu'au nouveau cycle d'une dizaine d'années.
Près du Porto, ils aménageaient des « planches » de
terre sur lesquelles ils cultivent des légumes. La rivière fournissait des
truites attrapées à la main sous les rochers. Des pièges faits de crin de
cheval capturent des merles et des grives, les cartouches étant trop chères
pour un tel gibier.
Les garçons étaient habitués très tôt à suivre le
père ou le grand-père, nus pieds, vêtus sommairement, couverts d'un manteau
de laine, filé par la mère et les filles, et de jambières de peau de mouton
protégeant contre le froid. Ils apprenaient à construire en mortier l'enclos
où les bêtes étaient remisées la nuit. Ils veillent ou somnolent près du feu,
sous le manteau-cape dans une crainte permanente de la nuit et de ses
maléfices. Les chiens enfermés avec les troupeaux garantissent contre les
renards.
Le père ou un oncle âgé évoquait à la veillée les
temps anciens. Il racontait les exploits légendaires, souvent contre les
Sarrasins, et pouvaient désigner tels éboulis sous lesquels seraient enterrés
quelques assaillants aventurés de Chjuni à Marignana.
Les garçons s'initiaient aussi à l'art s joutes
oratoires chantées peut-être héritées de ces mêmes Sarrasins, dans lesquelles
intervenaient imagination, art de la poésie et de la réplique juste et
humoristique. Les Marignanais en étaient très friands.
|
||||||
Peu d'instruments de musique à part la
guimbarde. Cependant les Corses
excellent au chant polyphonique auquel les tout petits s'exercent très tôt.
La vie des enfants était rythmée par la vie
économique. Il n'y a pas d'école avant le milieu du XIXe siècle. La majorité des habitants du village est
illettrée. Avant 1850,seul le curé enseigne-t-il quelques rudiments
d'écriture et de lecture. Rares sont ceux qui savent signer et bien souvent
s'agit-il d'une simple transcription du dessin de leur nom.
Mon propos étant d'introduire les "dits"
de Dominique mon père, j'ai voulu définir le cadre et les conditions
économiques de la famille au XIXè siècle afin de mieux comprendre les motifs
de l'expatriation vers l'Algérie.
Domenico Maria et son épouse Luciani Giacinta
donnèrent naissance à neuf enfants dont quatre s'expatrieront vers l'Algérie.
Les conditions de vie d'une famille onze personnes à
Marignana étaient très difficiles. Elles provoquèrent le départ vers l'Algérie
de Maria Anna leur second enfant qui avait épouse en 1879 Lugano Jean un
colon originaire la région des établi
à Sidi Merouane fut rejointe par le dernier fils Xavier qui sera plus tard le
Fondateur de la Mauritanie. Enfin l'aîné Anton’ Francesco s'établit à Thamala
puis à Tocqueville en 1892.
Après la mort de Xavier à Tidjikdja en 1905, Santu
(Toussaint) mon grand-père obtint une concession à Aïn-Oulmen (Colbert) en
1906,dans la région de Sétif.
Il est âgé de 50 ans et avec son épouse Leca Julie, ils
ont six enfants, nés dont Dominique mon père en 1894,
Mes grands-parents parlaient uniquement le Corse.
Mon père venait d'être reçu au Certificat d'études primaires "le premier
du Canton".
|
||||||
L'établissement à Colbert.
Colbert est situé dans une région au sol
ingrat et au climat rude, chaud en été et froid en hiver.
Les concessionnaires ont l'obligation de construire
dans les plus brefs délais maison d'habitation et abri pour bêtes et matériel
de culture, sans obtenir les moyens nécessaires alors qu'ils sont, par
définition même, pauvres voire miséreux et n'ont en général pas les
connaissances techniques indispensables pour exécuter de tels travaux.
Tandis que des cousins germains de mon grand-père
procèdent aux travaux de maçonnerie avec les garçons comme manœuvres, les
premières tentatives
La population autochtone vit dans le plus grand
dénuement et les européens déjà installés sont tout juste mieux lotis.
Les premiers travaux agricoles révèlent la mauvaise
qualité de la quarantaine d'hectares concédés répartis en parcelles souvent
éloignées les unes des autres. Les moyens matériels se réduisent à une seule
charrue prêtée par Anton ‘Francesco mon grand-oncle.
Les trois garçons les plus âgés sont donc obligés de
s'employer à diverses activités afin de gagner un peu d'argent pour faire
face aux besoins essentiels de la famille.
Les conditions climatiques défavorables ne
permettent pas d'effectuer des récoltes substantielles. Les mauvaises années
sont les plus fréquentes. Elles obligent à recourir aux prêts hypothécaires
pour pouvoir continuer à labourer, à ensemencer et à tenir jusqu'à la
prochaine récolte.
Quelques temps avant la Grande Guerre, mon père
obtient un emploi de facteur En 1914, Joseph et François sont déjà sous les
drapeaux. Mon père est incorporé au 3è Régiment de Zouaves à Constantine. Il
participe à la constitution du 2è Régiment de Marche d'Afrique qui embarque à
Bizerte en Octobre 1915 pour prendre part aux combats sur le front d'Orient,
à la Campagne de Serbie et des Dardanelles.
Il reste en opérations pendant vingt-quatre mois
consécutifs. Il fait l'objet d'une citation et se voit attribuer la Croix de
Guerre avec étoile de bronze. Son régiment est décimé perdant 50 Officiers et
1500 Zouaves ce qui provoque sa dissolution.
Après une permission, il est affecté au 5è Régiment
de Tirailleurs Algériens et est envoyé au début de 1918 à Foum Tataouine,
dans l'Extême-Sud tunisien. Mon père ressentira jusqu'à la fin 1940, les
séquelles de la dysenterie amibienne contractée en raison de l'état sanitaire
de la troupe.
Mon père m'a dit
Tu veux toujours que je te raconte des histoires,
mais je peux t'en raconter des histoires parce que tu sais, j'en connais mais
ce sont des petites histoires de rien du tout… ce sont des faits
insignifiants de la vie de tous les jours...mais quand même c'est peu des
choses à raconter.
Moi : « De toute façon c’est cela que je voudrais
pour une fois que tu nous raconte. Ce sera suffisant... »
L'expatriation de Corse vers l'Algérie
Le départ et le voyage
Si tu veux savoir comment nous sommes partis de
Corse je vais te le dire.
Pour nous Marignana, c'était Marignana...
Moi : « Oui comme pour moi, Aïn-Beïda c’était
Aïn-Beïda… »
Mais si tu le sais, je ne te le rappellerai pas: le
frère de mon père qui était en Mauritanie avait été tué. À la suite de cela,
on nous a dit: "Si vous voulez demander une concession en
Algérie..."Et mon père, tu sais, avec six enfants, quatre garçons et
deux filles, il commençait à beaucoup souffrir.
Alors il a dit: "En bien! Demandons-la."
On l'a demandée, mais je ne peux me souvenir de qui l'a demandée ni qui a
fait toutes ces histoires qui étaient nécessaires pour avoir un peu de terre!
Le titre de cette concession est arrivé. Nous avions
déjà des parents en Algérie, une soeur de mon père. Et nous avons décidé de
partir tous. C'est ce que nous devions faire. Mais ça se prépare ça! Il faut
trouver un chariot pour transporter le matériel, il faut tant de choses.
Finalement nous avons été prêts, fin prêts.
Les amis arrivent à la maison pour dire au revoir.
Mais il m'en est arrivé une! Nous
jouions sur la place de la maison, près de celle-ci nous jouions au rampinu.
Le rampinu, savez-vous ce que c'est? On trace un
cercle et il y a un des joueurs qui sort du rond' et laisse tomber, en courant,
un foulard ou un chiffon aux pieds de l'un de ceux qui lui font face.
Celui-ci se met à courir vivement et laisse tomber le foulard à son tour.
Ainsi mon tour est arrivé et l'on a laissé tomber le
chiffon. Je l'ai vu, alors comme les autres je l’ai pris et je me suis mis à
courir. Lorsque je suis arrivé, il y en a un qui m'a mis un pied en travers,
j'ai butté et je suis tombé lourdement heurtant juste de la tête une pierre
qui se trouvait sur la place ...Alors le sang s'est mis à couler ... Le sang
tourne en Corse! Et puis ma mère est arrivée. On a appelé mon père, on a
appelé tous ceux qui s'embrassaient.
Ma mère: « Oh! Ce n'est rien ».Et puis une amie qui
se trouvait là, une cousine, qui sait, je ne me souviens plus, a pris dans la
cheminée un peu de suie et allez! Qu'on lui en mette pour que le sang ne
coule plus, qu'il reste là où il est! Il n'est plus sorti! C'était le
principal!
Et dès l'aube, nous sommes partis. Mais le voyage
... deux ou trois jours, d'abord
Sagone et d'autres, lieux... la tête me faisait mal et j'ai commencé à
pleurer...
Et dès l'aube, nous sommes partis. Mais le voyage
... deux ou trois jours, d'abord
Sagone et d'autres, lieux... la tête me faisait mal et j'ai commencé à
pleurer...
|
||||||
Lorsque nous sommes arrivés à Ajaccio, mon père a
dit. « Il faut aller à la pharmacie.»Et nous y sommes allés.
-"Mais qu'est-ce que vous avez mis à ce
gosse?"
-"Nous lui avons mis ce que l'on met pour que
le sang ne sorte plus! On lui a mis... qui sait, nous, nous ne savons pas ce
que sont les médicaments."
Ils m'ont mis de la teinture d'iode et la suie est
partie. Et puis l'heure de prendre le bateau est arrivée et nous avons
embarqué. Mais ma tête me faisait mal, un jour, deux jours, trois ou quatre
jours, je ne sais combien on mettait pour aller à Bône. Parce que nous
devions débarquer là bas.
|
||||||
Arrivés à Bône, mais vous ne pouvez pas savoir...
vous ne pouvez savoir comment était ma tête. Elle était le double de ce
qu'elle était quand nous sommes partis. Il y avait eu ces deux ou trois jours
de voyage par mer et ce bateau! Non seulement elle avait doublé, mais...
triplé... sûr! La fièvre commençait, tu sais, mais grâce au Seigneur, un
cousin de mon père tenait une pharmacie à Bône: mon père avait de nombreux
parents: ils étaient quarante-deux cousins germains au village, au village et
à Evisa et autres lieux.
Ce cousin s'appelait Luciani autant que je me
souvienne. Nous sommes vite allés voir Luciani. Il était content! « Qu'avez-vous fait à ce gosse? Que lui avez-vous fait? » Et tant de choses
...
Ma mère : « Mais on lui a mis... il est tombé... en
vérité... »
Mon père:« C'est le voyage... le voyage... « »
Alors il s'est mis à l'ouvrage tu sais, il m'a
arrangé un peu et je n'ai plus eu cette douleur.
Et puis nous avons pris le train pour aller à
Constantine. Tu m'as compris, ce train! Maintenant je me souviens qu'il y
avait dans ce train des militaires... des soldats. Ces soldats chantaient une
chanson que je ne me rappelle plus... ça ne fait rien!
Nous avons débarqué de ce train à Constantine.
Eh bien! Constantine était une grande ville, mais il
y a un pont qui me faisait peur. Et comme il était neuf ou dix heures du
soir, nous sommes arrivés sur ce pont qui me faisait peur parce que
c'était...
Moi :-"Le pont suspendu?"
Non, le pont d'El Kantara, le pont d'El Kantara,
voyez si je me souviens encore... parce que cette histoire-là quand j'avais
onze ans, moi il s'est écoulé plus d'un demi siècle(En fait soixante-douze
ans) quand je vous la raconte maintenant, sans en avoir l'air.
|
||||||
|
Pont d’El Kantara
|
||||||
Nous passons le pont et nous entrons dans le centre
de Constantine. Mais il fallait se coucher quelque part. Mon père dit: « Il y
a une auberge nous allons demander une chambre..."
Nous y sommes allés, mais pour demander cette
chambre, mon père ne savait pas parler le français,ma mère encore moins, et
nous qui étions prétendument instruits: et nous étions les trois frères,et il
y avait Joseph, il y avait François, et puis il y avait moi aussi, que l'on
appelait Dumè, « O Dumè! »
Il fallait demander cette chambre. Et nous qui
connaissions le français mieux que les Français de France nous n'osions pas
parler avec les gens pour demander cette chambre. Stupide! Alors mon père a
dit: chambre, chambre, ouna chambre,
ouna chambre! Et on nous a
donné une chambre et nous avons dormi.
Le jour est venu, et nous sommes partis avec un
autre train pour Sétif. Ce train! Mais ma tête ne me faisait plus mal quand
nous sommes arrivés.
Mon père avait une sœur qui était déjà mariée en
Algérie, à Tocqueville comme cela s'appelait.
Nous sommes allés là-bas, en premier lieu dans ce
village.Et nous y sommes arrivés.... mais je veux te dire, si je ne l'ai pas
déjà dit, cette sœur était mariée avec un grec à la barbe noire.
Moi : « Comment s'appelait-il? »
Il s'appelait Lugaro. « Un Grec de Cargèse » Un Grec
de Cargèse, oui, pas un Grec de Grèce.
Moi : « Oui, oui, un faux Grec, un Grec Corse!"
...
Un vrai Corse de Cargèse. Les Grecs, vous savez
qu'ils sont venus une première fois à Paomia, et par nous ils ont été jetés
dehors, quand ils ont eu fait fructifier la terre de Corse si généreuse ...
A Sétif, ils nous attendaient avec une voiture. Ils
nous ont pris et nous sommes restés un mois chez eux qui avaient une
propriété... tu sais... une propriété enfin si on peut appeler ça une
propriété! Et ils nous ont prêté une charrue. Et puis, nous sommes allés dans
cette concession à Aïn-Oulmen en Arabe et Colbert en Français.
|
||||||
Colbert et la construction de la maison.
Et nous voici donc à Colbert.
Mais en Corse je voudrais te dire que cette terre
qu'on nous avait donnée en concession... 0 Signore! Una tarra ingrata: O
Seigneur ! Une terre ingrate et puis en trois morceaux, dispersés de sept à
huit kilomètre… à parcourir bien sûr à pied à l’aller et au retour et puis
une misère…une terre qui ne valait rien et loin des lieux d’habitation. Et il
fallut se mettre immédiatement à l’œuvre car l’Administration n'avait pas
oublié son exigence de construire avant tout la maison, de planter des
arbres, de remplir tant d'obligations, alors que nous n’avions rien.
Et bien nous avons commencé par faire la
maison. Pour cela nous avons cherché
des gens pour construire les murs. Il n'y en avait pas à Colbert. S'il y
avait des colons anciens, il n'y avait aucun maçon.
Chacun avait
fait come il a pu.
|
||||||
|
Couple patriarcal Coppolani en
1938
|
||||||
Moi : « Les
anciens colons, comment avaient-ils fait ? »
Les anciens colons... je n'en sais rien, ils avaient
fait leur maison comme nous l’avons faite, peut-être.
Moi : « Sûrement !
»
Si bien que mon père a fait venir de Corse deux
parents, c'étaient des cousins qui étaient maçons. L'un je me souviens bien
c'était un frère de ma mère.
Et l'autre, c'était le mari d’une sœur de ma mère,
Et ils se sont mis au travail, avec nous bien sûr. Avec un tombereau nous
allions chercher des pierres et ainsi la construction a commencé.
Les premiers temps
Et puis nous avons commencé à travailler et mon père
a emprunté pour pouvoir acheter des vaches et des mulets au marché de Sétif.
Et nous avons entrepris les labours. Pour pouvoir manger, nous avons
construit un four car ma mère voulait toujours faire son pain. Des sous, il
n'y en avait pas, des sous nous n'en avions pas. Alors... pour acheter du
pain...
Nous sommes allés travailler dans une pépinière de
la Commune, les trois garçons de seize, quatorze et moi douze ans, pour
quarante, trente-cinq et trente sous par journée de douze heures.
Et ensuite l'affaire s'est arrangée! Joseph
travaillait, François aussi... et pour moi, un parent de mon père, un certain
Luciani du « Gouvernement général »,est intervenu et les choses ont été
entendues: moi, facteur, tu sais que c'était quelque chose! Vingt francs par
mois, c'est combien?... Ça ne fait rien. Maintenant, à toi je peux le dire ce
que faisait ma mère pour avoir quelques sous. Elle façonnait ce qu'ils
appelaient des gandourahs. Elle faisait une gandourah pour vingt sous.
Et pour les faire plus vite, une, deux, trois,
quatre par jour, car ils étaient contents d'avoir pour vingt sous une gandourah
toute faite, moi j'ai appris... nous avons acheté une machine à coudre, et
couds, et couds, allez... pédalez, pédalez: une gandourah pour seulement vingt sous!
Mais quand je suis devenu facteur, tu sais...
j'encaissais toute l'année et puis au jour de l'an, comment dit-on en corse
les almanachs? Eh bien, je me faisais des sous, on me donnait un franc, un
franc, vingt sous et certains quarante. Deux de ces conseillers, cinq francs:
avoir cinq francs c'était quelque chose!
Le vol du bétail
Je dois dire qu'avec les Arabes nous n'avons jamais
été ennemis, nous les avons toujours aidés. Mon père ne savait encore pas
parler l'arabe, mais il était estimé. Il payait ceux qui travaillaient et
puis il avait des amis Arabes.
Or un jour lorsque nous sommes sortis pour nous
préparer à aller au labourage...Que se passa-t-il? Les bêtes étaient parties,
ils avaient vidé les écuries! Ils avait vidé les écuries, chèvres, vaches,
mulets et chevaux tous étaient partis!
Moi : -« Ils avaient tout volé? »
Tout volé, sans rien laisser, pour un peu ils
auraient emporté les poules ... mais là-bas les vols étaient presque
autorisés... Tu vois un peu ce que cela pouvait représenter de voir les
écuries vidées!
Alors on va chez l'Administrateur dire de faire
quelque chose. Chaque fois, il y avait un de ces colons qui trouvait son
écurie vide. Bon! Eh bien! On va chez l'Administrateur. Il y avait un
Administrateur... une Administration, comprenez bien, dans un village comme
celui-là où il y avait peut-être à ce moment-là, une trentaine de colons et
tous les enfants en nombre.
Mon père va déclarer à l'Administrateur.
-« Voilà ce qui arrive, l'écurie est vide, ils ont
tout emmené. »
-« Ah! Bien! ça va bien, on va faire des recherches.
Comme on dit toujours, les Cavaliers sont là, on va les faire partir.
Mais pendant ce temps-là les mulets et les chevaux
et ceux qui les avaient pris... Que pouvions-nous faire? Que devait-on faire?
Deux, trois jours, quatre jours se passent et puis
un beau jour mon père dit: « Tranquillisez-vous, moi je sais ce que j'ai à
faire! Je vais aller chez mon ami le marabout. » Ce marabout était à quelque
dix kilomètres dans la montagne.
Mon père a pris une caissette avec de quoi manger en
route. Il avait l'habitude de marcher, pas comme on fait maintenant... Et
puis allez!
Moi :-« Il est allé voir ce marabout? »
Oui, il est allé voir ce marabout qui lui a demandé
: « Qu'est-ce qu'il t'arrive? O Coppolani, qu'y a-t-il? »
-« Ce qui m'arrive, en arabe je ne sais pas te le
dire... ».Mais comme tous ces marabouts comprenaient le Français... « On m'a
pris tout ce qu'il y avait dans l'écurie. »
-« Comment? À toi? Comment, ce n'est pas
possible! Que me dis-tu ? »
« Ils m'ont vidé l'écurie, ils ont tout pris les
vaches, les mulets et tout! »
-« Pas possible qu'on t'ait fait ce coup-là à toi.
Ce n’est pas possible, c'est une histoire que tu me racontes là ! »
Eh bien! Tu veux que je te dise, le marabout lui a
dit: « Rentre chez toi et puis... dors tranquille, ce n'est pas la peine de surveiller quoique ce soit. Demain tu
verras ce que l'on t'a pris, tu verras ou dehors ou dans l'écurie et tu auras
tes bêtes là-bas. »
Et c'est ce qui s'est passé. Le lendemain matin, nos
bêtes étaient là sur la place des meules, d'un côté et de l'autre parce que
l'écurie était fermée. Ils les avaient ramenées et toutes.
Alors qu'est-ce que tu penses? Ce n'était pas une
amitié? Ce n'était pas une amitié avec ces Arabes ?Et il en a toujours été
ainsi! Nous n'avons jamais eu d'histoire avec les Arabes.
Si on voulait être respecté, il fallait les
respecter.
Moi-« "Les autres avaient des histoires... »
Oui, certainement, ils en ont eues, et souvent ils
n'ont pas retrouvé leurs bêtes. Il faut reconnaître que les Arabes volaient
pour manger. Ils allaient pendant les moissons remplir deux ou trois filets
de grain, ils les mettaient sur les mulets et partaient.
Et oui, c'était du vol... mais c'était pour manger,
parce qu'ils n'avaient rien. Ils avaient des petits socs de petites charrues.
Quelquefois, il y avait même la femme qui aidait à traîner...
Alors, nous n'avons jamais porté plainte s'ils nous
enlevaient un ou deux tas... par
erreur…un ou quatre tas qu'on laissait sur place avant de les ramasser avec
les chariots.
Nous n'avons jamais porté plainte parce qu'ils
étaient miséreux et nous savions ce qu’était que la misère, ils n'avaient
rien à manger... et ainsi nous laissions faire.
Avec les autres colons
Moi:« Lorsque vous êtes arrivés à Colbert, il y
avait déjà des colons... »
À Colbert, il y avait déjà des colons, mais il y
avait aussi non seulement des Français
de France mais deux familles de Corses: Mattei et Corteggiani.
Mattei était un petit bonhomme, tu sais, un de ces
hommes peu forts, mais qui était capable. Et Corteggiani était un de ces
hommes forts et grands: peur de personne. Mais Mattei et Corteggiani
n'étaient plus amis... pour des raisons mineures comme cela arrive toujours
dans les villages. Alors ils ne se parlaient plus!
Le soir, tous ces colons allaient se réunir au café.
Avec ces colons qui venaient de l'Ardèche ou de je ne sais où, il y avait
toujours des zizanies. Ils étaient toujours contre un de ces Corses.
Un soir au sortir du café, et parce que l'un était
Corse et les autres n'étaient pas Corses... « Hé Corteggià! ». Je pourrais
dire que ce n'était pas du Corse mais ils voulaient imiter l'accent que nous
avions? Alors d'un mot à un autre, descendant vers la maison de Corteggiani,
ils ont attrapé celui-ci et ont voulu le bastonner. Cependant Corteggiani
n'était pas homme à se laisser faire, mais contre six ou sept... il a
commencé à cogner et crier tandis qu'il arrivait en face de la maison de
Mattei ...
Lorsque Mattei a entendu la voix de Corteggiani et a
facilement compris que les Français étaient en train de le bastonner, il a
ouvert sa porte et dit: « Tiens bon, ô Corteggiani! Maintenant voici de
l'aide! ». Et le fusil en main, on entendit deux coups, pan et pan! Et ces
Français s'en sont allés comme les oiseaux quand ils entendent des coups de
fusil!
Et puis pour nous, même chose... toujours ce parler
Corse, l'accent, tu sais! Alors, « Hé, hé, qué... encore toi... encore toi,
le Corse, encore toi... »ça ne finissait jamais. Chaque jour qui passait, battez-vous à
coups de poings!
Un samedi soir, cinq ou six se sont rassemblés et
ont recommencé: « Hé! encore toi! »Nous sommes allés à la maison et avons
pris des bricoles derrière le jardin, vers les meules de foin, tu sais, et de
paille... mais nous voulions ... alors bon, nous étions près de ces meules...
Joseph se tenait sur l'une d'elles, nous nous battions à coups de poings...
le sang commençait à pisser et l'affaire n'était plus facile.
Que fait Joseph? Il descend soudain tout prêt avec
son couteau, mais savez-vous ce que c'était que ce couteau, un couteau pour
préparer la ration des mulets et des chevaux... un triangle! Un triangle! Et
quand ils l'ont vu venir, ils se sont alors dispersés et très vite ils se
sont sauvés ces sacrés gars... !
Moi :-«
Pourquoi vous cherchaient-ils la bagarre? »
Ils nous cherchaient la bagarre parce que nous
étions Corses. Nous étions Corses, voilà.
Nous n'étions pas de leur pays, la France des Français.
Moi :-« C'était à cause de l'accent? »
Eh oui! Toujours: « Encore toi... encore toi... »
Nous en avions assez de cet encore toi.
Moi :« Parce qu'eux n'avez pas d'accent ? »
Eux, comme s'ils n'en avaient pas! Tu parles...
qu'ils n'en avaient pas. Mais nous...
Moi -« "Ils avaient l'accent de l'Ardèche ?...
»
Ils avaient l'accent de l'Ardèche, de l'Ariège et à
savoir d'où encore... l'accent savoyard ou toulonnais, je ne sais pas mais en
tout cas ils avaient autant d'accent que nous, parce que ces colons de
France, on en avait envoyés de toutes les régions!
Moi-« Des régions pauvres? »
Oui, des pauvres, de vrais pauvres, ce n'était que
ceux-là, et qui avaient beaucoup d'enfants à nourrir, qui partaient ! Alors
quelques-uns sont tombés sur de bonnes terres et ils ont fait fortune. Et
puis les autres... c'est une autre histoire, qu’est-ce que tu veux? La
majorité des autres ont été obligés... année après année... une fois la
récolte était bonne, dix fois elle était mauvaise, si bien que l'on a vécu
comme on a pu.
Et le temps a passé
Et le temps a passé, ces réunions des autres colons
avaient cessé. Pour continuer cette histoire, l'un de ceux que nous appelions
les Français s'est marié avec une de mes sœurs et un autre avec une Arabe.
Lorsqu'ils se sont mariés c'était pour avoir des enfants et ainsi fut fait et
la vie a continué.
Nous nous sommes réunis dans cet Aïn-Oulmen, je
crois que c'était en quatorze, nous avions vingt ans, pour le Conseil de
révision en avril ou mai. Mais au mois de juillet ou d'août la guerre a été
déclarée. Au mois de septembre ils m'ont mis la capote, j'étais militaire et
trois mois plus tard on se trouvait au front.
Et nous avons fait notre devoir! Nous ne sommes pas
tous morts grâce à qui... en tous cas pas au Général qui nous commandait: il
fallait marcher et tuer et être tué… Celui qui y avait échappé... avait
échappé… ! Moi ce sera grâce à ma sœur que je m'en sortirai, parce qu'un jour
...
Nous étions en Orient nous avions fait une offensive
dans cette guerre aux environs de Salonique et compagnie! Et puis la retraite
est venue et nous nous sommes retirés, nous avons effectué... la
fortification du port de Salonique pour qu'on ne puisse pas nous rejeter à la
mer.
Alors bien entendu, lorsqu'est venue cette retraite
nous étions toujours en arrière-garde. Cela durait depuis deux ou trois jours
et un soir tard, la nuit est venue, alors toutes les colonnes de soldats et
autres... on en avait assez. À la pose, on s'est couché comme ça, appuyé sur
le sac et je me suis endormi.
Je me suis endormi et je n'ai entendu ni « Debout et
partez! » ni rien. Je dormais! Et j'ai fait un rêve, même maintenant j'ai
encore l'émotion quand j'en parle. Ma sœur qui était encore à Colbert me
disait: « O Dominique! Marche! O Dominique! Ils s'en vont, marche! »
Je me suis réveillé: on entendait venant de derrière
les tirs des Bulgares et des Allemands. Alors je me suis mis à marcher et
puis marche... et marche... dépassant des choses détruites...marche et marche
et marche...
À onze heures du matin j'ai rejoint la compagnie et
puis nous avons continué jusqu'à dix ou douze kilomètres de Salonique où l'on
a commencé à piocher e piocher encore pour faire ce fameux camp retranché de
Salonique! L'histoire doit en parler.
Et voilà une petite histoire de... comment
disent-ils ici en Français, de prémonition!
Hé bien! Je l'ai dit, basta!
Le travail de la terre
Moi : -« Les Algériens, quand vous êtes arrivés,
comment cultivaient-ils? »
Les Algériens? Ils cultivaient... mais je ne
voudrais même pas te le dire, il leur arrivait d'atteler un bourricot et puis
la femme avec, pour tirer cette espèce de soc...
Moi -« Une charrue arabe ? »
Oui, une charrue arabe ...
Moi : « avec un soc en bois... »
Un soc en bois et puis vas-y!
Moi :- « ...et c'est la femme et le bourricot qui
tiraient! »
Oui, ils tiraient et l'homme guidait. Ils faisaient
des petites récoltes, mais tu sais, insignifiantes. Quand ils avaient
quelques mesures de blé ou d'orge... Alors ils se louaient et nous les
employions et ils pouvaient au moins manger avec leurs gosses.
Savez-vous comment on pouvait faire la récolte avant
que les machines n'arrivent? Parce que plus tard il y a eu des
"Spicadora " pour faucher. Mais avant, comment faisions-nous?
Le soir à la tombée de la nuit, tous ceux qui
étaient à même de pouvoir faucher avec la faucille se rassemblaient. On en
prenait alors une trentaine ou plus selon les besoins de la récolte à
faucher.
Hé bien! On
les payait trente sous, mais on leur assurait un quart d'une boule de
pain et un deux oignons, suivant la grosseur des oignons... On leur donnait
ça et nous partions, nous, avec le même pain et les mêmes oignons.
Mais à quatre heures avant la tombée de la nuit on
rentrait tous et ça recommençait... Tous les colons prenaient des ouvriers.
Moi :-« ...tour à tour ? »
Non, seuls ceux qui demandaient à faucher, à couper,
cette récolte.
Plus tard nous avons acheté en empruntant une "
Espicadora " américaine. Il fallait six mulets ou chevaux pour la
traîner.
Moi :-« Une moissonneuse? »
C'était une moissonneuse et nous avons fait la
récolte plus facilement, on a avancé
un peu.
|
||||||
Moi :-« Vous passiez la moissonneuse et puis après
vous mettiez tout en meules? »
On mettait tout en meule et on prenait une batteuse
qui venait de Sétif.
C'était un entrepreneur qui venait parce que les
récoltes n'étaient pas très importantes... pas extraordinaires. En peu de
temps, il faisait le tour des meules des colons qui étaient là et il battait
chaque fois.
Avant qu'il y ait cette batteuse, il y avait l'aire
à battre...
Moi : -« L’"aghja" comme en Corse... »
Comme en Corse, oui, avec les trois ou quatre
chevaux ou mulets que l'on faisait battre. Et puis ensuite il fallait vanner,
il fallait trier, ventiler et puis avec des espèces de balais de bruyère on
enlevait la petite paille.
Moi-« Vous laviez le grain? »
Ah ça! C'était toute une histoire pour le faire
propre et l'envoyer. C'était des acheteurs de Constantine qui exploitaient
les colons !
Quand il y avait de la récolte, ils n'étaient pas
acheteurs. Ils attendaient pour prendre à bas prix. Et quand il n'y avait pas
de récolte, ils proposaient la vente de la semence à prix élevé.
Pour nous, en résumé, je vais vous dire : une année
c’était une récole moyenne, les suivantes étaient mauvaises ? Alors pour acheter de la semence, cette semence,
comment faire?
Mon père allait à Sétif avec les titres de la
propriété pour obtenir de quoi acheter cette semence.
Moi :-«Il demandait un prêt? »
La banque exigeait un prêt hypothécaire… oui! Si
bien que pendant des années et des années... et mon père a continué, mais
nous nous avions grandi et l’an quatorze, le fameux quatorze est arrivé...
les jeunes sont partis pour la guerre.
Joseph qui était de 1890 était déjà parti, il avait
plus de deux ans de faits. François est parti un an avant, en montagne du
côté de Nice, dans les bérets bleus , les " Alpins " Et moi,
j'avais déjà passé le Conseil de révision, tant et si bien qu'en septembre,
ils m'ont " mis en route "et je suis parti aussi.
Alors mon père est resté seul, si bien que je ne
sais pas comment ils ont vécu, parce que moi, j'ai fait plus de quatre ans:
je suis rentré de cette guerre seulement en 1919 au mois de mai. J'avais eu, il est vrai,
une permission après vingt-quatre mois du côté du Front d’Orient, en
Macédoine après les Dardanelles. J'ai eu cette permission mais la guerre a
continué et nous l'avons continuée.
|
||||||
|
Spahis du Goum des Haracta
(Bataille de la Marne 1914)
|
||||||
Aïn-Beïda
Je suis rentré à Colbert. François qui était à
Philippeville et " faisait " des céréales, était allé jusqu'à
Aïn-Beïda et il était descendu au Grand Hôtel d'Orient qui était tenu par un
monsieur Mourguès, marié à une fille de Marignana..
Moi :-«Il était corse?»"
Il ne l'était peut-être pas de naissance... enfin il
s'était marié à Marignana avec une Corse. Ils tenaient cet hôtel depuis plus
de quinze ans. Ils lui ont dit: « Nous cherchons à vendre » parce que les
enfants étaient partis.
De Philippeville François a pensé que nous serions
peut-être mieux à deux. Il est venu à la maison. Il m’a dit: « Tu veux
t'associer avec moi? Nous allons acheter un bel hôtel à Aïn-Beïda.» J'ai
répondu que j'étais libre: « Si tu le veux c'est d'accord ».Il me dit: «
Alors viens avec moi, nous allons traiter. »
Je suis parti avec lui pour Philippeville. De là,
dans une petite "Quadriette" Peugeot nous nous embarquons pour
Aïn-Beïda. On a rencontré les Mourguès. On a versé un petit peu pour le
principe. Puis nous avons fait le contrat d'achat payable en tant d'années
répartis comme nous pensions pouvoir faire.
Et voilà!
Et nous nous retrouvons donc à Aïn-Beïda et nous
commençons notre association ...
Moi :-« Mais vous ne connaissiez pas Ain-Beïda »
Je ne connaissais pas Ain-Beïda. Je n'y étais jamais
allé auparavant.
Moi :-« Comment c'était? »
C'était agréable. Il y avait une belle entrée dès la
descente en gare.
Moi :-« Des arbres... »
Des arbres... et j'ai trouvé agréable... et tu sais,
quand on va pour travailler
Il y avait des Européens. C’était une grande
municipalité, tout un centre de commune, une belle commune.
Alors on s'est installé. Mais nous, avec François,
nous avons tout transformé, tout aéré, tout rénové. Et on s'est mis au
travail. Et comme il y avait à l'époque beaucoup de jeunes, beaucoup
d'employés... Nous avions trois salles, une grande salle de café, deux salles
de restaurant, une grande cuisine, une grande cave et deux cours.
|
||||||
|
Grand Hôtel d’Orient 1925
|
||||||
Nous avons fait réparer la toiture, refaire
l'électricité. Nous avons pris un peintre, un maçon, tout ce qu'il fallait
pour arranger.
Nous avons renouvelé la vaisselle parce que nos
prédécesseurs étaient déjà âgés et avaient laissé tomber un peu. Et nous avons commencé!
Moi-« L’oncle François était déjà marié? »
Oui, il avait déjà une toute petite fille
L'association... si tu veux que je t'en dise deux
mots... pour payer l'hôtel nous nous étions engagés à ne pas gaspiller notre
recette. Alors François et moi bien sûr: rien; mais pour compenser, nous
avions fixé un salaire pour la femme de François.
Et voilà nous sommes partis! Nous avons eu
immédiatement une belle clientèle. Les Corses par leur clientèle nous ont
bien aidés, parce qu'il y en avait aussi à Aïn-Beïda, bien sûr.
Moi-« Comment l’oncle François a-t-il été conduit à monter la limonaderie ?
Il a monté son affaire à lui, car moi, je ne voulais
pas participer à deux choses à la fois.
Moi-"Avant, il n'y avait pas de
limonaderie. »
Non, il n'y avait pas de limonaderie, alors il l'a
montée. Elle n'entrait pas dans l'association, parce que moi je ne pouvais
pas " couvrir "avec ce que nous faisions comme recette partagée en
deux et rembourser. L’argent empruntée
Je ne pouvais pas m'associer encore. Lui, avait déjà
amassé un pécule assez important avec les céréales qu'il avait "faites
" à Philippeville. Alors, j'ai laissé la limonaderie pour lui mais
c'était attenant à l'immeuble de l'hôtel.
Moi-« "Parce qu'il avait fait une limonaderie
là-bas derrière... »
Derrière, oui. l’hôtel... que je te dise qu'en plus
de ce que je t'ai déjà signalé, avait vingt-six chambres que nous avions fait
refaire totalement: literie, table de nuit, grande table et tout!
Si bien qu'il y avait beaucoup de voyageurs qui
venaient pour placer leur marchandise. Il y avait des employés de la Police,
des commissaires enquêteurs de la propriété foncière et ce monde-là nous
l'avions, plus tous les colons qui venaient tous les lundis, au moins, et à
d'autres moments aussi.
Nous avions fait une belle clientèle et même
sélectionnée, autre que celle de certains cafés qui existaient, je ne parle
pas des cafés maures, mais des cafés français qui acceptaient un petit peu
ceux qui " boivent " et qui font la bagarre. Nous avions vraiment
une bonne clientèle!
-«A quel moment la limonaderie a-t-elle été
transférée où était Faletti par la suite?»
A quel moment, il l'a transférée ... ?
-« Ça s'est avéré trop petit rapidement ? »
Lorsque je me suis marié en 1926... tu vois qu'il y
avait quelques années de passées. Son amortissement étant fait mon frère
s'est retiré dans sa limonaderie mais il participait encore. Mais un jour, il
m'a dit: « Moi, je préférerais vendre. Si tu veux acheter, bien sinon on
vendrait ma part à quelqu'un d'Ain-Beïda. »
J’ai préféré faire un emprunt bancaire et assumer la
totalité des charges.
Mais après cela je n’avais plus d'argent, je n'avais
plus rien!
Si bien qu'en plus de mon travail à l'hôtel, dès que
je pouvais m'échapper, j'ai commencé à l'invitation d'un de mes amis de
Khenchela, à " faire " de l’agréage de céréales. Puis il y avait un
voyageur en assurances qui venait à l'hôtel et j'ai pris une part à
l'exploitation de son portefeuille.
Puisque je parcourais le bled pour les céréales, je
pouvais faire les assurances en même temps.
C'était avant la guerre et ensuite j'ai accepté de
représenter la société... Je ne me
souviens plus... dis-moi ...
Moi :-«Algéronaphte.»
Algéronaphte... fuel-oil, mazout et huiles
Moi : -«C'était après la guerre.»
C'était après la guerre. Voilà mon travail. Voilà
comment j'ai continué à durement travailler en devenant courtier
Et basta !.
|
||||||
|
Le Marché 1925
|
||||||
R e t o u r
Je raconte.
J'avais pensé que ces pages ne devaient comporter
que les souvenirs de mon père mais Gil mon épouse m'a convaincu de les
compléter par le récit du retour de celui-ci à Marignana en 1966, soixante ans
après l'expatriation de la famille vers l'Algérie.
De nous quatre j'étais le seul à avoir eu l'occasion
de venir en Corse. Après un premier séjour de découverte que j'avais effectué
en 1953, ce fut un rapide aller-retour en une journée, entre l'aérodrome du
Centre d'Essais en Vol de Brétigny-sur-Orge et Ajaccio, en biréacteur «
Morane 763 Paris. »
Le survol de la côte occidentale de l'île et en
particulier de la région de Marignana, avait fait naître en moi le désir
d'effectuer un voyage en famille qui permettrait à mon père de revoir sa
terre ancestrale et son village natal et à ma mère et à Gil de découvrir la
Corse.
Ma mère était déjà très malade et nous hésitâmes
avant de prendre une décision. Cependant mes parents acceptèrent volontiers
d'effectuer ce voyage.
Il fallut organiser ce qui était encore une petite
expédition avec la réservation difficile des places en plein été.
Mon père n'avait aucun souvenir d'Ajaccio. Le
passage qu'il y avait fait en 1906 avait été bref et dans les mauvaises
conditions que l'on sait.
Ce que je vais rapporter relève plus de mon
observation que de ses commentaires qui furent très fragmentaires pendant ces
quelques jours.
Nous nous sommes rapidement décidés à nous rendre à
Marignana.
Nous comptions rester plusieurs jours chez la
dernière sœur de mon père qui habitait la maison familiale qu'elle avait fait
remettre en état eût été donnée par ses frères et sa sœur, lors de son
rapatriement d'Algérie après l'indépendance. C’est finalement la seule qui
ait été vraiment rapatriée.
Nous avons été le plus attentifs possible aux
réactions de mon père retrouvant son village après soixante ans.
A l'étonnement de son cousin germain qui n'avait
jamais quitté Marignana, il rappelait avec une extraordinaire précision le
nom de ceux qui habitaient au début du siècle telle ou telle maison.
Ajaccio- Les Iles sanguinaires Marignana
Il lisait à livre ouvert dans les lieux dont il
énonçait chemin faisant les noms:... La moindre ruelle, le plus petit
sentier, les escaliers, les murets étaient gravés dans sa mémoire, comme
moi-même pour Aïn-Beïda à la différence qu’il n’en était parti qu’à l’âge de
douze ans.
Nous attendîmes en vain quelques impressions de mon
père sur ce retour dans sa maison natale. La crainte de se montrer gagné par
l'émotion le retint de faire le moindre commentaire.
Nous fîmes ensuite des promenades dont l’une nous marqua
profondément
Nous avions décidé de nous rendre à la Tavulella,
lieu mythique familial, pour que mon père nous montrât les " planches
" que cultivait mon grand-père au bord de la rivière, témoignage de
l'ardeur de nos ancêtres à tirer le meilleur parti de leurs lopins de
terrain. Nous pûmes y accéder encore assez facilement malgré l'invasion des
ronces
Chemin faisant, il nous montra tel noyer que son
père avait planté et qui portait encore des fruits.
Il commenta l'étagement des petites parcelles. Il
raconta les étapes de la confection de la farine de châtaigne tandis que nous
parvenions au vieux moulin à eau où l'on pouvait toujours voir des restes de
la structure mécanique et des rigoles permettant l’acheminement de l'eau pour
en faire tourner les meules.
Comme il mentionnait que la rivière était à
l'époque, très poissonneuse et qu'ils attrapaient des truites à la main, il
joignit le geste à la parole, retroussa les jambes de son pantalon et entra
dans l'eau, disant qu'il allait voir s’il y en avait toujours autant sous la
même roche. Je savais mon père chasseur mais je ne pensais pas qu'il ait pu pêcher.
Lorsqu'il parvint au milieu des pierres, il se
pencha et mit sa main dans l'eau. Au bout d'un moment il nous dit: « Je sens
une truite ... je lui caresse le ventre pour la sortir... »Nous pensions
qu'il plaisantait mais, à la demande de Gil je pris la caméra, on ne savait
jamais! Je ne voulais pas rater une prise de vue que je pensais improbable.
Tandis que je filmais, mon père nous dit: « Ca y
est, je la tiens. »Et tout à coup, il offrit à nos yeux médusés une jolie
petite truite toute frétillante! Je ne regrettai pas d'avoir continué de
filmer et c'est Cyrnos, notre chat qui nous accompagnait, qui dégusta cette
victime d'un tour de main marignanais conservé intact après soixante années.
Notre voyage en Corse se poursuivit par un grand
tour de l'île.
Ce n'est que douze ans plus tard, à Noël 1978 que
nous sommes revenus en Corse avec mon père.
Nous avions décidé de lui permettre de revoir à
nouveau Marignana. Malheureusement au jour dit, nous avons rencontré de la
neige dès Saint-Roch et la couche s'épaissit jusqu'à nous immobiliser, faute
de chaînes. Je fus obligé de procéder à une longue marche arrière pour pouvoir
faire demi-tour vers Ajaccio.
Le lendemain, forts de cette expérience nous sommes
passés par la côte et ainsi nous avons trouvé une route dégagée.
|
||||||
Nous avons repris la route de Marignana, mais en
traversant la châtaigneraie aux arbres dépourvus de feuilles semblant comme
de puissants piliers soutenir le ciel, mon père s'enferma dans un mutisme
révélateur de l'angoisse qui l’avait saisi devant la désolation du paysage
Le village avait sa physionomie hivernale. Il était
désert. Peu de cheminées laissaient échapper un voile de fumée, les ruelles
étaient vides. Les murs gris renvoyaient en écho le seul bruit de
l'écoulement de l'eau de la fontaine
Je proposai à mon père de monter vers les hauteurs.
Nous avons emprunté le chemin défoncé par les orages qui y conduisait. Il
était jonché de branches mortes qui en rendaient l'utilisation aléatoire. Je
décidai alors de faire une marche arrière sur une centaine de mètres. Cette
action était délicate mais ne comportait aucun risque.
Pendant toute la manœuvre mon père ne cessa de me
harceler de mises en garde : « Attention! Attention! »répétait-il à notre
grand étonnement. J'eus beau tenter de le convaincre que je faisais
effectivement attention, que j'allais lentement et qu'il n'y avait aucun
danger. Rien n'y fit.
Nous avons quitté Marignana tandis que de lourds
nuages couvraient le village et annonçaient une nuit précoce. Nous sommes
rentrés à Ajaccio déçus par cette journée que nous avions tellement attendue.
Le soir au dîner, je me décidai à interroger mon père
sur son comportement inhabituel: « Comment se fait-il que tu n'aies pas
arrêté de me mettre en garde au cours de ma marche arrière sur le chemin
difficile.
Il resta silencieux un long moment puis il répondit:
« Pendant
cette manœuvre, j'ai pensé tout à coup à tous ces anciens disparus depuis si
longtemps et je les ai entendus me dire: « O Dumè! Tu es revenu... hé bien,
nous allons te garder avec nous, tu ne repartiras plus jamais d'ici! »
Nous sommes restés silencieux, nous gardant bien de
faire le moindre commentaire sur ces propos étranges.
Mon père ne nous demanda plus jamais de le ramener
en Corse.
Je pense qu'ayant revu Marignana en été 1966, il
n'avait jamais pensé que le village pouvait présenter en hiver un aspect
aussi désolé. Cela a dû lui donner l'impression qu’il était voué à l'abandon
et que quelque jour seules les ombres des ancêtres erreraient dans ses rues
dépeuplées.
Dans ses derniers jours à près de quatre-vingt-dix
ans il m’a dit : « Je crois que vais
aller mourir en Algérie.» C’est là-bas que ses père et mère reposent.
|
||||||
Que Dieu les ait en Sa Sainte
Miséricorde
Mon père en 1978 à Marignana
|
||||||
|
||||||















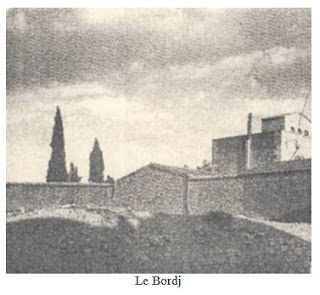











هناك 3 تعليقات:
ttرائع ما تقدمه أخي أبو حمزة
جزاك الله كل خير
يحق لك أن تفتخر بمسقط رأسك
رائع ما تقدمه أخي أبو حمزة
جزاك الله كل خير
يحق لك أن تفتخر بمسقط رأسك
هل بالإمكان الحصول على نسخة من كتاب جورج كوبولاني
إرسال تعليق